De nouveau ils parurent tentés, curieux.
– Est-ce vrai que l'Homme du Tonnerre fait sauter la montagne ? demandèrent-ils. Est-ce vrai que les Iroquois se sont enfuis devant lui ?
Angélique disait :
– Oui, l'Homme du Tonnerre faisait sauter la montagne. Non, les Iroquois ne s'étaient pas enfuis. Simplement, les Iroquois avaient fait alliance avec l'Homme du Tonnerre, car celui-ci avait payé le prix du sang au delà de tout ce qu'on n'avait jamais vu.
– Est-ce vrai, demandaient les Abénakis, qu'il y avait dans les présents aux Iroquois des perles rouges comme le sang, jaunes comme l'or et translucides comme la sève qui coule de l'arbre, des perles inconnues des autres traitants ?
– Oui, c'était vrai, qu'ils viennent donc jusqu'au fort. Ils les verraient de leurs propres yeux.
La pluie se mit à tomber doucement sur les feuilles.
Un cri grêle s'éleva, une sorte de miaulement de chat... Les Indiens éclatèrent de rire devant les mines stupéfaites d'Angélique et de Cantor. Content de les étonner à leur tour, l'un d'eux sortit d'une espèce de sac qu'il avait en bandoulière un petit être rouge et nu qu'il présentait par les pieds et qui se mit à s'égosiller avec toute l'énergie d'un nouveau-né mécontent. Une des femmes alors, en pleurant, parla. Elle s'adressait à Cantor car elle avait constaté qu'il comprenait bien l'anglais.
– Elle dit que c'est son enfant. Qu'il est né il y a six jours, dans la forêt...
– Seigneur ! murmura Angélique. Il faut absolument décider les Indiens à venir jusqu'au fort afin de donner quelques Soins à ces pauvres gens.
Enfin, multipliant les promesses de perles, de tabac, de munitions pour le mousquet, de couvertures splendides, ils réussirent à convaincre les Indiens. Durant le trajet, tandis que Cantor soutenait l'homme blessé, celui qui était valide racontait son odyssée.
Ils étaient tous habitants d'un petit hameau de l'intérieur, des « habitants des frontières », comme les désignaient ceux du rivage. Biddeford, près du lac Sébago. Le fort gardait à l'intérieur de ses palissades une trentaine de familles. Mais certains fermiers plus indépendants, comme les William, s'étaient installés au-dehors. Lui-même, Daugherty et son fils, le jeune Samuel, étaient « engagés » dans cette famille. En arrivant un matin avec son fils pour prendre son travail, à peine la porte de la maison s'ouvrait-elle qu'on avait vu surgir des fourrés un groupe d'Abénakis qui devaient s'y être cachés la nuit et qui attendaient une occasion de ce genre pour pénétrer dans l'habitation.
En un tournemain, les sauvages se saisirent de tous ceux qui se trouvaient là, arrachant les enfants de leurs lits, ce qui expliquait pourquoi ces pauvres petits étaient pieds nus et vêtus d'une seule chemise, ainsi que Mistress William elle-même qui venait juste de se lever. Ils raflèrent tout ce qu'ils purent trouver de vêtements, d'ustensiles, de provisions, et entraînèrent tout le monde en courant jusqu'à la lisière de la forêt.
Puis ils s'enfoncèrent dans les bois avec leurs captures. Le raid s'était accompli si promptement et dans un tel silence que du fort ou du village on n'avait rien pu entendre. Ni rien voir, car ce matin-là la brume était si épaisse qu'on ne se distinguait pas à dix pas. Alors avait commencé pour les malheureux une marche torturante. Les Indiens, soucieux de s'éloigner au plus vite des lieux de leurs exploits, les pressaient et les harcelaient. Le fermier, qui n'avait qu'une chaussure au pied – il était en train d'enfiler ses bas lorsque les sauvages l'avaient empoigné – donna ces bas à sa femme qui était pieds nus. Ce que voyant un des sauvages, comprenant que la captive, enceinte et presque à terme, ne pourrait soutenir la marche sur une paire de bas, lui passa une paire de chaussons en peau d'orignal. William se blessa à son pied nu en s'y enfonçant une épine. Le lendemain, ils étaient parvenus sur les rives de la rivière Androscoggin. Les sauvages avaient fabriqué deux radeaux pour la traverser. Ensuite, comme on s'éloignait des établissements anglais, les Indiens avaient consenti à ralentir un peu l'allure. Le pied de William enflait. Il fallait le soutenir. Puis Mistress William avait été prise des douleurs de l'enfantement...
La voix du pauvre « engagé », qui se nommait Phileas Daugherty, ne cessait de s'élever et de s'abaisser dans ses lamentations comme une litanie ininterrompue ; tant de confidences de leurs misères à une oreille enfin complaisante lui apportaient du soulagement, et la pluie redoublait, rendant plus pénible leur marche dans la glaise mouillée. Lorsqu'ils arrivèrent en vue du fort Wapassou et longèrent les lacs, la bourrasque s'éleva et les bouleaux tordant leurs cimes les aspergèrent au passage.
Enfin Angélique et ses convives indiens s'engouffrèrent dans la salle bien chauffée et tandis que Joffrey de Peyrac, tout de suite au fait de la situation, recevait avec déférence les Indiens, Angélique put se dévouer aux prisonniers de ceux-ci. On coucha Mistress William dans le lit, bien bassiné, de Mme Jonas. Lavée, pansée, réchauffée, la pauvre femme retrouva des couleurs sur son visage d'un blanc de craie. L'autre femme, celle dont l'enfant de deux ans avait été jeté à la rivière, était restée sur le banc à grelotter. Lorsque Angélique voulut l'emmener dans une chambre pour la débarrasser de ses vêtements trempés le sachem Quandequiba s'y opposa. Selon la coutume des Abénakis, celui qui le premier mettait la main sur un prisonnier en était considéré comme le maître et le propriétaire, et il devait désormais être obéi sous peine des plus durs traitements. La jeune femme et son fils appartenaient à Quandequiba qui ne semblait pas disposé à être un maître particulièrement tendre.
– Ce Quandequiba est mauvais comme la teigne, confia Angélique à Nicolas Perrot, qu'elle prit en aparté. Essayez donc de le convaincre, vous, Canadien, de me laisser soigner cette malheureuse.
Elle était indignée de l'indifférence que manifestait Perrot pour le sort de ces gens, surtout des femmes. Bien qu'il fût fort brave homme il était avant tout Canadien, et pour lui l'Anglais hérétique n'appartenait pas à une espèce qu'il soit nécessaire de ménager. Mais, voyant une déception mêlée d'horreur dans les yeux d'Angélique, il essaya de se disculper.
– N'allez pas croire, madame, que ces femmes sont tellement à plaindre. Certes, les Indiens les traiteront peut-être comme des servantes corvéables mais ne craignez pas pour leur honneur. Les Indiens ne violent jamais leurs prisonnières8 comme cela se fait en Europe. Ils estiment qu'une femme contrainte attire le malheur sur un wigwam. Et, de plus, je crois que les femmes blanches leur inspirent une certaine répugnance. Si ces Anglaises et leurs enfants se montrent dociles, elles ne seront pas malheureuses.
Et si elles ont la grâce d'être rachetées par une honorable famille montréalaise elles seront en outre baptisées et ainsi leurs âmes seront sauvées. Ces Anglais ont de la chance d'être tirés de l'hérésie.
Il lui rappela aussi que les Canadiens avaient eu beaucoup à souffrir des Iroquois qui, eux aussi, enlevaient des Blancs, mais c'était pour les torturer affreusement, ce que ne faisaient pas les Abénakis, alliés des Français.
Après cette petite mise au point, il alla trouver Quandequiba et le convainquit de laisser reposer et nourrir sa prisonnière, car si celle-ci mourait en chemin quel bénéfice tirerait-il de son expédition, à part quelques hardes et casseroles qu'il aurait traînées sur plusieurs centaines de miles ? Plongé dans l'euphorie d'un tabac de Virginie, Quandequiba voulut bien laisser faire.
La jeune femme était une sœur de Mistress William. Elle habitait le poste de Biddeford, mais son mari, étant parti faire un voyage de quelques jours à Portland, elle en avait profité pour rendre visite à sa sœur avec son petit garçon. Que dirait le pauvre James Darwin, son époux, en retrouvant son foyer vide ? Elle pleurait intarissablement. Angélique, aidée d'Elvire, lui fit prendre un bain de vapeur, lui donna du linge et des vêtements secs, lui coiffa les cheveux et elle finit par sourire faiblement, surtout lorsqu'elle vit son petit bonhomme, rassasié et réchauffé, s'endormir sur son sein.
Elle tremblait pour lui. L'enfant, tout au long du voyage, n'avait cessé de pleurer bruyamment et ses gémissements exaspéraient les Indiens qui par deux fois avaient failli le tuer pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, sans l'intervention de Cantor, c'eût été chose faite. Elle baisait la main d'Angélique et continuait à la supplier de les racheter. Enfin, elle s'endormit allongée aux côtés de sa sœur. Mme Jonas vint demander les conseils d'Angélique pour le pied du fermier William, qui trempait dans une bassine d'eau additionnée de benjoin et de consoude. Angélique vit tout de suite que seul le bistouri éviterait la gangrène à la jambe enflée et distendue. Les Indiens la regardèrent avec admiration manier sans hésitation le petit couteau étincelant que M. Jonas lui avait forgé pour ses opérations délicates. Les sauvages étaient contents de l'accueil qu'on leur faisait. Le maître de William remercia Angélique de lui rendre un captif en état de marche.
Par intermittence, le miaulement du nouveau-né sortait de la carnassière d'un des Indiens où celui-ci le conservait comme un levreau écorché en réserve pour son dîner. Il fallut encore à Angélique beaucoup de diplomatie pour obtenir la petite créature. Enfin elle l'emporta dans ses deux mains. Elle fit sa toilette sur le lit de sa mère.
– Dieu soit loué, c'est une fille ! Elle survivra... les filles sont plus résistantes que les garçons...
Elle protégea d'huile de tournesol la peau fragile, langea le bébé et le mit au sein de sa mère qui heureusement avait un peu de lait. La pauvre femme racontait les affres qu'elle avait traversées, la marche insensée dans la forêt, le froid, la faim, la peur, les pieds meurtris. Mme Jonas, qui savait l'anglais comme toute bonne commerçante de La Rochelle, traduisait. L'Anglaise racontait que lorsqu'elle avait été prise des douleurs de l'enfantement, elle croyait sa dernière heure venue. Les Indiens, en l'occurrence, s'étaient montrés humains. Ils avaient bâti une cabane afin qu'elle s'y abritât et l'avait laissée aux soins de son mari et de sa sœur, emmenant les autres enfants à l'écart. Après la naissance, qui s'était passée sans trop de peine, ils avaient paru réjouis de l'événement et l'avaient même célébré en dansant et en poussant des hurlements épouvantables. Ils avaient consenti à demeurer un jour sur place pour laisser à la malade le temps de se reposer et avaient, durant cette journée, confectionné une litière avec des branchages. Pendant deux jours c'est ainsi qu'elle avait été transportée par son mari et « l'engagé » blanc. Mais ensuite ceux-ci, épuisés, et surtout William dont le pied s'infectait, ne purent plus soutenir leur effort. Les Indiens répugnaient à transporter la litière. C'était au-dessous de leur dignité. Comme ils discutaient d'abandonner la femme et l'enfant
dans la forêt, après les avoir tués d'un coup de hache, Mistress William dans sa torpeur avait trouvé la force de marcher et c'est ainsi que leur calvaire avait continué. Elles se croyaient en Paradis, mais demain leur martyre reprendrait. Angélique s'indignait à la pensée d'abandonner ces femmes blanches aux mains des sauvages. Elle s'entretint avec son mari de la possibilité de les arracher à leur triste sort. Le comte de Peyrac avait déjà proposé de racheter tous les captifs, mais les Abénakis se montraient intraitables. Ils acceptaient les présents pour avoir consenti à s'arrêter dans le fort et quand on y eut ajouté plusieurs rasades de perles, six couteaux, une couverture pour chacun, ils acceptèrent de rester encore un jour afin de permettre à l'état des prisonniers de s'améliorer.
Mais ils tenaient trop à leur entrée glorieuse dans leur village poussant devant eux les prisonniers « matachiés » de couleurs vives, au milieu des cris d'enthousiasme, pour revenir les mains vides d'une si périlleuse expédition. Ils avaient aussi à Montréal des amis canadiens qui les féliciteraient fort de contribuer à sauver des âmes pour le paradis des Français. Et qui les paieraient un bon prix. Les Français étaient fort généreux quand il s'agissait de gagner des âmes à leur foi. Sans doute, parce qu'ils étaient si peu nombreux, ils avaient besoin de toutes les forces invisibles avec eux. Et dans ce domaine, la cohorte était belle : les saints, les anges, les âmes de leurs morts, les âmes converties... Voilà pourquoi les Français de Canada finiraient par triompher des Iroquois et des Anglais, malgré leur petit nombre. Quandequiba ne pouvait pas trahir les Français en les privant de ces âmes sur lesquelles ils comptaient tant. Peyrac pouvait-il se porter garant qu'il ferait baptiser les « Yenngli » par la « Robe Noire » ? Non, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi ces vaines discussions ? Angélique, quand la nuit vint, commençait à éprouver de la compréhension, sinon de l'indulgence, à l'égard des conquérants espagnols qui avaient brûlé vive une bonne partie de la race rouge sur d'énormes bûchers. Ils avaient dû avoir, à certains moments, des excuses. Angélique aurait volontiers pris les armes, mais, malgré le déplaisir qu'ils avaient tous de laisser des Blancs aux mains des sauvages, Peyrac ne pouvait envisager de risquer une guerre avec la Nouvelle-France et les nations Abénakis pour une poignée de laboureurs anglais. Angélique finit, la mort dans l'âme, par se rendre à leurs raisons. Elle avait encore beaucoup de choses à apprendre sur l'Amérique.

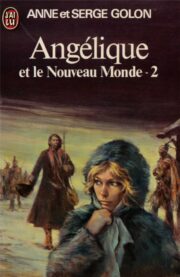
"Angélique et le Nouveau Monde Part 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique et le Nouveau Monde Part 2" друзьям в соцсетях.