– Tu sais bien qu'on ne pouvait les amener. Ils sont protestants.
– Ze veux retourner chez les protestants ! cria Honorine de toute sa voix.
Une telle exclamation hurlée au sein d'une cité éminemment papiste était pour le moins inopportune.
On se retira précipitamment dans la maison, on mit presque les verrous et les barres aux portes et, enfin tranquilles, on graissa la grande poêle à crêpes et elle fut déposée sur les braises de l'âtre.
Pour distraire l'humeur de sa fille, Angélique monta avec elle jusqu'au deuxième comble du toit que l'on atteignait par une courte échelle. Des lucarnes, on voyait alors très loin.
Angélique et Honorine, la tête et les épaules sorties au ras de l'imposte et le visage fouetté par le vent, pouvaient jeter un regard circulaire sur le domaine à leurs pieds. D'où elles se trouvaient leur vue plongeait par-dessus les murs et les palissades.
L'enclos des ursulines offrait un champ d'observations des plus faciles à la curiosité d'Honorine et de sa mère. Malgré les grands murs qui cernaient la propriété, il leur était loisible de suivre l'existence familière, toute de piété et de travaux, de ces femmes petites élèves, dont la plupart filles d'habitants ou de seigneurs éloignés, étaient pensionnaires, prenaient leur récréation dans le verger.
Angélique avait observé que la principale distraction de ces enfants paraissait être la danse. Des danses paysannes pour la plupart, amenées des provinces d'origine par les parents : la bourrée, le rigodon.
Elles se tenaient par le bras et tournaient en rond, dans un sens, dans l'autre. Elles se plaçaient en rangées, face à face, avançaient, reculaient, en battant des mains, faisaient la révérence... Dans l'air glacé, les petites voix scandaient les ritournelles naïves.
Sur le pont de Nantes
Marion, Marion, danse
Sur le pont de Nantes
Marion dansera.
Bergers, entrez dans la danse
Marion, Marion, danse
Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.
Il y avait quelques enfants indiennes parmi elles, auxquelles on laissait leurs habillements de peaux frangées, leurs mocassins et leur petite plume unique plantée dans le ruban brodé de perles qui retenait leurs longs cheveux noirs. Elles paraissaient gaies et espiègles et ne dansaient pas moins et ne criaient pas moins que les autres.
Dans un coin de l'enclos s'érigeait l'habituel groupement de quelques huttes d'écorce autour d'un foyer toujours fumant, petit campement d'Indiens réfugiés à l'ombre bénie de ces douces ursulines. Une vieille Indienne s'y apercevait toujours préoccupée à longueur de journée de soulever le couvercle de la marmite, d'en surveiller le contenu, de la retirer du feu, d'y ajouter un morceau de gras, une poignée de maïs, un gobelet d'eau. Comme un essaim de moineaux, quelques fillettes parfois s'abattaient autour d'elle dans ce coin du jardin, faisaient cercle, écoutaient une histoire, ne se privaient pas de pêcher dans le chaudron du bout des doigts quelques morceaux de la sagamité.
Elles repartaient en courant, se poursuivaient, grimpaient dans les arbres, ces courts pommiers trapus, dont la silhouette tordue étalée, avec des coudes, des angles aigus dans les rejets, parlait de leur croissance difficile, de branches brisées maintes fois sous le poids des neiges ou l'emprise des glaces.
Les fillettes, aux jupes colorées, se perchaient là-dessus, animant les branches de leurs plumages.
– Comme elles s'amusent bien ! faisait remarquer Angélique à Honorine. N'aurais-tu pas envie, un jour, d'aller jouer avec elles ?
Honorine regardait, s'intéressait, mais répondait :« Non ».
« Il faudrait pourtant qu'elle apprenne à lire », pensait Angélique.
Mais elle savait qu'elle n'aurait jamais le courage d'abandonner Honorine sur le seuil d'une porte conventuelle sans qu'elle en eût manifesté le désir. Honorine avait toujours été seule. Seule avec sa mère et de nulle part. Elle éprouvait de la méfiance vis-à-vis de la société comme si elle avait eu l'instinct d'en avoir été rejetée dès sa naissance. Le jour où elle se mêlerait aux joyeuses petites Canadiennes, ce serait une réparation du destin.
Pour l'instant, Honorine disait non. Est-ce que les petits garçons du Séminaire s'amusaient autant que les petites filles des ursulines ? demandait-elle. Emmanuel avait dit à Angélique que les garçons jouaient surtout à la crosse, le jeu iroquois dont ils étaient très férus.
Dès qu'on les lâchait un instant, ils se saisissaient d'un bâton et d'une balle de lanières de cuir serré, pour taper dessus. Ils se battaient à coups de boules de neige, comme tous les gamins. Ils étaient turbulents, et l'abbé, qui avait appartenu aux missions de Monsieur Vincent de Paul, les jugeait plus instables mais plus éveillés que les enfants de France du même âge et de même condition. Ils aimaient danser eux aussi, mais, encore une fois, c'étaient des danses païennes, estimaient leurs éducateurs, que leur apprenaient leurs condisciples sauvages, et on le leur avait interdit car cela éveillait la nostalgie des enfants indiens qui s'enfuyaient alors des hauts murs du Séminaire, cherchant à rejoindre leurs tribus au fond des bois.
À propos de ce que lui avait dit Ville d'Avray, elle risqua une petite enquête afin d'en avoir le cœur net.
Recevant le maître d'hôtel Tissot, elle l'interrogea à brûle-pourpoint.
– Vous qui avez servi à la Cour, avez-vous reconnu la personne qui se cache sous le nom de duc de La Ferté et que l'on trouve en ville ?
Il lui lança un bref regard de côté et inclina la tête affirmativement.
– N'est-ce pas incompréhensible ? dit-elle déçue. Lui ! Quels motifs peuvent pousser un homme si haut placé et dans une position sûre grâce au rang de sa sœur à se dissimuler, en quelque sorte fuir...
– Les motifs qui entraînent un grand seigneur de la Cour à vouloir se faire oublier quelque temps ne manquent pas. La justice n'est plus aussi indulgente qu'autrefois pour certains crimes. Et elle a reçu les droits et les facilités de pouvoir remonter à toutes les sources.
Il baissa la voix.
– ... Sa Majesté a été fort malade l'an dernier, au point que l'on a pu craindre qu'Elle n'en réchappe pas. Les médecins, en dépit de leur ignorance, ont fini par parler d'empoisonnement. Aux cuisines, on est venu nous poser beaucoup de questions. Pour nous, officiers de Bouche, c'était l'évidence même. Madame de Montespan a un peu trop forcé sur les poudres destinées à ranimer les ardeurs du Roi pour elle. Pour peu que ce duc... de La Ferté l'ait aidée, et qu'il ait vu les enquêteurs se rapprocher de sa personne et commencer d'interroger ses domestiques et les gens de sa maison... Mieux valait qu'il se soustraie à leur curiosité malsaine, au moins dans l'immédiat. Si le Roi était mort, il y aurait eu crime de lèse-majesté.
– Et c'est aussi par la faute de cette histoire que vous avez vous-même décidé de quitter le royaume.
– Un officier de la Bouche du Roi sait forcément, de par sa charge, trop de choses. Il est donc le premier menacé par les uns et par les autres, les uns ayant intérêt à ce qu'il se taise, les autres à ce qu'il parle.
– Craignez-vous qu'« il » ne vous ait reconnu ici à Québec ? Qu'il ne s'en effraye et ne cherche à vous supprimer ? Votre engagement près de nous aura été pour vous un mauvais hasard.
– Pas plus que pour vous, Madame, qui ne vous attendiez pas à « le » rencontrer ici : il n'y a pas à s'étonner de ces hasards. C'est le contraire qui serait surprenant. Quoi qu'on en dise, la Terre est étroite. Ce sont toujours les mêmes sortes de gens que l'on rencontre aux mêmes endroits. Je suis au service de Monsieur de Peyrac et chercherai autant que possible à me cantonner au château de Montigny qui est une demeure à l'écart. Avec un peu d'habileté, je peux, en ce qui me concerne, n'avoir jamais l'occasion de me trouver en sa présence.
– J'en accepte l'augure et vous y encourage. Mais le jeu va être serré. Nous sommes enfermés dans une petite ville sans issue, où l'on sait vite tout de chacun et d'où l'on ne peut s'échapper.
– Croyez-vous, Madame, que celui que l'on joue à Versailles n'est pas moins serré, ni dangereux ? Il ne faut pas trop penser et ne le faire qu'à bon escient. Ne réserver cet exercice qu'à l'heure dangereuse qui le mérite. Hors cela, avec un peu d'inconscience et beaucoup de philosophie, on passe à travers tout. Je gage que Madame la comtesse sait cela aussi bien que moi...
Chapitre 33
Les oies sauvages s'en allaient. C'était le signe que l'hiver allait s'abattre sans rémission.
Tant qu'elles étaient là, en troupeaux de plus de deux cent mille volatiles, à pâturer au pied du Cap Tourmente, la clémence de l'arrière-saison était assurée et cette année, elle s'était prolongée plus encore.
Près de deux mois, venant de l'Arctique, où elles avaient niché l'été, les grandes oies blanches avaient hanté les « battures » marécageuses qui s'étendaient à l'extrémité de la côte de Beaupré où elles trouvaient, et là seulement, un rhizome particulier, nécessaire à leur survie. Tout l'automne, elles avaient fait retentir les falaises de leurs jacassements animés
Maintenant, et alors que l'on s'imaginait que le beau temps durerait toujours, soudain, elles partaient.
Le nez levé, on les regardait passer au-dessus de la ville, le cou tendu, les ailes battant largement et leurs appels traduisaient une allégresse courageuse, un amour fervent du voyage qui les conduirait d'une traite, sans une halte jusqu'aux Carolines, dans le Sud.
On sentait qu'elles abandonnaient les hommes aux intempéries, le fleuve aux glaces, les terres aux neiges infécondes. Certains en concevaient de la mélancolie. Ils disaient tristement :
– Elles partent ! Elles partent !
Mais quand elle reviendraient, tous s'écrieraient joyeusement :
– Elles arrivent !
Car elles annonçaient le printemps.
*****
Voulant parler d'Élie Kempton et poussée par un peu de curiosité, Angélique avait passé sur la répulsion que lui inspirait la demeure préparée pour Ambroisine et elle s'était rendue au manoir, derrière la colline. Elle avait trouvé son mari dans la cour d'entrée que délimitaient les communs où l'on réunissait chevaux traîneaux et charrettes, où une partie des hommes de la flotte logeaient.
Angélique jeta un regard sur la façade garnie de huit fenêtres au second étage, ce qui, avec les pièces du rez-de-chaussée et celles des combles, annonçait une demeure assez vaste. Joffrey de Peyrac y avait ce qu'il appelait sa chambre de commandement. Dans les salons du bas il avait installé son quartier général pour y décider des ordres du jour, des tâches à répartir entre différentes escouades. Dégréer cinq navires pour les mettre en état de supporter l'hivernage demandait soin et diligence.
Une partie du mobilier du Gouldsboro avait été transportée dans ce manoir, ainsi que des pièces de canon, des armes. Il y régnait, et cela était normal, une activité qui tenait plus de la caserne et du bivouac que de la maison de maître.
– Non, dit Joffrey qui avait suivi le regard d'Angélique, l'ombre d'Ambroisine ne vient pas me hanter en ces murs...
– Que faites-vous tout le jour ? s'informa-t-elle s'avisant qu'elle n'avait guère songé aux tâches qui lui incombaient.
– Comme vous, ma chère, je visite mes amis.
– Votre « allié secret » ?
– Pourquoi pas ?
Elle le regarda, perplexe. Et simultanément une idée l'effleura, qu'elle ne put préciser et qui faillit la mettre sur la piste du mystérieux espion de Joffrey. Elle éprouva la certitude qu'à un moment ou à un autre dans le tourbillon des personnes qu'ils avaient rencontrées elle l'avait vu et reconnu. Mais son intuition avait été trop furtive. Et Joffrey se taisait encore.
– Vous vous méfiez de moi, dit-elle.
Il secoua la tête en riant.
– Un jour viendra. Ne soyez pas jalouse.
Il lui prit le bras et il l'entraîna par les bois légers de bouleaux dépouillés de leurs feuilles qui, mêlés de quelques sapins noirs, mettaient au cœur de la ville haute des îlots de forêts. Ces boqueteaux séparaient différents quartiers qui, au début, avaient été des concessions isolées et maintenant représentaient les abords immédiats de la ville. Québec n'était pas enfermée dans des remparts et aucune frontière ne marquait la limite entre la concentration urbaine et la nature sauvage et encore mal défrichée.

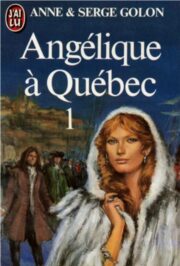
"Angélique à Québec 1" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique à Québec 1". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique à Québec 1" друзьям в соцсетях.