– Venez voir, cria Ville d'Avray en entrant à toute volée dans la cellule, venez voir ces œuvres admirables que le Frère Luc a peintes pour moi...
*****
Dans son atelier le moine était occupé à réaliser le blason de M. de Ville d'Avray. Un grand pan de bois sur lequel étaient ébauchées les lignes d'une composition picturale où l'on devinait la mer, des tritons, des personnages aux vêtements gonflés par le vent, était dressé contre le mur. Le cadre une fois peint serait transporté jusqu'au navire de Ville d'Avray et on le fixerait sous le château arrière à l'emplacement appelé « tutelle » d'où on pourrait l'admirer et l'apercevoir de loin en mer.
– Regardez bien Madame de Peyrac, mon Frère, pria Ville d'Avray en présentant Angélique à l'artiste. J'aimerais que vous donniez les traits de son visage à la figure féminine principale de votre tableau.
– Ah non ! Je vous en prie, se rebella-t-elle. Cela me suffit d'être déjà représentée sur la tutelle du Cœur de Marie. Je sais que vous jalousiez Colin pour la beauté de cette peinture. Si vous aviez pu la lui arracher de son navire et l'emporter sous votre bras, vous l'auriez fait.
– Oh ! Certes, convint Ville d'Avray.
Il renifla à petits coups comme pour dissimuler un sourire, parut réfléchir, et d'un air faussement innocent :
– ... Alors c'est donc bien vous qui étiez représentée sur le Cœur de Marie ? Mes sens ne m'avaient pas trompé. Mais comment cela pouvait-il se faire ? Ce pirate aux robustes épaules, Colin Paturel, vous aurait-il connue jadis, avant de venir se faire capturer à Gouldsboro ? Vous me raconterez, n'est-ce pas ?
« J'emmène Madame de Peyrac, dit-il en s'adressant au comte de Loménie. Vous ne m'en voulez pas, chevalier ? Vous l'avez assez accaparée l'autre jour, aux chutes de Montmorency... Belle promenade, n'est-ce pas ?
Il jubilait en l'aidant à s'installer dans le traîneau.
– ... Plus je vous connais et plus votre vie me semble receler des mystères qui ne font qu'attiser ma passion pour vous. Je voudrais que vous m'apparteniez... Oui, vraiment, c'est le mot exact, que vous m'apparteniez.
– Comme vos tableaux ou vos verreries de Venise ?
– Oui, vous seriez le fantastique et le plus précieux de mes objets d'art... Un automate que j'aurais rapporté d'Allemagne, dirais-je. La plus jolie femme du monde. Il semble qu'elle soit vivante. Elle sourit... quand on a fini de l'admirer on tourne la clef et crac, elle raconte ses secrets...
Il était assommant, mais drôle.
Chapitre 57
Le lendemain, M. de Loménie fit porter à la maison de Ville d'Avray un présent enveloppé de peaux cousues, qui, une fois découpées, révélèrent un petit arc dans son carquois brodé de perles et de pointes de porc-épic, bien garni de flèches, aux empennes de plumes bariolées. Le tout était adressé à demoiselle Honorine de Peyrac.
La réception d'un tel cadeau aussi somptueux qu'inattendu la plongea dans une extase silencieuse.
Elle posa l'arc et le carquois sur un tabouret et resta à les contempler longuement, tandis qu'Eloi Macollet et Piksarett se proposaient pour lui donner des leçons de tir et que Chérubin brûlait d'envie de toucher seulement du doigt ce beau jouet.
On alla jusqu'au carrefour de l'orme où un premier essai eut lieu sous l'œil intéressé des Indiens du campement.
Honorine, grâce à Loménie, possédant une arme contre ses ennemis, se sentit-elle assez forte désormais pour affronter le vaste monde en dehors des murs de sa maison et du cercle familial ?
Toujours est-il que, le jour suivant, la Haute-Ville fut secouée par un événement d'importance.
Accompagnée de sa mère, de ses frères, de ses serviteurs, de ses amis petits et grands, de personnalités en vue telles que M. de Bardagne ou Piksarett, ou plus humbles en la personne rugueuse de Nicaise Heurtebise, ou des Indiens du campement avec leurs chiens jaunes, damoiselle Honorine de Peyrac s'en fut aux ursulines pour y apprendre à lire.
La main dans celle de sa mère, et tenant sous le bras son arc et ses flèches, tout enturbannée de lainages et de fourrures qui ne laissaient voir que ses yeux bridés et son nez rouge, et nantie dès le départ de son imposante escorte, elle quitta la maison par la grand-porte, passa devant celle de Mlle d'Hourredanne, les demeures de la famille Gaubert de La Melloise, de la Dentellière et du bonhomme Loubette, fut saluée par les clients de la forge et ceux de l'auberge du Soleil levant, traversa la place de la Cathédrale après avoir franchi le ruisseau sanglotant sous ses bouillons de glace. Les enfants se rendant à l'école arrivaient de toutes parts dans leurs cabans et leurs capots et leurs bottes sauvages, car il faisait un de ces grands froids mauves et vaporeux.
La rumeur se répandait : Honorine de Peyrac va aux ursulines.
Tout juste si l'on ne sonna pas les cloches.
On parvint en foule au monastère où les dames ursulines attendaient.
Honorine, très droite, abandonna la main d'Angélique et sans daigner jeter un regard en arrière, son arc et ses flèches au poing, elle franchit la porte du cloître et descendit les degrés de pierre qui menaient au premier vestibule.
Accueillie, embrassée, engloutie dans les plis des chapes noires, des lourdes jupes, blanches pour les novices, noires pour les mères, où bruissaient de longs chapelets de buis, elle disparut, s'enfonçant dans les profondeurs du couvent sous les regards protecteurs de l'Incarnation dans son cadre et la double haie des cœurs de Jésus et de Marie couronnés d'épines et percés de poignards.
Déraisonnablement angoissée et le cœur brisé comme si elle n'aurait jamais dû la revoir, Angélique passa sa matinée dans les combles de la maison avec Suzanne et Yolande à guetter de la dernière lucarne la cour de récréation des ursulines. Elle y distingua à l'heure où les enfants viennent s'y ébattre la silhouette de sa fille. Celle-ci se tenait dans un coin, entourée à distance d'un cercle de fillettes. La tourmentait-on ? La repoussait-on ? Suzanne fut envoyée aux nouvelles. On la vit peu après pénétrer avec une Mère dans le jardin, parlementer, repartir. Tout allait pour le mieux, affirma-t-elle en revenant. Honorine régnait déjà sans conteste dans son nouvel univers. Les fillettes lui faisaient des grâces dans l'espoir d'obtenir d'elle de pouvoir tirer à l'arc. Mais elle n'accordait qu'avec parcimonie ses autorisations.
Angélique, le premier déchirement passé, fut soulagée de sentir qu'Honorine était mise sous la protection divine en ce même temps où elle était elle-même sollicitée et tourmentée par diverses choses.
Elle se reprochait de n'avoir pas mieux expliqué à M. de Loménie, lorsqu'elle l'avait vu aux récollets, les dangers qui rôdaient autour d'elle. Elle aurait dû lui raconter l'attentat dont elle avait failli être victime de la part de Martin d'Argenteuil. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas abandonnée. Il aurait voulu revenir à Québec pour veiller sur elle, ne serait-ce que de loin. Mais n'avait-elle pas Piksarett, sanglé dans sa redingote rouge d'officier anglais, ou engoncé dans sa peau d'ours noir, selon les décisions d'une humeur sur laquelle il ne s'expliquait pas, elle le trouvait souvent dans les parages. Parfois bavard, il l'accompagnait ; d'autres fois, il était si discret, si invisible, qu'elle sursautait en le découvrant dans son dos.
Et le chevalier avait raison. C'était surtout en son âme à elle que se trouvaient les pièges.
L'effacement de Loménie-Chambord, son refus de la rencontrer désormais lui fut sensible. Tout en reconnaissant que « c'était bien ainsi », elle avait des rêves troublés. Elle ne se dissimulait pas que – nonobstant les obstacles insurmontables qui les séparaient – elle n'aurait pas trouvé sans charme la reddition de cet homme chaste et doux entre ses bras. Il aurait pu découvrir par elle l'éblouissement de l'amour. Il n'aurait pas été maladroit, seulement hésitant et comme suffoquant sous le poids d'un trop vaste bonheur. N'était-ce pas merveilleux ? Combler de joie ! Où était le péché ?
*****
Quelques jours après la promenade aux chutes de Montmorency, M. Garreau d'Entremont vint la voir. Elle crut un peu sottement qu'il allait lui parler de Martin d'Argenteuil. Mais il n'en était rien. Son flair ne l'avait pas encore averti. Il s'occupait toujours du dossier de Varange. Il voulait la tenir au courant. Il lui dit qu'il était à la recherche du soldat qui avait fait la conjuration sur le crucifix. Il avait une piste. On croyait l'avoir vu dans un fort du côté de la rivière Saint-François. Qu'un soldat fût chargé de la sacrilège besogne ne l'étonnait pas. Les militaires que l'on envoyait aux colonies avaient roulé leur bosse un peu partout. Ils étaient souvent hâbleurs et s'amusaient à mystifier les paysans chez qui on les logeait. Ils étaient surtout malfaisants. La plupart des crimes dont le rapport parvenait sur le bureau de Garreau étaient commis par eux, l'opinion catégorique du Lieutenant de Police sur le militaire de la métropole s'expliquait. La Nouvelle-France ne possédait pas encore de « classe dangereuse ».
En cette période de grands froids où l'on chauffait à mort dans les maisons, Noël Tardieu de La Vaudière continuait à être hanté par la moindre étincelle annonciatrice d'incendie... « Nous y passerons tous ! »... Sans cesse il faisait compter les seaux de cuir, effiler le tranchant des haches, débarrasser les toits pour découvrir si l'échelle était bien là et non pourrie. Chaque jour, les petits Savoyards s'introduisaient dans les cheminées et les gens se plaignaient qu'on les fît geler sur pied, car il fallait, pendant le ramonage, éteindre les foyers de la maison et attendre en claquant du bec dans la rue que les conduits soient refroidis.
« Oui-da ! Le temps d'attraper la mort », grommelaient les habitants.
Les petits Savoyards faisaient bien leur métier. Ces enfants n'étaient pas débiles comme l'avait dit Garreau, mais seulement abrutis. C'étaient des petits Savoyards perdus. On les avait vendus, violés, exploités, emmenés au bout du monde. On leur avait tout pris et jusqu'à leurs marmottes.
On les employa à nettoyer et à décoincer les girouettes, ainsi que les croix et les instruments de la Passion, qui se trouvaient au sommet des clochers qu'ils escaladaient de bon cœur.
*****
Le Carême s'ouvrit, précédé des trois jours du carnaval, et dont l'appellation qui signifiait dans son étymologie latine : carnelevare = ôter la viande, avait perdu de son sens puisque ces trois jours au contraire étaient devenus prétexte à « désordres impies », comme disait l’Évêque et que l'on s'empressait de s'y bâfrer de viande et de charcuterie en vue des quarante jours d'abstinence annoncés.
Le lendemain, mercredi des Cendres, tout Québec s'en revint des églises marqué au front d'un noir stigmate destiné à rappeler à chacun qu'il n'était que poussière et retournerait en poussière.
En Carême, un seul repas était admis par jour, de préférence à midi... Les laitages et les viandes interdits, que restait-il ? Le pain, les poissons, les légumes, les boissons aussi par bonheur. Il se ferait donc une consommation redoublée d'eau-de-vie, de vin d'Espagne, de Ténériffe, Malaga, boissons « réchauffantes » et, sous les toits plus rustiques : de bière, de cidre, de cervoise, ce « bouillon » de pâte fermentée, de bière d'épinette ou de sureau.
Trois jours plus tard, la première querelle du Carême éclata et elle fut d'importance. Elle resterait dans les annales de Québec sous le nom de querelle d'Aquitaine. Elle eut lieu chez M. Haubourg de Longchamp, premier conseiller.
Mme Haubourg de Longchamp était une femme effacée et recevait peu. En revanche, M. Haubourg, qui appartenait à la Compagnie du Saint-Sacrement, aimait profiter de la période de pénitence pour susciter ces réunions de beaux esprits où l'on pouvait discuter théologie, morale, destinée de l'homme ; réunions qui, par la grande culture de la plupart des invités, atteignaient un haut niveau d'intérêt. Les dames y étaient naturellement conviées. Les temps n'étaient plus où une société masculine, encore particulièrement grossière, reconnaissait-on, car soumise au fracas des coups d'estoc et de taille contre les lourdes cuirasses antiques, écartait de son cercle paillard la femme jugée servante, sotte et juste bonne à procréer.
Depuis deux siècles, au moins, les mœurs avaient changé. Les hommes avaient appris, surtout en France, à rechercher la société des femmes pour d'autres plaisirs que ceux de la chair, c'est-à-dire de l'esprit. La Renaissance, sous des rois raffinés tels que François Ier, avait commencé à mettre à l'honneur la femme cultivée et les charmes de son esprit.

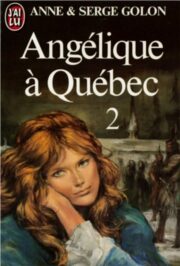
"Angélique à Québec 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique à Québec 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique à Québec 2" друзьям в соцсетях.