De même, il n'était jamais arrivé de voir déléguer, pour l'escorte du courrier royal et administratif, un officier appartenant à cette glorieuse création de Louis XIV qui y apportait toute son attention, appelée « La Maison du Roi », effroi de l'Europe sur les champs de bataille. Et l'on sut qu'il s'agissait d'un officier choisi parmi l'une des trois compagnies françaises des gardes du corps, servant les plus proches de la personne du Roi, accompagné de deux « anspessades4 » à hallebardes courtes et d'une douzaine de leurs subalternes.
C'était autre chose que la canaille militaire, composée de recrues ramassées ivres mortes dans les cabarets, qu'on leur envoyait communément à titre de soldats.
Ces hommes étaient des hommes qui, chaque jour, voyaient passer Sa Majesté, entendaient sa voix, observaient ses gestes et son habillement, car de se tenir muets et raides comme des piquets, les gardes du corps, cela ne les empêchait pas d'avoir des yeux.
Les Québécois s'arrêtaient et faisaient cercle pour admirer les uniformes.
Fallait-il croire que le Roi commençait à s'intéresser à sa colonie lointaine pour lui envoyer tout ce beau monde ?
Angélique n'était pas plus enchantée que le secrétaire de Frontenac de ce M. de La Vandrie. Que fallait-il croire ? Son comportement proche de la goujaterie, envers une femme, était-il inconscient ou intentionnel ? Que savait-il ou soupçonnait-il qui le rendait muet et gourmé en face d'elle ? Peut-être rien ? Peut-être plus ? Il était évident que tous ces bonshommes, chargés de missives ultra-secrètes, qui décidaient, tranchaient le sort, élevaient ou abaissaient ceux auxquels elles étaient destinées, en connaissaient peu ou prou le contenu.
Ainsi Bardagne ne fut pas long à apprendre que sa lettre maladroite expédiée en novembre par le Maribelle avait porté ses fruits amers. Un jeune fonctionnaire attaché au cabinet de Monsieur Colbert, qui avait demandé qu'on le lui envoyât et qu'il retrouva à un coin de rue alors qu'il allait monter dans un carrosse pour gagner le palais de l'intendant, n'attendit pas qu'ils fussent en présence dans un endroit plus digne et plus confortable pour lui faire comprendre sa disgrâce. M. de Bardagne s'étant nommé, l'autre l'avertit aussitôt qu'il était démis de ses fonctions, lui montra les papiers qui attestaient de ce verdict, lui signifia qu'il n'avait plus à se mêler de rien. Il lui parlait de ce ton mi-dédaigneux, mi de pitié qu'inspirent les pestiférés du pouvoir, ceux qui, abandonnés de la chance, se révèlent coupables d'avoir misé sur la mauvaise carte. Il lui signifia qu'une partie de son voyage de retour serait retenue sur sa cassette personnelle.
– Je m'en moque, répondit Bardagne.
L'autre eut un sourire pincé.
– Oh ! Monsieur, est-ce bien politique de votre part de vous montrer méprisant des bontés de Sa Majesté alors que vous auriez pu revenir à fond de cale ou même aux fers ? Je comprends à votre réflexion ces rigueurs envers vous dont je ne m'expliquais pas toutes les raisons. Sachez que j'ai reçu ordre de recueillir des renseignements sur votre conduite comme envoyé du Roi en Nouvelle-France. Ce que j'en dirai peut alourdir ou alléger par la suite votre dossier. Et à peine ai-je abordé à Québec que déjà l'on m'informe que vous fréquentiez quotidiennement, presque jour et nuit, une maison mal famée.
– Une maison mal famée ? répéta Bardagne ahuri.
– Le Navire de France, fit le fonctionnaire après avoir jeté un coup d'œil sur un papier.
– Mais, Monsieur, s'écria Bardagne, je me rendais là parce que j'y rencontrais mes amis.
– Parfait ! Je ne vous le fais pas dire, ricana l'autre.
Nicolas de Bardagne ouvrit la bouche pour se défendre. Mais sur le point d'expliquer comment l'amitié en laquelle la noble dame de Peyrac tenait la tenancière du lieu, ainsi que divers incidents arrivés en cours d'année, dont l'accident du marquis de Ville d'Avray, avaient entraîné l'exode d'une partie de la société la plus aristocratique de la Haute-Ville, en cette auberge dite « mal famée » de la Basse-Ville, et qu'on y avait vu fréquenter tout au long de l'hiver de grands noms et des meilleurs jusqu'au Lieutenant de Police : M. Garreau d'Entremont, il se retint. Il haussa furieusement les épaules. Comment faire comprendre à ce jocrisse, à ce blanc-bec pâle encore de son mal de mer et qui entrait dans la carrière en s'imaginant qu'il allait mieux servir le Roi que tous les autres avant lui, comment lui faire apprécier de quelle façon circulait le sang de Québec de la Basse-Ville à la Haute-Ville et de la Haute-Ville à la Basse-Ville, durant l'interminable saison des glaces. Comment lui rendre accessible ce qui pouvait se vivre dans ce réceptacle d'effervescence qu'était le Navire de France, les querelles des Acadiens, les yeux verts d'Angélique de l'autre côté de la table à travers la fumée des pipes, Janine Gonfarel tournant ses soupes, le marquis de Ville d'Avray et le bel Alexandre...
C'était indescriptible et inexplicable. Et ce prétentieux n'était pas digne qu'il lui en suggérât seulement l'idée.
Il puait les officines des grands commis, les Le Tellier, Colbert et compagnie, le bras robin du Roi. Il suait les relents de leurs intrigues soucieuses, de leurs calculs pointilleux et acrobatiques, leur suffisance de bourgeois laborieux à l'odeur d'encre, au bruit de plumes grinçantes. Qu'il se fût déjà informé de ces mœurs prouvait son caractère fouinard. Il avait dû prendre ses renseignements auprès de l'« espion du Roi » qui, par les résultats révélés, était sans doute un de ces dévots rancis du Saint-Sacrement, avides de ronger par la base la réputation de leurs semblables.
Au cours de sa carrière, Nicolas de Bardagne avait appris qu'il ne fallait pas se préoccuper outre mesure de ces ragots de sacristie, des espions.
Il prit la mesure de son adversaire et le jugea piètre. Il n'en était, c'était visible, qu'à sa première suppléance : il se gonflait, accoutumé à asseoir son importance sur celle d'appuis aujourd'hui fort lointains. Il pourrait, si on le malmenait, protester :
– Je vais en référer à Monsieur Colbert.
Ce ne serait pas demain.
– Monsieur, peu m'importent les décisions que vous m'apportez, dit Bardagne en fourrant les documents dans la poche de son habit. C'est votre conduite qui m'importe. Vous manquez de tact et de prudence en oubliant que vous venez de traverser l'océan et que vous vous trouvez fort loin de vos protecteurs. Et je doute que vous ayez dans ce sac que vous tenez là, des mandats vous assurant l'accueil sans réserve des « principaux » de ce pays. On ne vous a chargé que de quelques petites besognes sans éclat comme de signifier sa disgrâce à un homme tel que moi qui ne l'ignorais pas, infortune que vous ne manquerez pas de connaître un jour à votre tour, car ce mouvement d'aller et de retour est aussi régulier que celui des marées, pour qui sert le Pouvoir. Je vous aurais apprécié si vous aviez su attendre d'être revenu sur vos rivages pour me manifester votre mépris. Vous avez beaucoup à apprendre. Et vous allez commencer par juger de l'influence en Nouvelle-France d'un homme qui a su s'y faire des amitiés. Non seulement ne comptez pas sur moi pour vous accueillir et veiller à votre confort, mais sachez que je m'arrangerai pour que vous ne trouviez ici ni feu ni lieu !
Il le quitta sans prendre congé et entama la remontée de la côte de la Montagne. Il allait commencer par aller parler à Mlle d'Hourredanne qui ferait comprendre à Carlon qu'il n'avait pas à recevoir ce jean-foutre de mince importance, même dans ses communs : À la rue, le fonctionnaire du Roi !
De temps à autre dans son ascension, Nicolas de Bardagne s'arrêtait et se retournait, contemplant comme il se doit l'horizon.
Il se calmait.
L'été arrivait, plein de vols d'oiseaux, de gibier dans les forêts, de poissons dans les rivières.
Il se mit à penser à sa gentilhommière du Berry, où la vie serait plus douce, plus mesurée. Ses beaux livres, d'aimables voisinages, un lieu pour y rêver, pour méditer, se souvenir des douleurs et des espoirs, des joies illusoires et des joies ineffables. Il se disait :
« Adieu ! Adieu, ma belle servante ! Adieu, mon amour ! Adieu, Québec !... »
Jusqu'à lui montait la rumeur de la foule qui s'agglutinait en bas sur les rives.
Et seul dans la montée vers la Haute-Ville, il ne pouvait retenir ses larmes.
Chapitre 91
Fort avant dans la nuit les gens du Gouldsboro groupés autour d'Angélique discutèrent dans la petite maison.
Angélique commentait l'attitude que M. de La Vandrie avait eue en l'apercevant et elle y cherchait des raisons d'espérer. Il ne s'était pas montré aimable, empressé, mais il s'était montré courtois, respectueux. D'où on pouvait déduire que le Roi n'avait pas laissé retomber son sceptre sur leurs têtes de façon péremptoire. En attendant, on parlait dans le vide.
La grosse enveloppe était là, dans Québec, aux mains de Jean Carlon, lourde d'une décision que seule pouvait leur signifier la voix de Frontenac.
Quels seraient les ordres qui les attendaient ? Sévérité du Roi ? Clémence du Roi ?
En tout état de cause, ils s'arrêtèrent au projet d'envoyer un homme au-devant de M. de Peyrac pour l'avertir de l'arrivée des navires et d'une réponse du Roi statuant sur son sort.
Angélique, ayant pris un court repos, fut réveillée par des appels. On avait signalé que les premiers canots de l'armée ramenant M. de Frontenac se montraient sous Québec.
Au port, la presse était encore pire que la veille. Les nouveaux arrivants parlaient d'Iroquois, de guerre et de « pawas5 ». Ils sentaient la forêt et la graisse d'ours car, au bord des rivières, il fallait déjà commencer à se défendre contre les maringouins. Les gens de Québec, eux, n'avaient en tête que les nouvelles de France et les Iroquois étaient oubliés.
– A-t-on vu Monsieur de Peyrac ?
Personne ne pouvait lui répondre. Tout ce qu'on savait c'est qu'il n'avait pas débarqué avec M. de Frontenac. Car M. de Frontenac était déjà là-haut, au château Saint-Louis, à ouvrir les missives de France.
Angélique fut saisie de panique. Redoutant un peu la minute précédente de se trouver en face de son mari, la pensée qu'il ne faisait pas partie de ce convoi, qu'il ait pu prolonger sa rencontre avec Outtaké pour le plaisir de palabrer ou, ce qui était pis, qu'il lui ait pris l'idée, se trouvant au quart du chemin, de descendre jusqu'à Wapassou, lui causa une déception cruelle. Elle était proche du désespoir. Elle voulait le voir, seulement le voir. Le reste lui était égal. Tant pis pour la réponse du Roi et ce qui s'était passé récemment entre eux ou il y avait des siècles. Elle voulait le revoir. Sans lui la vie n'était plus la même et rien de ce qui arrivait, aussi agréable et incomparable que ce soit, ne valait la peine sans lui.
Suivie de son escorte, elle remonta jusqu'à la Haute-Ville et se rendit directement au château Saint-Louis, et dès l'entrée, elle tomba sur Frontenac qui se précipita vers elle, illuminé, les bras levés.
– Ah ! Ma chère, chère amie ! Vous arrivez à point nommé !... Ah ! Comment vous dire ma joie... Ce jour est le plus beau de ma vie.
D'une main, il pressait les deux siennes à les lui broyer, de l'autre il brandissait une liasse de parchemins.
Il n'avait pas attendu d'être débotté et de s'être rafraîchi pour faire sauter les cachets du courrier royal et ainsi, le teint brûlé par le soleil, suant et rayonnant sous sa perruque tant soit peu de travers, il manifestait une exubérance et une jubilation juvéniles.
– Le Roi ! répétait-il, le Roi...
– Eh bien ?
– Il me couvre de lauriers... Ah ! Enfin ! Pour une fois ! C'est plus que je n'en pouvais espérer ! Croyez-moi si vous le voulez. Dans une lettre dont chaque terme me touche, Sa Majesté me répète qu'elle n'a eu de longtemps un serviteur aussi dévoué que moi et qui sache aussi bien, malgré la distance et le peu d'avis dont je puis disposer, étant loin du soleil, pour soutenir mon jugement, deviner en quelle direction orienter ma politique. Lui, mon souverain, afin de lui être le plus agréable possible. J'ai dû relire deux fois sa lettre pour y croire. Ouf ! Quel soulagement. J'avoue que, jusqu'au dernier moment, je tremblais, ne pouvant décider si je me ferais sacquer ou non pour l'initiative que j'avais prise d'accueillir mon ami le comte de Peyrac.
Il s'interrompit et parut la découvrir.
– ... Vous êtes ici ! C'est bien ! Je n'aurai pas besoin de vous faire chercher. Quelques membres du Grand Conseil, dont Monsieur l'Intendant, m'attendaient pour m'accueillir au château Saint-Louis. J'ai fait convoquer les autres. Ils sont tous là. Je veux donner lecture aussitôt de la lettre du Roi... Non, pas celle dont je viens de vous parler à mon sujet... Celle qui concerne Monsieur de Peyrac... Je lirai la mienne après, bien entendu. Mais il est stipulé que tout ce qui a trait aux décisions prises par le Roi vis-à-vis de mon cher ami Peyrac doit être lu en présence du Conseil. On n'attend plus que le comte votre époux. Ah ! Le voici !

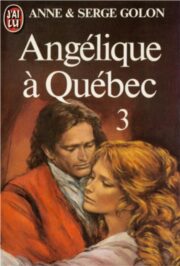
"Angélique à Québec 3" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique à Québec 3". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique à Québec 3" друзьям в соцсетях.