Il voulait qu'elle comprenne qu'il n'était lui-même qu'un policier avançant dans les souterrains fangeux du crime où sa vie et ses plans étaient sans cesse remis en question, qu'il était menacé aussi bien par les rapières des truands qu'il pourchassait, que par le poison des sorcières qu'il débusquait, et dans la meilleure perspective, par la disgrâce et l'éloignement obtenus à force d'intrigues des grands qu'il commençait à inquiéter.
En somme, il voulait lui faire entendre qu'il pourrait encore moins la défendre qu'autrefois. Il était dans une position trop fragile. Trop surveillé et trop fort et trop redouté. Et pourrait-il se permettre seulement devant le Roi ce clin d'œil de l'amitié ancienne ? Ou une brève rencontre au coin d'une rue obscure, le manteau couleur de muraille sur le visage, elle masquée, pour se dire :
– Salut, Marquise des Anges !...
– Salut, grimaud du diable...
Fini tout cela... Il approchait des « intouchables ». Il allait prendre dans ses rets la déesse de l'Olympe, Athénaïs...
Quant à Angélique, elle ne se faisait pas d'illusions. Le Roi ne renoncerait pas à sa conquête. Les premières joies et griseries du retour passées, les escarmouches recommenceraient. Le Roi saurait vite qu'il n'était pas aimé comme il rêvait de l'être. La souffrance l'aigrirait. La jalousie, l'envie envers son rival, toujours détesté : Joffrey de Peyrac.
Et tout recommencerait.
Et il serait trop tard pour courir vers les rivages et tendre les bras vers la mer en suppliant tout bas :
« Emmène-moi ! Emmène-moi ! »
Ce n'était pas la peine d'avoir tant souffert pour gagner la liberté.
Quand elle cessa de dialoguer en pensée avec le policier Desgrez et que, relevant les yeux, elle s'évada en même temps de la maison du pont Notre-Dame et des ruelles ténébreuses de Paris où résonnaient l'écho des lames entrechoquées et les cris d'agonie ; quand elle cessa de voir couler la Seine « verte et murmurante » et de respirer les émanations de sa vase nauséabonde, à l'odeur du péché des hommes, elle vit que l'intendant Molines était parti. Il avait annoncé qu'il allait visiter le Gouverneur.
*****
La tablée de midi semblait nombreuse et animée. À part les enfants, elle ne remarqua personne de ceux qui y avaient pris place.
Malgré les instances de Suzanne, elle ne put avaler une bouchée, ce qui lui prouva qu'elle avait profondément changé, car autrefois les émotions lui donnaient faim. Elle monta jusqu'à sa chambre, s'assit devant sa petite table et écrivit.
Mon amour, il faut que je vous parle, il faut que je vous voie. Je ne sais plus que faire. Où vous irez, j'irai. Où vous demeurerez, je demeurerai. Vous êtes mon seul amour...
Puis elle déchira la missive en craignant que Joffrey ne la jugeât aussi folle que sibylline. Elle griffonna un autre mot à son adresse : « Pouvez-vous me recevoir dans l'après-midi ? » qu'elle fit porter au château de Montigny.
Peu après Kouassi-Bâ se présenta avec un pli cacheté contenant la réponse du comte où celui-ci, en termes volontairement solennels, avertissait la comtesse de Peyrac qu'il la recevrait volontiers en son manoir de Montigny en fin d'après-midi, entre la fin des vêpres et le début du salut, soit de 5 heures à 6 heures.
Il affectait de répondre sur le même ton gourmé qu'elle avait adopté.
« Il plaisante, se dit-elle en froissant le papier. S'il savait à quel point tout cela est grave... Je ne vois pas d'issue. »
Reprenant le message, elle y posa ses lèvres.
« Je l'adore ! »
Elle n'aurait pas voulu peser sur sa vie, ni se montrer désemparée au moment où, fort et vainqueur après une lutte tenace et longue, il touchait enfin au but. Elle aurait voulu se taire, revenir aux premières illusions de la veille. Mais la visite de Molines l'obligeait à regarder en face la réalité d'un avenir qu'elle ne percevait que trop clairement entre les chausse-trappes de l'acceptation et les conséquences désastreuses du refus.
Un bruit ténu au-dehors lui fit lever les yeux. Il pleuvait malgré le soleil et, à travers la dentelle verte des feuillages, les jeux du prisme étaient de nacre et de perles.
Angélique attendit l'heure du rendez-vous en retournant entre ses doigts une monnaie d'or très ancienne du règne de Bêla III de Hongrie qu'elle avait retrouvée au tond de la cassette aux trésors. La pièce lui avait été donnée par le prince rebelle Ragosci, celui qui un jour lui avait dit :
« Vous avez la tête de l'archange vengeur incorruptible, celui qui tient le glaive de la justice et tranche les liens visqueux des compromissions. Votre regard transperce. Les êtres se sentent nus devant vous. Il n'y aura pas de prison trop profonde pour éteindre cette lumière-là. Prenez garde ! »
On frappa à la porte et c'était Bérengère, sanglotante.
– Ne ruinez pas nos vies !
– Mais... l'idée ne m'en a jamais effleurée.
– Vous le pouvez maintenant. Le comte de Peyrac et vous avez tous pouvoirs désormais.
– Qui vous l'a dit ?
– Le bruit s'en répand.
– On exagère. Il s'affirme seulement que la politique de Monsieur de Frontenac a été approuvée par le Roi et qu'il désire nous voir à Versailles.
– On raconte beaucoup plus que cela, murmura Bérengère.
Elle secoua la tête, répondant à des réflexions personnelles qu'elle avait dû ressasser dans l'amertume.
– J'avais raison de savoir que cet homme triompherait, le comte de Peyrac. J'ai l'intuition de ces choses-là Ah, que je le déteste !
– Pourquoi ?
– Il m'a dédaignée.
– Ce n'est pas faute pourtant d'avoir ménagé vos efforts.
– Il m'a fait vraiment souffrir par son indifférence.
– Vous ne voudriez pas que je vous en plaigne ?
– Vous seule comptiez pour lui.
– Devrais-je le regretter ?
Percevant enfin la nuance ironique, Bérengère leva les yeux au-dessus de son mouchoir.
– C'est étrange ! fit-elle. Mais vous êtes tous deux si remarquables qu'on éprouve de la difficulté à vous considérer comme mari et femme... Vous êtes liés, mais par d'autres liens que celui du contrat conjugal. On vous sent complices, amis, amants. C'est différent. C'est autre chose. Sans cesse, j'oubliais qu'il était votre époux.
– J'aurais souhaité que vous vous en souveniez plus souvent. Votre jeu parfois m'a déplu.
– Était-ce un jeu ? Ou bien alors c'est que je m'y suis laissé prendre presque aussitôt. J'imaginais mal qu'il puisse exister un homme tel que lui, un vrai homme. Je me suis conduite comme une péronnelle éblouie, mais il m'a quand même parlé, n'est-ce pas ? Et quand il me parlait, il s'adressait à moi ? Et il me voyait ?
– N'en doutez pas ! C'est un galant homme.
– Alors, j'aurai eu cela, dit la jeune femme tristement. Mais j'étais folle. J'aurais dû comprendre que près de vous je n'avais aucune chance. En toute circonstance, vous demeurez éclatante et belle. Moi, dans six ans j'aurai l'air d'un pruneau sec. Le froid m'est nuisible...
– Moins que de vous tourmenter de l'aspect que vous aurez dans six ans.
– J'ai vingt-huit ans. C'est tard si l'on n'est pas encore parvenu à faire parler de soi pour espérer un jour briller. Et pourtant, j'aurais tellement voulu connaître, ne serait-ce que pour un temps, la souveraineté de la célébrité. Avancer sous le feu des regards qui vous font exister. L'admiration, la jalousie, l'envie, la haine peut-être, mais n'est-ce pas délicieux ces désirs qui crépitent autour de vous comme un feu, et qui vous apprennent que vous êtes belle, vivante, riche, toute cette gloire autour de votre personne, unique ? Et que vous avez connue vous, cela se sent, et c'est pourquoi vous séduirez toujours. N'avons-nous pas besoin, nous autres femmes, de connaître cela, au moins une fois dans notre vie ?
– Oui, vous avez raison.
Bérengère renifla, étonnée.
– J'ai raison ?
– Mais oui, ma chère enfant.
– Oh ! Ne faites pas votre duègne. Cela ne vous va pas du tout. Vous qui dominez le monde vous pouvez vous permettre de mépriser ces rêves qui me sont inaccessibles.
– Vous n'avez déjà pas mal joué votre partie et je vous approuve de vouloir poursuivre ce chemin. Toute femme, en effet, a besoin d'y réussir un jour. Mais, en ce qui concerne les hommes, je voudrais vous faire une remarque. On s'étonne de vous voir envieuse, car vous avez un époux jeune, beau, bien fait... assidu à faire carrière.
– Il est assommant.
– Pas autant que vous ne voulez vous en persuader afin de vous donner bonne conscience... Il est même, lui aussi... très distrayant à sa façon... Il plairait en haut lieu. Pourquoi ne brigueriez-vous pas tous deux des charges qui vous feraient graviter dans les parages du trône ? Les gens industrieux y sont bienvenus... et les jolies femmes aussi.
– Il faut de la fortune.
– On m'a dit que vos parents étaient morts. N'allez-vous pas toucher votre part d'héritage ?
Bérengère-Aimée sécha ses larmes et commença de réfléchir à la question.
– Vous nous recommanderiez ?
– Dans la mesure de notre influence. Mais n'y comptez pas trop. Faites confiance plutôt à vos charmes et à vos ambitions. Vous avez de la naissance et vous plairez sans y tâcher. Cependant je pourrai vous donner une lettre pour une ancienne amie : Madame de Maintenon, qui est la gouvernante des jeunes princes du sang.
– Vous feriez cela pour moi ?
– Oui ! Et maintenant cessez de penser à moi, à ce que je suis et à ce que vous n'êtes pas. Avertissez votre mari et préparez vos bagages. Et n'oubliez pas : c'est à la porte de Madame de Maintenon qu'il faut frapper.
Chapitre 97
La pluie traversée de soleil tombait encore lorsqu'elle atteignit le manoir de Montigny.
En pénétrant dans l'appartement de Joffrey, elle rabattit en arrière la large capuche de sa mante et ses cheveux perlés d'humidité, ses joues mouillées accentuaient l'effet de fraîcheur et de vivacité qui émanait de sa personne.
Sans savoir pourquoi, cela lui parut incroyable de trouver là Joffrey de Peyrac qui l'attendait.
– Ah ! Qu'il me tardait de vous voir, s'écria-t-elle. J'ai compté les minutes qui me séparaient de ce rendez-vous.
– Et pourquoi ne pas l'avoir devancé ?
– Je vous sais très occupé et requis par mille tâches maintenant que...
– Quelle retenue soudaine vous saisit ?
– Je voulais être certaine de vous trouver...
– Voilà qui est nouveau ! Vous ne vous êtes jamais embarrassée que je sache auparavant de me chercher à travers la ville et de me trouver où que je fusse, dès l'instant où vous le souhaitiez...
– Je voulais aussi être assurée que vous disposiez d'une heure à m'accorder.
– Que signifie ce langage ? Suis-je devenu pour vous un ministre dans l'antichambre duquel vous devez prendre rang ? Dieu merci ! Nous n'en sommes pas encore là.
Angélique se mit à rire.
– Oui, Dieu merci ! Nous ne sommes pas encore à Versailles.
Et son regard se remplit de sa vue. Dieu merci ! Il était encore à elle. Elle pouvait encore le préserver, le retenir.
La lumière tendre du soleil qui entrait à flots par la fenêtre, tamisée par les feuillages, ajoutait une douceur à l'aménité de son brun visage, à la gaieté mordante de son chaud regard.
Dans ce halo rayonnant, elle l'imagina, comme dans la vision qui la hantait depuis le matin, lorsqu'il se tiendrait debout devant le roi, parmi l'étincellement des miroirs, des ors et des marbres de ce palais édifié pour la gloire de Louis XIV et sous les yeux de cette Cour imbécile.
D'un élan elle courut à lui, l'entourant de ses bras.
– Oh ! Mon chéri ! Mon chéri ! Non, jamais ! Cela est impossible ! Mon amour !
Elle enfouit son visage dans les plis de son vêtement, et elle l'étreignit comme si elle se fût cramponnée au seul pilier inébranlable qui demeurât solide alors que la terre tremblait, le seul arbre indéracinable dans la tempête, la seule bouée dans la mer démontée. Elle se réfugiait contre son cœur, dans l'obscurité du bien-être et la tiède et familière odeur qui émanait de lui, son parfum d'homme qui le décrivait de façon si subtile mais impérieuse aussi, vivant, et elle en était grisée comme du plus capiteux des parfums d'Orient qui troublent l'esprit et les sens. C'était tout le charme de leur vie commune, des étreintes merveilleuses et des bonheurs et des douleurs qu'elle avait connus par lui qu'elle respirait dans ses bras et qui l'étourdissaient et la faisaient défaillir, annihilaient sa pensée.

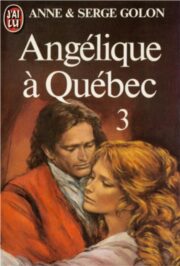
"Angélique à Québec 3" отзывы
Отзывы читателей о книге "Angélique à Québec 3". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Angélique à Québec 3" друзьям в соцсетях.