A suivi une éducation bourgeoise, toute de raideur et de tradition. Bonjour madame, au revoir monsieur. Manières impeccables, résultats scolaires excellents, la messe tous les dimanches à Saint-Pierre-de-Chaillot. Avec prière de garder ses émotions pour soi. Interdiction aux enfants de s’exprimer. Ne jamais parler de politique, de sexe, de religion, d’argent ou d’amour. Ne jamais prononcer le nom de notre mère, ne jamais évoquer sa mort.
Notre demi-sœur, Joséphine, est née en 1982. Elle est vite devenue la préférée de notre père. Il y avait quinze ans de différence entre Mélanie et elle. À la naissance de Joséphine, j’avais tout juste la majorité. Je partageais un appartement avec un couple d’amis sur la rive gauche et étudiais à Sciences-Po. J’avais quitté l’avenue Kléber qui, depuis la mort de Clarisse, ne pouvait plus porter, pour moi, le nom de maison.
Le lendemain matin, je suis affreusement raide à mon réveil. Ce lit d’hôpital fatigué est la chose la plus inconfortable sur laquelle il m’ait été donné de dormir. Ai-je même dormi ? Je pense à ma sœur. Comment va-t-elle ? S’en remettra-t-elle ? Dans la chambre nue, je cherche ma valise et mon ordinateur portable, rangé dans sa sacoche. Ces deux objets ont survécu à l’accident. J’ai testé mon ordinateur avant de me mettre au lit hier soir, il s’est allumé comme si de rien n’était. À peine croyable. J’ai vu l’état de la voiture. Pire encore, j’étais dans cette voiture. Et de cette voiture qui n’est plus qu’une épave, moi et mon portable sommes ressortis comme des fleurs.
L’infirmière que je vois arriver n’est pas celle de la veille. Elle est plus ronde et son visage a de jolies fossettes.
— Vous pouvez aller voir votre sœur, m’annonce-t-elle avec un grand sourire.
Je la suis dans les couloirs, nous croisons des vieux à moitié endormis qui traînent la patte, puis nous prenons un escalier jusqu’à l’étage où Mélanie est étendue sur un lit, harnachée à un tas d’appareils compliqués. Sa poitrine est entièrement plâtrée, des épaules à la taille. Seul son cou dépasse, long et fin. Elle ressemble à une girafe.
Elle est réveillée. Ses yeux verts sont cerclés de grands cernes noirs, sa peau est extrêmement pâle. Je ne l’ai jamais vue si pâle. Elle a l’air différente, je ne saurais dire pourquoi ou comment.
— Tonio, murmure-t-elle dans un souffle.
Je veux être fort, jouer au grand frère costaud, mais la voir ainsi me fait monter les larmes. Je n’ose pas la toucher, j’ai peur de lui casser quelque chose. Je m’assois maladroitement sur la chaise installée près de son lit. Je me sens gauche.
— Tu vas bien ? articule-t-elle tant bien que mal.
— Je vais bien. Et toi, comment te sens-tu ?
— Je ne peux pas bouger. Ce truc me gratte à un point…
Des questions me traversent furtivement : pourra-t-elle bouger un jour ? Le docteur Besson m’a-t-elle dit toute la vérité ?
— Tu as mal ? demandé-je.
Elle secoue la tête.
— Je me sens bizarre. – Sa voix est basse et faible. – Comme si je ne savais plus qui j’étais.
Je lui caresse la main.
— Antoine. Où sommes-nous ?
— Près de Nantes. On a eu un accident sur l’autoroute.
— Un accident ?
Elle ne se souvient de rien. Je décide de ne pas lui rafraîchir la mémoire. Pas pour l’instant. Je prétends être perdu moi aussi. Cela semble l’apaiser et elle me rend ma caresse. Puis je lui dis :
— Il arrive.
Elle comprend tout de suite de qui je parle. Elle soupire et détourne la tête. Je ne la quitte pas des yeux, tel un ange gardien. Je n’ai pas regardé une femme dormir depuis Astrid. Je pouvais la regarder des heures, jamais lassé de contempler son visage paisible, le frémissement de ses lèvres, sa peau de nacre et le soulèvement léger de sa poitrine. Dans son sommeil, elle avait l’air si jeune et si fragile, comme Margaux à présent. Je n’ai pas regardé Astrid dormir depuis le dernier été que nous avons passé ensemble.
L’été où notre mariage s’est brisé, Astrid et moi avions loué une maison carrée et blanche sur l’île grecque de Naxos. Nous avions déjà décidé de nous séparer en juin (enfin, Astrid avait décidé de me quitter pour Serge…), mais nous n’avions pas pu annuler nos billets d’avion et de bateau. Alors nous étions partis malgré tout, pour ce qui fut l’épreuve finale d’un mariage déjà défunt. Nous n’avions encore rien annoncé aux enfants et jouions la comédie des parents normaux. Nous affections un air si faussement enthousiaste que les enfants s’étaient doutés de quelque chose.
Pendant les trois semaines que dura ce supplice, j’ai eu envie de me tirer une balle dans la tête. Astrid passait son temps à lire sur le toit en terrasse, dans le plus simple appareil, et obtint rapidement un intense bronzage chocolat qui me rendait malade parce que je savais que bientôt Serge y promènerait ses grosses mains. Moi, je restais assis sur la terrasse du bas qui surplombait Orkhos et Plaka. La vue était splendide et je la contemplais dans une demi-ivresse, due à l’alcool autant qu’à ma profonde tristesse. La tache brune de l’île de Paros semblait à quelques brasses, la mer resplendissait d’un bleu ultramarine, moucheté d’éclats blancs et mousseux dessinés par un vent violent. Quand je me sentais trop désespéré ou trop soûl, ou les deux, je titubais sur le chemin abrupt et poussiéreux menant à une crique et me jetais, littéralement, dans l’eau. Un jour, une méduse m’a piqué, mais j’étais si perdu que je l’ai à peine sentie. C’est Arno qui a remarqué plus tard une méchante zébrure rouge sur ma poitrine, comme si l’on m’avait fouetté.
Un été en enfer. Pour ajouter encore à mon inconfort psychologique, la sérénité de nos petits matins était gâchée par le bruit exaspérant de bulldozers et de marteaux-piqueurs qui sévissaient un peu plus haut sur la colline où un Italien assouvissait sa folie des grandeurs en bâtissant une villa tout droit sortie d’un film de James Bond. C’était, sur l’étroit chemin qui longeait notre maison, un va-et-vient incessant de camions déblayant des débris ou de la terre. Je restais affalé, inerte, sur la terrasse à respirer la fumée de leurs pots d’échappement. Les chauffeurs étaient sympathiques et me saluaient à chaque passage, tandis que leurs moteurs monstrueux grondaient à quelques mètres de mon petit déjeuner. Que je n’arrivais pas à avaler.
Pour couronner le tout, il fallait veiller à ne pas gaspiller l’eau de la citerne, il y avait des coupures d’électricité tous les soirs, les moustiques étaient de véritables vampires des Carpathes et Arno avait brisé les toilettes high-tech, tout en marbre et suspendues, simplement en s’asseyant dessus. Chaque nuit, je partageais le lit de celle qui serait bientôt mon ex-femme, je la contemplais dans son sommeil et pleurais sans bruit. Elle ne cessait de me chuchoter, comme une mère patiente avec un enfant récalcitrant : « Antoine, c’est juste que je ne t’aime plus comme avant », puis elle me prenait très maternellement dans ses bras alors que moi, je frissonnais de désir pour elle.
Comment cela est-il possible ? Comment une chose pareille arrive-t-elle ? Comment un homme peut-il surmonter une telle épreuve ?
J’avais présenté Astrid à Mélanie, dix-huit ans auparavant. Astrid était attachée de presse dans une maison concurrente de la sienne. Elles étaient vite devenues bonnes amies. Je me souviens qu’elles offraient un contraste intéressant : Mélanie, petite, délicate, brune, et Astrid, blonde, les yeux bleu pâle. La mère d’Astrid, Bibi, est suédoise, originaire d’Uppsala, décontractée et artiste, et pour tout dire, totalement excentrique. Mais charmante. Le père d’Astrid, Jean-Luc, est un nutritionniste célèbre, un de ces types bronzés, à la minceur insultante, dont la seule présence vous rabaisse à l’état de loque confite de cholestérol. Obsédé par son transit intestinal, il saupoudre des fibres sur à peu près tout ce que Bibi cuisine.
Penser à Astrid me donne envie de l’appeler pour raconter ce qui est arrivé. Je sors de la chambre sur la pointe des pieds. Astrid ne décroche pas. Ma paranoïa rampante me suggère de masquer mon numéro. Je laisse un bref message. Neuf heures. Elle doit être en voiture, dans notre vieille Audi. Je connais son emploi du temps par cœur. Elle a déjà déposé Lucas à l’école, et Arno et Margaux à Port-Royal, où se trouve leur lycée. Elle se débat probablement dans les embouteillages matinaux pour atteindre Saint-Germain-des-Prés, son bureau de la rue Bonaparte, juste en face de l’église Saint-Sulpice. Elle se maquille, en se regardant dans le rétroviseur, à chaque fois qu’elle est arrêtée à un feu rouge, et les hommes des voitures voisines reluquent cette bien belle femme. Mais je suis idiot. Nous sommes mi-août. Elle est encore en vacances.
Avec lui. Ou déjà rentrée à Malakoff, avec les enfants, après une longue route depuis la Dordogne.
Quand je retourne dans la chambre de Mélanie, un vieil homme bedonnant se tient devant la porte. Il me faut quelques secondes pour comprendre que c’est lui.
Il me prend brutalement dans ses bras. Les rudes embrassades de mon père me surprennent toujours. Je n’embrasse jamais mon fils de cette manière. De toute façon, Arno arrive à l’âge où l’on déteste être pris dans les bras, mais s’il m’arrive de m’y risquer, c’est avec douceur.
Il recule d’un pas et me regarde de biais. Des yeux marron globuleux, des lèvres très rouges et plus fines qu’autrefois, aux commissures tombantes. Ses mains, où les veines saillent, semblent fragiles, ses épaules s’affaissent. Oui, mon père est un vieil homme. Je suis sous le choc. Est-ce que nos parents nous voient vieillir eux aussi ? Mélanie et moi ne sommes plus jeunes, même si nous restons ses « enfants ». Je me souviens d’une des amies de notre père, une femme extrêmement liftée, Janine. Elle nous avait dit un jour :
— C’est si étrange pour moi de voir les enfants de mon ami atteindre la quarantaine.
Ce à quoi Mélanie avait répondu en lui offrant son plus beau sourire :
— C’est encore plus étrange de voir les amies de son père devenir de vieilles dames.
Mon père a beau être quelque peu décrépit physiquement, il n’en garde pas moins l’esprit vif.
— Où diable est le docteur ? grogne-t-il. Qu’est-ce qui se passe ici, nom de Dieu ? Cet hôpital est nul !
Je ne moufte pas. J’ai l’habitude de ses éclats. Ils ne m’impressionnent plus. Une jeune infirmière arrive en courant comme un lapin pris dans les phares d’une voiture.
— Tu as vu Mel ?
— Elle dort, marmonne-t-il en haussant les épaules.
— Elle va s’en tirer.
Il me fixe, l’air furieux.
— Je la fais transférer à Paris. Il n’est pas question qu’elle reste ici. Elle a besoin de bons médecins.
Je pense aux yeux noisette de Bénédicte Besson, aux taches de sang sur sa blouse, à tout ce qu’elle a fait la nuit dernière pour sauver la vie de ma sœur. Mon père se laisse tomber sur une chaise. Il guette une réponse ou une réaction de ma part. Je ne le gratifie ni de l’une ni de l’autre.
— Redis-moi ce qui s’est passé.
Je m’exécute.
— Avait-elle bu ?
— Non.
— Comment peut-on ainsi quitter la route ?
— C’est pourtant ce qui est arrivé.
— Où est la voiture ?
— Il n’en reste pas grand-chose…
Il me dévisage, menaçant et soupçonneux.
— Pourquoi êtes-vous allés à Noirmoutier tous les deux ?
— C’était une surprise pour l’anniversaire de Mel.
— Pour une surprise…
La colère monte. Il arrive toujours à m’atteindre, je ne sais pas pourquoi je m’en étonne. Oui, il y parvient encore et moi, je me laisse faire.
— Elle a adoré, dis-je en forçant le trait. Nous avons passé là-bas trois jours merveilleux. C’était…
Je m’interromps. J’ai un ton de gamin excédé. Exactement ce qu’il voulait. Sa bouche se tord comme quand il savoure sa victoire. Mélanie fait-elle semblant de dormir ? Je suis sûr que derrière la porte, elle écoute chacun des mots que nous prononçons.
Après la mort de Clarisse, notre père s’est refermé sur lui-même. Il est devenu dur, amer et toujours pressé. Difficile de se souvenir du vrai père, celui qui était heureux, qui souriait et riait, qui s’amusait à nous tirer les cheveux et nous préparait des crêpes le dimanche matin. Même quand il était débordé et rentrait tard, il prenait du temps pour nous, à sa façon. Il participait à nos jeux, nous emmenait au bois de Boulogne, ou nous conduisait à Versailles pour une balade dans le parc du château et une partie de cerf-volant.
Il ne nous montre plus jamais qu’il nous aime. Plus depuis 1974.
— Je n’ai jamais supporté Noirmoutier.
— Pourquoi ?
Pour toute réponse, il lève ses sourcils broussailleux.
— Robert et Blanche aimaient bien cet endroit, non ? demandé-je.

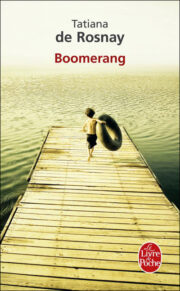
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.