— Mon Dieu, mais qu’est-ce que c’est que ça ? grogne-t-il. Il donne à Arno, une tape dans le dos. – Tiens-toi droit, idiot, bête que tu es ! Ton père ne te le dit donc jamais ? Il ne vaut pas mieux que toi, franchement.
Je sais qu’il plaisante, mais comme toujours, son humour est mordant. Depuis qu’Arno est tout petit, mon père me harcèle à cause de l’éducation que je lui donne, me reprochant de mal l’élever.
Nous entrons tous sur la pointe des pieds dans la chambre de Mélanie. Elle n’est pas réveillée. Son visage est plus pâle que ce matin. Elle a l’air d’une petite chose et fait subitement plus que son âge. Les yeux de Margaux s’embuent et j’y vois briller des larmes. Elle a l’air horrifié par l’aspect de sa tante. Je passe un bras autour de ses épaules et la serre contre moi. Elle sent la sueur et le sel. Le parfum de cannelle de la petite fille a disparu. Arno demeure bouche bée. Lucas gigote, orientant son regard alternativement vers moi, sa mère et Mélanie.
Puis Mélanie tourne la tête et ouvre doucement les yeux. Elle reconnaît les enfants et son visage s’éclaire. Elle tente un faible sourire. Margaux éclate en sanglots. Les yeux d’Astrid sont aussi pleins de larmes, sa bouche tremble. Je m’éclipse discrètement dans le couloir. Je prends une cigarette que je n’allume pas.
— Interdiction de fumer ! hurle une infirmière aux airs de matrone en pointant un doigt rageur vers moi.
— Je la tiens juste. Je ne la fume pas.
Elle me lance un sale regard, comme si j’étais un voleur à l’étalage pris la main dans le sac. Je range ma cigarette dans son paquet. Je pense soudain à Clarisse. Il ne manque qu’elle. Si elle était encore en vie, elle serait ici avec nous, dans cette chambre, auprès de sa fille, de ses enfants, de ses petits-enfants. De son mari. Elle aurait soixante-neuf ans. Impossible d’imaginer ma mère à soixante-neuf ans. Elle restera pour toujours une jeune femme. J’ai atteint un âge qu’elle n’a jamais connu. Elle n’a jamais su ce que c’était que d’élever des adolescents. Tout aurait été différent si elle n’avait pas disparu. Mélanie et moi avons mis le couvercle sur notre puberté. Nous avions été habitués à la soumission ; il n’y eut donc ni emportements, ni cris, ni portes qui claquent, ni insultes. Pas de saine rébellion adolescente. La raideur de Régine nous avait muselés. Blanche et Robert avaient approuvé. C’était la bonne méthode, selon eux. Des enfants présents, mais en silence. Et notre père qui, en une nuit, était devenu une autre personne, ne s’intéressant plus à ses enfants, ni à leur avenir.
Mélanie et moi n’avons pas eu le droit d’être des adolescents.
Alors que je raccompagne ma famille vers la sortie, une grande femme en uniforme bleu pâle me dépasse en me souriant. Elle porte un badge, mais je ne parviens pas à savoir si c’est une infirmière ou un médecin. Je lui rends son sourire. Je songe à quel point il est agréable, dans ces hôpitaux de province, que les gens vous saluent, ce qui n’arrive jamais à Paris. Astrid a toujours l’air fatigué et je commence à penser que faire maintenant la route jusqu’à Paris, dans cette chaleur étouffante, n’est pas une très bonne idée. Ne pourraient-ils pas rester un peu plus longtemps ? Elle hésite, puis marmonne quelque chose à propos de Serge qui l’attend. J’ajoute que j’ai réservé une chambre dans un petit hôtel voisin où je resterai tant que Mélanie doit être hospitalisée. Pourquoi n’en profiterait-elle pas pour se reposer avant de reprendre la route ? La chambre est petite, mais fraîche. Elle pourrait même prendre une douche. Elle incline la tête, l’idée ne lui déplaît pas. Je lui tends les clefs et lui montre l’hôtel, juste derrière la mairie. Elle s’éloigne avec Margaux. Je les suis du regard.
Arno et moi retournons vers l’hôpital et nous asseyons sur les bancs de bois qui encadrent l’entrée.
— Elle va s’en tirer, hein ?
— Mel ? Tu parles ! Bien sûr qu’elle va s’en tirer.
Mais ma voix ne fait pas illusion.
— Papa, tu as dit que la voiture avait quitté la route ?
— Oui. Mel conduisait. Et puis soudain, boum, l’accident.
— Mais comment ? Comment est-ce arrivé ?
Je décide de lui dire la vérité. Ces derniers temps, Arno s’est montré distant, renfermé, ne répondant à mes questions qu’en grognant. Je n’arrive même pas à me souvenir de la dernière fois où nous avons eu une conversation digne de ce nom. Alors l’entendre à nouveau, sentir ses yeux fixer les miens me donne envie de prolonger autant que possible ce contact inespéré, d’une manière ou d’une autre.
— Elle était sur le point de me confier quelque chose qui la préoccupait. C’est à cet instant-là que c’est arrivé. Elle a juste eu le temps de me dire qu’un souvenir troublant avait ressurgi. Mais depuis l’accident, sa mémoire a quelques failles.
Arno se tait. Ses mains sont si grandes désormais. De vraies mains d’homme.
— Tu crois que c’était quoi ?
J’inspire un bon coup.
— Je crois que ça concernait notre mère.
Arno a l’air surpris.
— Votre mère ? Mais vous n’en parlez jamais !
— C’est vrai, mais ce séjour de trois jours à Noirmoutier nous a beaucoup remués. Nous avons évoqué le passé et parlé d’elle. Toutes sortes d’images ont refait surface.
— Continue, me presse-t-il. Comme quoi ?
J’aime sa façon de poser des questions, directe, sans détour.
— Comment elle était, par exemple.
— Tu avais oublié ?
— Non, ce n’est pas ce que je voulais dire. Je me souviens parfaitement du jour de sa mort, qui reste le pire jour de ma vie. Imagine : tu dis au revoir à ta mère, tu pars à l’école avec la jeune fille au pair, tu passes une journée de classe comme toutes les autres et tu reviens, fin d’après-midi, avec ton pain au chocolat à la main. Sauf que quand tu arrives à la maison, ton père est déjà rentré, tes grands-parents sont là, tous avec une mine à faire peur. Ils t’annoncent que ta mère est morte. Qu’elle a eu quelque chose au cerveau. Ensuite, à l’hôpital, on te montre un corps sous un drap en te disant que c’est ta mère. On soulève le drap et tu fermes les yeux. C’est ce que j’ai fait, j’ai fermé les yeux.
Il me fixe en accusant le coup.
— Pourquoi tu ne m’as jamais rien raconté ?
Je hausse les épaules.
— Tu ne m’as jamais rien demandé.
Son regard retombe. Le piercing qu’il porte à l’un de ses sourcils suit le mouvement. Décidément, je ne m’y ferai jamais.
— C’est nul comme raison !
— En fait, je ne savais pas comment t’en parler.
— Pourquoi ?
Ses questions commencent à me déranger. Mais je veux continuer de lui répondre. Je ressens le besoin vital de me débarrasser d’un poids qui m’oppresse, en me confiant, pour la première fois, à mon fils.
— Parce que, quand elle est morte, tout a changé pour Mel et moi. Personne ne nous a expliqué ce qui s’était passé. C’était les années soixante-dix, tu comprends. De nos jours, on fait plus attention aux enfants, on les emmène chez le psy quand ce genre d’événement survient. Mais, à l’époque, personne ne nous a aidés. Notre mère avait disparu de nos vies, voilà tout. Notre père s’est remarié. On n’a plus jamais entendu prononcer le prénom de Clarisse. Ses photos, toutes les photos où elle était, ont disparu du paysage.
— C’est vrai ? grommelle-t-il.
— Oui, c’est vrai. On l’a effacée de nos vies. Et nous, nous avons laissé faire. Parce que la tristesse nous écrasait, que nous n’étions que des enfants, impuissants. Quand nous avons été assez âgés pour nous débrouiller tout seuls, nous avons quitté la maison, Mélanie et moi. Et tout ce temps, nous avons laissé les souvenirs de notre mère rangés dans des cartons. Je ne parle pas de ses vêtements, de ses livres, des objets qui lui appartenaient, non, je parle des souvenirs que nous avions d’elle.
J’ai soudain du mal à respirer.
— Elle était comment ? demande-t-il.
— Physiquement, elle ressemblait à Mel. La même silhouette, la même couleur de cheveux. Elle était gaie, pétillante. Pleine de vie.
Je m’interromps. Une douleur trop intime me perce le cœur. Je ne peux plus parler. Les mots ne veulent pas sortir.
— Excuse-moi de t’avoir embêté avec tout ça, marmonne Arno. On en parlera une autre fois. Ne t’inquiète pas, papa.
Il étire ses longues jambes et me tape le dos affectueusement, sans doute gêné d’être témoin de mon émotion.
La femme en blouse bleue que j’ai croisée tout à l’heure passe près de nous et me sourit une fois encore. Elle a de belles jambes. Un joli sourire. Je lui retourne son attention.
Le portable d’Arno se met à sonner et il se lève pour répondre. En baissant la voix, il s’éloigne de moi. Je ne sais rien de la vie de mon fils. Il ne ramène que rarement ses copains à la maison, sauf une fille dérangeante dans le genre gothique, avec des cheveux noir corbeau et des lèvres violettes, une sorte d’Ophélie en train de se noyer. Ils s’enferment dans sa chambre et écoutent de la musique à fond. En fait, je déteste poser des questions à mon fils. Un jour que je tentais une approche tout en légèreté, je me suis vu gratifié d’un glacial : « T’es de la Gestapo ou quoi ? » Depuis, j’évite les questions. D’ailleurs, quand j’avais son âge, je détestais que mon père fourre son nez dans mes affaires. Mais je n’aurais jamais osé lui répondre de cette façon.
J’allume une cigarette et me lève pour me dégourdir les jambes. Je réfléchis. Comment organiser le séjour de Mélanie à l’hôpital ? Je ne sais pas par où commencer. Je sens une présence près de moi. Quand je me retourne, je tombe sur la femme aux longues jambes et à la blouse bleue.
— Puis-je vous demander une cigarette ?
Je lui tends mon paquet d’une main maladroite. Même gaucherie quand je me débats avec mon briquet.
— Vous travaillez ici ?
Elle a des yeux étonnants, presque dorés. J’imagine qu’elle doit avoir la quarantaine, peut-être plus jeune. Tout ce que je sais, c’est qu’elle est agréable à regarder.
— Oui, me répond-elle.
Nous sommes un peu gênés. Je jette un coup d’œil sur son badge. Angèle Rouvatier.
— Vous êtes médecin ?
Elle sourit.
— Non, pas exactement.
Avant que je puisse poser une autre question, elle me demande :
— Est-ce que ce jeune homme est votre fils ?
— Oui. Nous sommes ici parce que…
— Je sais pourquoi vous êtes ici, dit-elle. C’est un petit hôpital.
Elle parle d’une voix basse et amicale. Pourtant quelque chose d’étrange se dégage de sa personne, je ne saurais dire quoi exactement. Une certaine distance.
— Votre sœur a eu de la chance. C’était un sacré choc. Vous aussi, vous avez eu de la chance.
— Oui, j’ai eu beaucoup de chance.
Nous tirons quelques bouffées en silence.
— Vous travaillez avec le docteur Besson, si je comprends bien.
— C’est le patron.
Je note qu’elle ne porte pas d’alliance. Avant c’est un détail qui m’aurait échappé.
— Je dois y aller. Merci pour la cigarette.
J’admire la finesse de ses longs mollets. Je ne me souviens même pas de la dernière femme avec qui j’ai couché. Probablement une fille rencontrée sur Internet. Ce devait être un de ces coups sinistres d’une ou deux heures. Préservatif usagé, au revoir pressé, et on passe à autre chose.
La seule fille chouette que j’aie rencontrée depuis mon divorce est une femme mariée, Hélène. Une de ses filles suit le même cours d’art plastique que Margaux. Mais elle n’a pas envie d’avoir une aventure. Elle préfère que nous restions amis. Ça me va bien comme ça. Elle est devenue une alliée précieuse. Quand nous dînons dans les brasseries bruyantes du Quartier latin, elle me tient la main et me laisse déballer mes idées noires. La situation n’a pas l’air de déranger son mari. De toute façon, il n’a aucune raison d’être jaloux de moi. Hélène vit boulevard de Sébastopol dans un appartement, où règne un joyeux fouillis, qu’elle a hérité de son grand-père et redécoré de manière audacieuse. La façade du bâtiment est en piteux état. Le quartier est coincé entre les Halles et Beaubourg, deux symboles de la vanité présidentielle. Quand je vais là-bas rendre visite à Hélène, à chaque fois, des souvenirs d’enfance me reviennent. Mon père et moi aimions traîner le long des stands du marché des Halles, aujourd’hui disparu. Il aimait me sortir du 16e arrondissement pour me montrer le vieux Paris, celui qui semblait tout droit sorti d’un roman d’Émile Zola. Je me souviens, je reluquais en douce les prostituées alignées le long de la rue Saint-Denis, jusqu’au moment où mon père me sommait sévèrement d’arrêter.
Je suis du regard Astrid et Margaux qui remontent de l’hôtel, requinquées par la douche. Astrid a les traits plus détendus, elle semble reposée. Elle tient la main de Margaux et leurs bras se balancent, comme nous le faisions quand notre fille était encore petite.

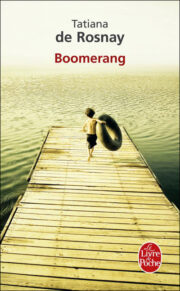
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.