Je repense à ce que Mélanie s’apprêtait à me dire quand la voiture a quitté la route. Depuis l’accident, j’ai constamment cela à l’esprit, cette énigme ne me quitte pas, elle est là, dans un coin de ma tête, comme un poids mort, oppressant. J’hésite à en parler au docteur Besson. Comment le lui dire et, surtout, qu’en pensera-t-elle ? Évidemment, la seule personne avec qui j’ai vraiment envie d’en parler, pour le moment, c’est mon ex-femme. Mais elle n’est pas là.
J’allume mon portable et j’écoute mes messages. Lucie m’a appelé à propos d’un nouveau contrat. Rabagny a essayé de me contacter trois fois. Si j’ai accepté de créer sa crèche « artistique » dans le quartier de la Bastille, c’est parce que c’était bien payé et que je ne pouvais plus me permettre de faire la fine bouche. La pension que je verse à Astrid chaque mois est faramineuse. Nos avocats se sont occupés de tout et je suppose que l’arrangement était juste. J’ai toujours gagné plus qu’elle. Mais les fins de mois sont un peu raides.
Rabagny ne comprend pas où je suis et pourquoi je ne le rappelle pas. Pourtant, je lui ai envoyé un SMS hier lui expliquant la situation, l’accident. Je déteste le son de sa voix. Haut perchée et geignarde, comme celle d’un enfant gâté. Il y a un problème avec les aires de jeux. La couleur ne va pas. Le matériau ne convient pas. Il se plaint sans arrêt, vomit son mécontentement. Je l’imagine devant moi et je vois sa face de rat, ses yeux globuleux et ses grandes oreilles. Dès le début, je l’ai eu dans le nez. Il a à peine trente ans, mais il est déjà aussi arrogant que désagréable à regarder. Je jette un coup d’œil à ma montre. Sept heures. Il est encore temps de le rappeler. Je ne le ferai pas. J’efface tous ses messages d’un geste rageur.
Le suivant a été laissé par Hélène. Sa douce voix de colombe. Elle veut savoir comment va Mélanie, comment je vais moi, depuis que nous nous sommes parlés il y a quelques heures. Elle est encore à Honfleur, dans sa famille. J’ai beaucoup fréquenté cette maison depuis mon divorce. Elle surplombe la mer. C’est une maison heureuse, désordonnée, accueillante. Hélène est une amie précieuse parce qu’elle sait exactement comment faire pour que je me sente mieux dans ma vie. L’effet ne dure pas, mais c’est déjà ça. Ce que j’ai le plus détesté à propos du divorce, c’est la division entre nos amis. Certains ont choisi le camp d’Astrid, d’autres le mien. Pourquoi ? Je n’ai jamais compris. Comment peuvent-ils continuer à aller dîner dans la maison de Malakoff avec l’autre, assis à ma place ? Ils ne trouvent pas triste de me rendre visite rue Froidevaux, dans cet appartement où il est tellement évident que je ne me remets pas de notre séparation ? Certains de ces amis ont choisi Astrid parce qu’elle respire le bonheur. La vie sociale est plus facile avec quelqu’un d’heureux, j’imagine.
Qui veut passer du temps à broyer du noir avec un loser ? Personne n’a envie de m’entendre parler de ma solitude, de ce raz-de-marée qui m’a submergé les premiers mois où je me suis retrouvé sans ma famille, après avoir été un pater familias pendant dix-huit ans. Personne ne veut m’entendre décrire mes petits matins blêmes dans ma cuisine Ikea, sur fond de baguette brûlée et de radio réglée sur RTL, qui braille les nouvelles. Au début, dans cet appartement, le silence me terrassait. J’étais habitué à entendre Astrid hurler aux enfants de se dépêcher, habitué au martèlement furieux des chaussures d’Arno dévalant l’escalier, aux aboiements de Titus, aux cris hystériques de Lucas cherchant partout son sac de sport. Maintenant qu’une année a passé, j’avoue que je me suis fait à mes petits matins tranquilles. Cependant, le bourdonnement de la vie familiale continue de me manquer.
Il y a encore quelques messages de clients. Certains sont urgents. L’été est fini, les gens sont de retour au travail, ils ont repris le collier. Je pense au temps qu’il va me falloir passer ici. Au temps que je peux me permettre de passer ici. Je suis coincé depuis bientôt trois jours, et Mel ne peut toujours pas bouger. Le docteur Besson ne me donne guère de précisions. Encore des messages, de la compagnie d’assurances de la voiture pour les papiers que je dois remplir. Je m’empresse de noter tout ça dans mon petit calepin.
J’allume mon ordinateur et me branche sur la connexion de la chambre pour lire mes mails. Deux d’Emmanuel et quelques-uns de boulot. Je réponds à tous brièvement. Puis j’ouvre les fichiers AutoCAD qui concernent les projets en cours. Je suis surpris de constater à quel point ils ne m’intéressent pas le moins du monde. Fut une époque où imaginer de nouveaux espaces de bureau, une bibliothèque, un hôpital, un centre sportif, un labo me donnait le frisson. Aujourd’hui, cela m’accable. J’ai la sensation que j’ai gaspillé ma vie et mon énergie dans un domaine qui m’indiffère. Comment en suis-je arrivé là ? Peut-être suis-je en pleine dépression ou au beau milieu d’une crise de la quarantaine. Je n’ai rien vu venir. Mais peut-on voir venir ce genre de choses ?
Je referme mon ordinateur et m’allonge sur le lit. Les draps ont encore le parfum d’Angèle Rouvatier. Cela me plaît. La chambre est petite, moderne, sans charme mais confortable. Les murs sont gris perle, avec une fenêtre qui donne sur le parking, et la moquette, fatiguée, beigeasse. À cette heure, Mélanie a déjà pris son dîner. Pourquoi les repas sont-ils servis toujours si ridiculement tôt dans les hôpitaux ? J’ai le choix entre un McDo dans la zone industrielle de la ville et une petite pension de famille sur l’avenue principale, où j’ai dîné deux fois. Le service est lent, la salle à manger pleine d’octogénaires édentés, mais les repas sont copieux. Ce soir, je vote pour le jeûne. Ça me fera du bien.
J’allume la télévision et tente de me concentrer sur les infos. Troubles au Moyen-Orient, bombardements, émeutes, morts, violence. Je zappe de chaîne en chaîne, écœuré par ce que je vois, jusqu’à ce que je tombe sur Singin’ in the Rain. Comme toujours, je suis fasciné par les jambes sculpturales de Cyd Charisse et par sa guêpière étroite vert émeraude. La splendide créature tourne autour d’un Gene Kelly à lunettes, godiche.
Allongé sur mon lit, à m’extasier devant ces longues et plantureuses cuisses à la fermeté impeccable, j’éprouve un certain sentiment de paix. Je regarde le film avec la tranquillité d’un enfant ensommeillé. C’est un bonheur serein que je n’ai pas ressenti depuis longtemps. Pourquoi ? Pourquoi diable me sentir heureux ce soir ? Ma sœur est plâtrée jusqu’à la taille et ne pourra pas marcher avant Dieu sait quand, je suis toujours amoureux de mon ex-femme et je déteste mon boulot. Pourtant le sentiment de paix est bien là, qui m’envahit, plus puissant que toutes mes pensées noires. Cyd Charisse est belle, avec ce voile blanc drapé autour d’elle, les bras tendus contre le décor violet. Ses jambes sont interminables. J’ai l’impression que je pourrais rester allongé dans cette chambre pour toujours, réconforté par l’odeur musquée d’Angèle Rouvatier et les cuisses de Cyd Charisse.
Mon téléphone lâche un bip. Un SMS. Je détourne à regret les yeux de Singin’ in the Rain pour attraper mon portable.
J’ai plus d’appétit qu’un barracuda.
Le numéro m’est inconnu, mais je devine qui c’est. Angèle a dû trouver mes coordonnées dans le dossier de Mélanie, auquel elle a accès comme membre de l’équipe soignante.
Le sentiment de paix, de satisfaction, s’enroule autour de moi comme un chat qui ronronne. Je veux en profiter au maximum car je sais qu’il ne va pas durer. Je m’abrite dans l’œil du cyclone.
Malgré mes efforts, je suis hanté par ce voyage fatal durant lequel Astrid a rencontré Serge, il y a quatre ans. Les enfants n’étaient pas encore entrés dans la zone de turbulences de l’adolescence. Sur mon idée, nous avions organisé un séjour en Turquie, au Club Med de Palmiye. Nous passions, d’habitude, la plus grande partie des vacances chez les parents d’Astrid, Bibi et Jean-Luc, dans leur maison de Dordogne, près de Sarlat. Mon père et Régine avaient une propriété dans la vallée de la Loire, un presbytère que Régine avait également transformé en cauchemar contemporain, mais nous n’y étions que rarement invités et nous ne nous y sentions jamais les bienvenus.
Les étés avec Bibi et Jean-Luc étaient plus difficiles. Malgré la beauté grandiose du Périgord noir, la cohabitation avec mes beaux-parents était de plus en plus délicate. Elle devenait même fastidieuse. Les obsessions intestinales de Jean-Luc, son observation minutieuse de la consistance de ses selles, les menus frugaux où chaque calorie était comptée, l’exercice perpétuel… Bibi avait l’habitude. Elle laissait filer en s’agitant dans la cuisine comme une abeille dans sa ruche, avec son visage de lune au teint rose et ses fossettes, ses cheveux blancs rassemblés en un petit chignon de danseuse, chantonnant sans cesse et se contentant de hausser les épaules quand Jean-Luc faisait son cirque. Chaque matin, quand je buvais mon café noir et sucré, j’avais droit aux mêmes aboiements de la part de mon beau-père : « Très mauvais pour ce que tu as ! », « Tu seras mort à cinquante ans ! ». Pareil quand je me cachais derrière les hortensias pour en griller une rapidement : « Une seule cigarette réduit ton espérance de vie de cinq minutes, tu sais ça ? » Bibi, quant à elle, faisait le tour du jardin d’un pas alerte, enroulée comme une momie dans du film plastique pour transpirer un maximum, en s’aidant de deux bâtons de ski. Elle appelait ça la marche nordique et, comme elle était suédoise, je suppose que c’était tout indiqué, bien qu’elle eût l’air absolument ridicule.
L’obsession de mes beaux-parents pour le naturisme sixties, autour de la piscine mais aussi dans la maison, commençait à me porter sur les nerfs. Ils trottinaient comme de vieux faunes, sans se rendre compte que leurs derrières flasques n’inspiraient rien d’autre que de la pitié. Je n’osais pas aborder le sujet avec Astrid qui, elle aussi, cédait à cette mode du naturisme estival, avec plus de modération que ses parents malgré tout. Le rouge s’est allumé quand Arno, qui venait d’avoir douze ans, a marmonné quelque chose, au dîner, à propos de son embarras lorsqu’il invitait des copains à profiter de la piscine et que ses grands-parents étalaient à la vue de tous leurs parties génitales. Nous avons décidé de changer de destination estivale, même si nous continuions de leur rendre visite.
Cet été-là, nous avons troqué la Dordogne et ses forêts de chênes, le muesli bio et les beaux-parents nudistes contre la chaleur accablante et la joie obligatoire du Club Med. Je n’ai pas tout de suite remarqué Serge. Je n’ai pas flairé le danger. Astrid allait à ses cours d’aquagym et de tennis, les enfants étaient au Mini-Club et moi, je lézardais des heures à la plage, sur le sable ou dans l’eau, à faire la sieste, à nager, à bronzer ou à lire. Je me rappelle avoir énormément lu cet été-là, beaucoup de romans que Mélanie avait ramenés de sa maison d’édition, de jeunes auteurs de talent, des écrivains plus confirmés, des auteurs étrangers. Je les ai lus comme ça, insouciant, détendu, pas vraiment concentré. Tout en moi était empreint d’une délicieuse paresse. Je ronronnais au soleil, avec la certitude que tout allait pour le mieux dans mon petit monde. Il aurait mieux valu que je reste sur mes gardes.
Je crois qu’elle l’a rencontré sur les courts de tennis. Ils avaient le même prof, un Italien frimeur qui portait des shorts blancs moulants et se pavanait comme Travolta dans La Fièvre du samedi soir. Rien ne m’a paru bizarre jusqu’à une excursion à Istanbul. Serge faisait partie du groupe. Nous étions une quinzaine, tous au Club, et un guide nous accompagnait, un Turc étrange qui avait fait ses études en Europe et parlait avec un drôle d’accent belge. Nous avons lamentablement traîné les pieds à Topkapi, dans la mosquée bleue, à Sainte-Sophie, dans les citernes antiques ornées d’étranges têtes de méduses renversées, dans le bazar, écrasés de chaleur et de fatigue. Lucas était le plus jeune des enfants présents, il n’avait que six ans, et se plaignait sans arrêt.
Ce que j’ai remarqué en premier, c’est le rire d’Astrid. Nous traversions le Bosphore en bateau quand le guide a désigné la rive asiatique et je l’ai entendue s’esclaffer. Serge me tournait le dos. Il tenait une fille jeune et fraîche par la taille, et tous les trois riaient. « Hé, Tonio, viens faire la connaissance de Serge et Nadia. » Je me suis exécuté et j’ai serré la main de Serge en luttant contre le soleil pour apercevoir son visage. Il n’avait rien de particulier. Plus petit que moi, costaud. Des traits assez communs. Sauf qu’Astrid n’arrêtait pas de le regarder. Comme lui. Il était avec sa petite amie et ne décollait pas les yeux de ma femme. L’envie m’a pris de le passer par-dessus bord.

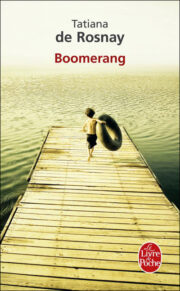
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.