Ma belle-mère ouvre la porte et me gratifie d’un baiser distrait sur la joue. Régine a un bronzage de pain brûlé qui la vieillit et la fait paraître plus ridée qu’elle ne l’est. Comme d’habitude, elle porte des vêtements style Courrèges et empeste le N° 5 de Chanel. Elle me demande comment va Mel, je lui réponds en la suivant dans le salon. Je n’aime pas venir ici. C’est comme revenir en arrière, à une époque où je n’ai pas été heureux. Mon corps en a conservé la trace et je le sens se raidir un peu plus à chaque instant, dans un réflexe d’autodéfense. L’appartement, comme la galerie Saint-Didier, n’a pas bien vieilli. Sa modernité tapageuse est aussi passée qu’un vieux rideau. La décoration est affreusement démodée. Les nuances gris et marron, la moquette à poils longs ont perdu de leur éclat et se sont usés. Tout a l’air taché, abîmé.
Mon père arrive en traînant les pieds. Je suis frappé par son apparence. On dirait qu’il a vieilli en à peine une semaine. Il a l’air à bout de forces. Ses lèvres sont pâles. Son teint est étrangement jaunâtre. Difficile de reconnaître en cet homme le célèbre avocat qui matait ses adversaires rien qu’en entrant dans la salle d’audience.
Au début des années soixante-dix, la scandaleuse affaire Vallombreux avait lancé la carrière de mon père. Edgar Vallombreux, conseiller politique de renom, avait été retrouvé inanimé dans sa maison de campagne de la région bordelaise, après un suicide présumé consécutif au résultat désastreux de son parti au cours de récentes élections. Paralysé, incapable de parler, en pleine dépression, il était condamné à rester cloué sur un lit d’hôpital pour le reste de sa vie. Sa femme, Marguerite, n’avait jamais cru à la thèse du suicide. Pour elle, il était évident que son mari avait été agressé parce qu’il possédait des informations fiscales confidentielles sur quelques ministres en poste.
Je me souviens que Le Figaro avait consacré une page entière à mon père, le jeune et insolent avocat qui avait osé apostropher le ministre des Finances. Après une semaine d’un procès houleux et palpitant qui avait tenu en haleine le pays entier, il avait prouvé que Vallombreux avait été victime d’un vaste scandale financier, qui fit tomber, par la suite, quelques têtes.
Au cours de mon adolescence, on m’a souvent demandé si j’avais un lien avec le « légendaire avocat ». Parfois, cela m’embarrassait ou m’ennuyait et je répondais « non ». On nous tenait, Mélanie et moi, à l’écart de la vie professionnelle de notre père. Nous l’avons rarement vu plaider. Nous savions juste qu’il était craint et respecté.
Mon père me donne une tape sur l’épaule et se dirige vers le bar. Il me tend un whisky. Sa main tremble. Je n’aime pas cet alcool, mais je n’ai pas le cœur de le lui rappeler. Je fais semblant de boire. Il s’assoit en grognant et en se frottant les genoux. Il est à la retraite, ce qui ne lui plaît pas du tout. Des avocats plus jeunes ont pris sa place et il ne fait plus partie de la scène judiciaire. Je me demande comment il occupe ses journées. Lit-il ? Voit-il des amis ? Discute-t-il avec sa femme ? Je ne sais rien de la vie de mon père, en fait. Comme il ne sait rien de la mienne. Et ce qu’il croit en savoir, il le désapprouve.
Joséphine apparaît, marmonnant dans son portable, qu’elle tient coincé entre sa joue et son épaule. Elle me sourit et me tend quelque chose. C’est un billet de cinq cents euros. Elle me lance un clin d’œil et me fait comprendre d’un geste que le reste suivra.
Mon père me parle des problèmes de plomberie de sa maison de campagne mais mon esprit est ailleurs. Je regarde autour de moi et essaie de me rappeler comment les choses étaient arrangées quand ma mère était encore vivante. Des plantes vertes étaient posées près de la fenêtre, le plancher brillait d’une jolie teinte noisette, il y avait des livres dans un coin et un canapé recouvert de chintz, un bureau, aussi, où elle aimait s’asseoir pour écrire dans le soleil du matin. Je me demande ce qu’elle écrivait. Et qu’est devenu tout cela ? Ses livres, ses photos, ses lettres ? Je veux questionner mon père, mais je ne le fais pas. Je sais que c’est impossible. Il en est toujours à ses histoires d’intendance et se plaint du nouveau jardinier que Régine a engagé.
Elle est morte ici. Son corps est passé par cette entrée et a descendu l’escalier recouvert d’un tapis rouge. Où est-elle morte exactement ? On ne me l’a jamais dit. Dans sa chambre, qui est juste derrière l’entrée ? Dans la cuisine, à l’autre bout du couloir ? Comment la scène s’est-elle déroulée ? Qui était présent ? Qui l’a trouvée ?
Rupture d’anévrisme. Le genre d’accident qui arrive sans prévenir. Foudroyant. À n’importe quel âge. Comme ça.
Il y a trente-trois ans, ma mère est morte dans l’appartement où je suis maintenant assis. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je l’ai embrassée. Cela fait mal.
— Tu m’écoutes au moins, Antoine ? demande mon père d’un ton sarcastique.
En rentrant chez moi, je comprends que les enfants sont déjà là. Je sens leur présence en montant l’escalier. De la musique, des bruits de pas, des éclats de voix. Lucas regarde la télévision, ses chaussures sales posées sur le canapé. Quand j’entre, il se lève d’un bond pour venir me dire bonjour. Margaux apparaît dans l’encadrement de la porte. Je ne m’habitue décidément pas à ses cheveux orange, mais je ne me permets aucune remarque.
— Salut, papa… dit-elle d’une voix traînante.
Il y a du mouvement derrière elle et je vois surgir Pauline par-dessus son épaule. Sa meilleure amie depuis qu’elle est toute petite. Sauf qu’aujourd’hui, on dirait que Pauline a vingt ans. On ne voit plus que ses seins imposants et ses hanches de femme. Je ne l’embrasse plus comme lorsqu’elle était enfant. Je ne l’embrasse même plus sur la joue. On se contente de se faire signe de loin.
— Ça pose un problème si Pauline dort ici ?
J’hésite. Je sais que si Pauline reste pour la nuit, je ne verrai pas ma fille, sauf au dîner. Elles vont s’enfermer dans sa chambre et papoter jusqu’à pas d’heure, et adieu mon « moment privilégié » avec ma fille.
— Non, pas du tout. Au contraire… dis-je à moitié convaincu. Tes parents sont d’accord ?
Pauline hausse les épaules.
— Ouais, pas de problème.
Elle a encore grandi pendant l’été et dépasse largement Margaux. Elle porte une minijupe en jean et un tee-shirt moulant violet. Dire qu’elle a quatorze ans. Qui pourrait le croire en la voyant ? Elle a probablement déjà ses règles. Je sais que ce n’est pas le cas de Margaux. Astrid me l’a dit il n’y a pas si longtemps. Avec un corps comme le sien, je réalise que Pauline doit attirer toutes sortes d’hommes. Des lycéens, mais aussi des garçons plus âgés. Des types de mon âge. Je me demande comment ses parents affrontent la situation. Peut-être a-t-elle un petit ami régulier, peut-être a-t-elle déjà fait l’amour, déjà commencé à prendre la pilule ! À quatorze ans !
Arno pointe son nez et me tape dans le dos. Son téléphone braille un air insupportable. Il décroche :
— Tu restes en ligne une seconde ?
Il disparaît. Lucas se concentre à nouveau sur la télévision. Les filles se sont enfermées dans la chambre. Et me voilà tout seul dans l’entrée. Comme un idiot.
Je vais dans la cuisine. Le plancher craque sous mes pas. Il ne me reste plus qu’à préparer le dîner. Salade de pâtes, avec de la mozzarella, des tomates cerises, du basilic frais et des cubes de jambon. Alors que je coupe le fromage, je ressens le vide de mon existence, si profondément que j’ai presque envie d’en rire. Et je ris finalement. Plus tard, quand le repas est prêt, les enfants mettent un temps fou à venir à table. Apparemment, ils ont tous mieux à faire.
— Pas de téléphone portable, pas de Nintendo, pas d’iPod à table, s’il vous plaît ! je déclare en apportant les plats.
Mes exigences sont accueillies avec des haussements d’épaules et des soupirs. Puis tous s’installent à table et le silence se fait, ponctué par des bruits de mastication. J’observe le petit groupe que nous formons. Mon premier été sans Astrid. J’en déteste chaque instant.
La soirée s’étire devant moi comme un champ à l’abandon. L’ultime erreur, c’était d’installer la WIFI et de leur offrir à chacun un ordinateur. Les enfants s’isolent dans leur espace privé et je les vois à peine. Plus jamais nous ne regardons la télévision en famille. Internet a pris le pas, en prédateur silencieux.
Je m’allonge sur le canapé et choisis un DVD. Un film d’action avec Bruce Willis. À un moment, j’appuie sur pause pour appeler Valérie et Mélanie et pour envoyer un SMS à Angèle, au sujet de notre prochain rendez-vous. La soirée est interminable. Ça glousse dans la chambre de Margaux, ça fait ping et pong dans celle de Lucas, dans celle d’Arno, on entend juste un bruit de basse qui sort de son casque. La chaleur a raison de moi. Je m’endors.
Quand j’ouvre les yeux, groggy, il est près de deux heures du matin. Je me lève comme je peux. Je trouve Lucas profondément endormi, la joue écrasée contre la Nintendo. Je le mets délicatement au lit en faisant tout mon possible pour ne pas le réveiller. Je décide de ne pas aller voir dans la chambre d’Arno. Après tout, il est en vacances et je n’ai pas envie de m’engueuler avec lui parce qu’il est trop tard et qu’il devrait dormir à cette heure, blablabla… Je me dirige vers la chambre de ma fille. Une odeur qui ne peut être que celle d’une cigarette me chatouille les narines. Je demeure un moment immobile, la main sur la poignée de sa porte. Toujours des gloussements, mais en sourdine. Je cogne. Les rires cessent immédiatement. Margaux ouvre. La chambre disparaît sous la fumée.
— Les filles, vous ne seriez pas en train de fumer, par hasard ?
Ma voix s’étrangle, presque timide, et j’enrage en m’entendant parler ainsi, moi l’adulte.
Margaux hausse les épaules. Pauline est affalée sur le lit. Elle ne porte qu’un soutien-gorge à frou-frou et une culotte transparente bleue. Je détourne mes yeux de la rondeur de sa poitrine qui semble me sauter au visage.
— Juste quelques cigarettes, papa, dit Margaux en levant les yeux au ciel.
— Je te rappelle que tu n’as que quatorze ans. C’est vraiment la chose la plus idiote que tu puisses faire…
— Si c’est si idiot que ça, pourquoi tu fumes alors ? rétorque-t-elle avec une pointe d’ironie.
Elle me claque la porte au nez.
Je reste dans le couloir, les bras ballants. Je m’apprête à frapper de nouveau à sa porte. Mais je laisse tomber. Je me retire dans ma chambre et m’assois sur mon lit. Comment Astrid aurait-elle réagi dans une telle situation ? Hurlé ? Puni ? Menacé ? Est-ce que Margaux se permet de fumer quand elle est chez sa mère ? Pourquoi faut-il que je me sente si impuissant ? Ça ne pourrait pas être pire. J’espère.
Même dans son austère blouse d’hôpital bleue, Angèle est sexy. Elle enroule ses bras autour de moi, sans se soucier que nous soyons tous les deux dans la morgue, entourés de cadavres, tandis que des familles éplorées attendent dans la pièce d’à côté. Chacune de ses caresses me fait l’effet d’une décharge électrique.
— Quand es-tu libre ?
Je ne l’ai pas vue depuis plus de trois semaines. La dernière fois que je suis venu voir Mélanie, j’étais avec mon père et je n’ai pas eu une minute pour passer du temps avec Angèle. Mon père était fatigué et il avait besoin que je le reconduise à Paris.
Elle soupire.
— Carambolage sur l’autoroute, quelques crises cardiaques, un cancer, une rupture d’anévrisme, tout le monde semble s’être donné le mot pour mourir en même temps.
— Rupture d’anévrisme… dis-je tout bas.
— Une jeune femme d’une trentaine d’années.
Je la tiens serrée contre moi, en caressant ses cheveux lisses et soyeux.
— Ma mère est morte d’une rupture d’anévrisme, à la trentaine.
Elle lève les yeux vers moi.
— Mais tu n’étais encore qu’un gosse…
— Oui.
— L’as-tu vue morte ?
— Non. J’ai fermé les yeux au dernier moment.
— Les personnes qui meurent d’une rupture d’anévrisme restent belles. Avec cette jeune femme, je n’ai pas eu grand-chose à faire.
L’endroit où nous sommes est frais, silencieux, un petit couloir qui jouxte la salle d’attente.
— Tu es déjà passé voir ta sœur ? demande-t-elle.
— Je viens d’arriver. Elle est avec les infirmières. J’y retourne maintenant.
— OK. Laisse-moi une heure ou deux. Après, j’aurai terminé.
Elle dépose sur ma bouche un baiser chaud et humide. Je rejoins l’aile où se trouve Mélanie. L’hôpital semble très plein, il y a plus d’activité que d’habitude. Ma sœur est moins pâle, son teint presque rose. Ses yeux s’éclairent quand elle me voit.

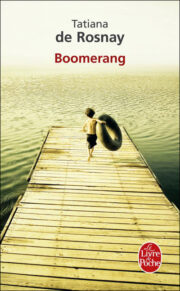
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.