Solange se dirige vers moi. Elle porte une robe brodée, un brin trop glamour pour ce genre d’occasion, et un collier de perles. Elle me prend la main. Son visage est enflé, ses yeux las. À quoi va ressembler sa vie maintenant, sans une mère dont il faut s’occuper, sans les infirmières à engager et cet immense appartement à entretenir ? Elle me conduit jusqu’à la chambre de Blanche où je la suis docilement. Des gens que je ne connais pas sont en train de prier. Une bougie est allumée. Je distingue une forme muette sur le lit, mais la seule chose que je crois voir, ce sont les deux yeux perçants et terribles fixés sur moi. Je tourne la tête.
À présent, je suis ma tante dans le petit salon. Il est vide. On entend à peine la rumeur des voix de ses invités. Elle ferme la porte. Son visage, qui me rappelle tant celui de mon père, si ce n’est le menton, plus grand, semble de marbre tout à coup, moins accueillant. Je comprends que je vais passer un mauvais quart d’heure. Être dans cette pièce est déjà pénible. Je baisse sans arrêt les yeux vers le tapis. C’est là que le corps de ma mère est tombé. Juste là, sous mes pieds.
— Comment va François ce soir ? demande-t-elle en jouant avec son collier de perles.
— Je ne l’ai pas vu, il dormait.
— Il paraît qu’il fait preuve de beaucoup de courage.
— Par rapport à Blanche ?
Elle se raidit quelque peu. Les perles cliquètent.
— Non. Face à son cancer.
Je suis KO debout. Son cancer. Bien sûr. Le cancer. Mon père a un cancer. Depuis combien de temps ? Un cancer de quoi ? À quel stade ? Personne ne dit jamais rien dans cette famille, décidément. On préfère le silence. La torpeur et le chloroforme du silence. Le silence de plomb coulant sur tout comme une étouffante et fatale avalanche.
Je me demande si elle sait. Si elle peut deviner, simplement à mon expression, que c’est la première fois que j’entends parler de la maladie de mon père. La première fois qu’on lui donne un nom.
— Oui, dis-je, morose. Tu as raison. Il se montre courageux.
— Je dois retourner à mes invités, finit-elle par répondre. Au revoir, Antoine. Merci d’être venu.
Elle sort, droite comme un i. Alors que je me dirige vers la porte d’entrée, Gaspard arrive du grand salon avec un plateau. Je lui fais signe que je l’attends au rez-de-chaussée. Je descends et sors griller une cigarette.
Gaspard arrive quelques minutes plus tard. Il a l’air calme, quoiqu’un peu fatigué. Il va droit au but.
— Monsieur Antoine, il faut que je vous dise quelque chose.
Il s’éclaircit la gorge. Il a l’air plus serein que l’autre jour, dans sa chambre.
— Votre grand-mère est morte. Elle me faisait peur, tellement peur, vous comprenez ? Maintenant, elle ne peut plus rien contre moi.
Il s’interrompt et tire sur sa cravate. Je décide de le laisser venir.
— Quelques semaines après la mort de votre mère, une femme est venue voir Madame. C’est moi qui lui ai ouvert. C’était une Américaine. Quand votre grand-mère l’a vue, elle a perdu son sang-froid. Elle s’est mise à crier sur cette femme en la priant de partir immédiatement. Elle était furieuse. Je ne l’avais jamais vue comme ça. Il n’y avait personne dans l’appartement ce jour-là. Rien que votre grand-mère et moi. Ma mère était sortie faire des courses et votre grand-père n’était pas à Paris.
Une femme élégante, portant un vison gris, s’approche de nous dans un effluve de Shalimar. Nous nous taisons jusqu’à ce qu’elle entre dans l’immeuble. Puis Gaspard se rapproche de moi et continue.
— La dame américaine parlait bien français. Elle a hurlé à son tour sur votre grand-mère, elle voulait savoir pourquoi celle-ci n’avait jamais répondu à ses appels, pourquoi elle l’avait fait suivre par un détective privé. Puis, dans un hurlement encore plus puissant que les autres, elle lui a lancé : « Vous avez intérêt à me dire comment est morte Clarisse, et tout de suite ! »
— À quoi ressemblait cette Américaine ? demandé-je en sentant mon pouls s’accélérer.
— La quarantaine, de longs cheveux très blonds, elle était grande et l’air plutôt sportive.
— Et que s’est-il passé ensuite ?
— Votre grand-mère l’a menacée d’appeler la police si elle ne quittait pas les lieux sur-le-champ. Elle m’a demandé de reconduire cette dame, puis elle est sortie et nous a laissés seuls tous les deux. La femme a lâché quelque chose en anglais qui avait l’air horrible, puis elle est partie en claquant la porte, sans même me regarder.
— Pourquoi ne nous l’avez-vous pas dit l’autre jour ?
Il rougit.
— Je ne voulais rien dévoiler du vivant de votre grand-mère. C’est une bonne place, vous savez, monsieur Antoine. J’ai travaillé ici toute ma vie. La paie est bonne. Je respecte votre famille. Je ne voulais pas d’ennuis.
— Il y a autre chose ?
— Oui, ce n’est pas tout, poursuit-il nerveusement. Quand la dame américaine a parlé du détective, j’ai fait le lien avec certains coups de fil pour votre grand-mère, qui venaient d’une agence. Je ne suis pas curieux de nature et je n’avais rien vu d’étrange dans ces appels, mais après la dispute, tout m’est revenu. Et puis, j’ai trouvé quelque chose dans la corbeille à papier de votre grand-mère, le lendemain de la visite de la dame américaine.
Il est de plus en plus rouge.
— Je ne voudrais pas que vous pensiez que…
Je souris.
— Non, rassurez-vous, je ne pense pas que vous avez fait là quelque chose de mal, Gaspard, vous vidiez juste la corbeille, c’est cela ?
Il a l’air tellement soulagé que j’en suis presque amusé.
— J’ai gardé ça pour moi toutes ces années, murmure-t-il.
Il me tend un bout de papier tout chiffonné.
— Mais pourquoi, Gaspard ?
Il se redresse dignement.
— Pour le bien de votre mère. Parce que je la révérais. Et parce que je veux vous aider, monsieur Antoine.
— M’aider ?
Sa voix ne faiblit pas. Ses yeux ont quelque chose de solennel.
— Oui, vous aider à comprendre ce qui s’est passé. Le jour de sa mort.
Je lisse le papier. C’est une facture, adressée à ma grand-mère, de l’agence de détectives privés Viaris, rue d’Amsterdam, dans le 9e arrondissement. Plutôt salée, la note.
— Votre mère était charmante, monsieur Antoine.
— Merci, Gaspard.
Je lui serre la main. Le geste est un peu maladroit, mais il a l’air content. Je le regarde s’en aller, avec son dos tordu et ses cannes de serin. Il disparaît dans l’ascenseur vitré. Je fonce chez moi.
Une rapide vérification sur Internet me confirme ce que je craignais. L’agence Viaris n’existe plus. Elle fait désormais partie d’un groupe plus important : « Rubis Détectives : service d’enquêtes professionnelles, surveillances, filatures, opérations clandestines, vérification d’activité, recouvrements ». Je n’imaginais pas que ce genre de boulot existait encore de nos jours. Et cette agence a l’air florissante, si j’en crois leur site, très graphique et moderne avec des fenêtres inventives. Leurs bureaux sont situés près de l’Opéra. Une adresse mail est indiquée et je décide de leur écrire pour leur expliquer la situation. J’aurais besoin des résultats de l’enquête commandée par ma grand-mère, Blanche Rey, en 1973. Je leur fournis le numéro de dossier indiqué sur la facture et leur demande de me contacter dès que possible. Parce que c’est urgent. Suivi des formules de politesse d’usage et de mon numéro de portable.
J’ai envie d’appeler Mélanie pour lui parler de mes recherches et je suis sur le point de décrocher le téléphone quand je me rends compte qu’il est une heure du matin. Je me tourne et me retourne dans mon lit avant de trouver le sommeil.
Le cancer de mon père. Les prochaines funérailles de ma grand-mère. La grande blonde américaine.
« Vous avez intérêt à me dire comment est morte Clarisse, et tout de suite. »
Le lendemain matin, sur le chemin du bureau, je cherche le numéro de Laurence Dardel, la fille du docteur Dardel. Elle doit avoir la cinquantaine aujourd’hui, j’imagine. Son père était l’ami ainsi que le médecin de la famille. C’est lui qui a signé le certificat de décès de ma mère et qui, selon Gaspard, est arrivé le premier sur les lieux, ce jour fatal de février 1974. Laurence est elle aussi médecin, elle a repris la clientèle de son père. Je ne l’ai pas vue depuis des années, nous ne sommes pas proches. Quand j’appelle à son cabinet, on m’indique qu’elle est à l’hôpital où elle exerce habituellement et qu’il me faut prendre rendez-vous. Mais ce n’est pas possible avant une semaine. Je remercie et raccroche.
Si ma mémoire est bonne, son père habitait rue Spontini, tout près de la rue de Longchamp. Son cabinet médical était à la même adresse. Celui de sa fille se trouve avenue Mozart, mais je suis à peu près sûr qu’elle doit habiter dans l’appartement de la rue Spontini, dont elle a hérité. Quand j’étais enfant, après la mort de ma mère, nous allions y prendre le thé avec Laurence et son mari. Ils avaient des enfants beaucoup plus jeunes que les nôtres. Le nom de l’époux de Laurence Dardel m’échappe, d’autant plus qu’elle a gardé son nom de jeune fille pour ses activités professionnelles. La seule façon de savoir si elle habite toujours rue Spontini, c’est de m’y rendre.
Après une matinée de travail intense, j’appelle mon père à l’heure du déjeuner. C’est Régine qui décroche. Elle m’informe qu’il est avec Solange pour préparer les funérailles de Blanche qui auront lieu à Saint-Pierre de-Chaillot. En fin d’après-midi, j’ai un rendez-vous, un des derniers, avec Parimbert, à son bureau. Le dôme de l’Esprit est en passe d’être achevé, mais il reste quelques petits détails à régler.
Quand j’arrive, je remarque, non sans appréhension, que Rabagny, son insupportable gendre, est là, lui aussi. Je suis abasourdi quand il se lève pour me serrer la main avec un sourire que je ne lui connais pas, véritable panoramique de gencives peu ragoûtantes. Il déclare que j’ai fait un boulot fantastique sur le dôme. Parimbert nous accorde sa grimace de satisfaction habituelle. J’ai l’impression qu’en bon chat du Cheshire, il va se mettre à ronronner. Rabagny est fou d’excitation, son visage cramoisi est en sueur. À mon grand étonnement, il est convaincu que le dôme de l’Esprit, avec sa structure de panneaux lumineux, est « un concept révolutionnaire à la signification artistique et psychologique admirable » et, avec ma permission, il souhaiterait l’exploiter.
— Ça peut être énorme, dit-il en s’étouffant presque, mondial !
Il a déjà tout prévu et beaucoup réfléchi. Il ne me reste plus qu’à signer le contrat, après l’avoir montré, bien sûr, à mon avocat, mais vite, parce qu’il faut se dépêcher, et si tout se passe bien, je serai bientôt milliardaire. Lui aussi. Je ne peux pas en placer une et je n’ai d’autre solution que d’attendre qu’il reprenne son souffle. Il postillonne, le lobe de ses oreilles est de plus en plus rouge. Je range calmement dans ma poche le contrat du siècle en affirmant, d’un ton glacial, que je dois y réfléchir. Plus je me montre froid, plus il accumule les courbettes. Il s’en va enfin, après une seconde terrifiante où il bondit vers moi comme un chiot en mal d’affection qui réclame une caresse.
Parimbert et moi nous mettons au travail. Il n’est pas tout à fait satisfait des sièges qui, trop moelleux selon lui, ne favorisent pas le fulgurant effort intellectuel qui jaillira du dôme. Il préférerait des fauteuils plus durs, plus rigides, dans lesquels on serait forcé de se tenir bien droit comme devant un professeur inflexible. Il ne faut laisser aucune place à la moindre tentation d’indolence.
Malgré sa voix doucereuse, Parimbert est un client exigeant et je quitte son bureau bien plus tard que je ne l’avais prévu, avec la sensation d’avoir été passé à tabac. Je décide de me rendre immédiatement rue Spontini. La circulation est dense à cette heure, mais je ne devrais pas mettre plus de vingt minutes pour y arriver. Je me gare près de l’avenue Victor-Hugo et attends encore un peu dans un café. Je n’ai toujours pas de nouvelles de l’agence Rubis. Je caresse un instant l’idée d’appeler ma sœur pour lui raconter mes intentions, mais à peine ai-je sorti mon téléphone, il sonne. Angèle. Mon cœur bat la chamade, comme à chaque fois. Je suis sur le point de lui révéler que je me rends chez Laurence Dardel, mais je ravale mes mots. Je préfère garder ça pour moi, cette mission, cette quête de la vérité. J’engage la conversation sur un tout autre sujet, le prochain week-end que nous devons passer ensemble.
Puis j’appelle mon père. Sa voix est faible. Comme d’habitude, notre discussion est brève et monotone.
Un mur se dresse entre nous. Nous nous parlons sans rien échanger, ni tendresse ni affection. Pourquoi les choses changeraient-elles aujourd’hui ? Je ne saurais même pas par où commencer. Lui poser des questions sur son cancer ? Lui dire que je suis au courant ? Que je pense à lui ? Impossible. Je n’ai jamais appris à exprimer ce type de sentiments. Et comme à chaque fois, le désespoir me submerge lorsque je raccroche.

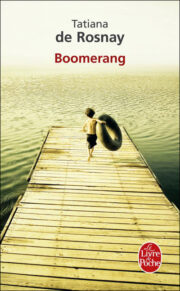
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.