Il est presque vingt heures à présent. Laurence Dardel doit être rentrée chez elle. 50, rue Spontini. Je n’ai pas le code, alors j’attends dehors, en fumant une cigarette. Quelqu’un finit par sortir. Je m’engouffre dans le hall. La liste des habitants, placardée près de la loge de la concierge, indique que les Fourcade-Dardel sont au troisième étage. Ces immeubles bourgeois haussmanniens moquettés de rouge ont tous la même odeur. Parfums appétissants de plats mijotés, de cire d’abeille, d’intérieurs chic et fleuris.
Un garçon d’une vingtaine d’années avec des écouteurs sur les oreilles m’ouvre la porte. Je me présente et demande si sa mère est là. Il n’a pas le temps de me répondre, je reconnais tout de suite Laurence Dardel. Elle me regarde fixement et interroge en souriant :
— Vous êtes Antoine, n’est-ce pas ? Le fils de François ?
Elle me présente Thomas, son fils, qui s’éclipse sans avoir ôté ses écouteurs, puis elle me conduit au salon. Son visage est comme dans mon souvenir, petit, pointu, ses cils blond vénitien, ses cheveux tirés en arrière en un impeccable chignon. Elle m’offre un verre de vin que j’accepte.
— J’ai appris la mort de votre grand-mère dans Le Figaro, dit-elle. Vous devez être bouleversé. Bien sûr, nous assisterons aux funérailles.
— Nous n’étions pas particulièrement proches.
Ses sourcils se lèvent.
— Je croyais que Mélanie et vous étiez très attachés à elle.
— Pas vraiment.
Un silence s’installe. La pièce où nous sommes assis est dans le plus pur style bourgeois. Tout est à sa place. Pas la moindre tache sur la moquette gris perle, pas un grain de poussière à l’horizon. Des meubles d’antiquaire, des aquarelles sans âme, et des rayons de livres médicaux. Et pourtant, cet appartement pourrait être une merveille. Mon œil exercé travaille. Il enlève les faux plafonds, abat les cloisons inutiles, supprime les portes encombrantes. Je sens une odeur tenace de cuisine. C’est l’heure du dîner.
— Comment va votre père ? me demande poliment Laurence.
Elle est médecin après tout. Je n’ai pas besoin de jouer la comédie.
— Il a un cancer.
— Oui, je sais.
— Mais depuis quand ?
Elle pose la main sous son menton et sa bouche s’arrondit.
— C’est mon père qui me l’a dit.
J’ai l’impression qu’on me donne un coup à l’estomac.
— Mais votre père est mort au début des années quatre-vingt.
— Oui, en 1982, pour être exacte.
Elle est charpentée comme son père, avec les mêmes mains courtes et larges.
— Vous voulez dire que mon père était déjà malade en 1982 ?
— Oui, mais les traitements l’ont sauvé. Il a eu une longue période de rémission. Récemment, il a rechuté.
— Êtes-vous son médecin traitant ?
— Non, mais mon père l’était, jusqu’à sa mort.
— Il a l’air très fatigué. Épuisé, même.
— C’est à cause de la chimio, ça assomme.
— Et c’est efficace ?
Elle me regarde dans les yeux.
— Je ne sais pas, Antoine. Je ne suis pas son médecin.
— Alors comment saviez-vous qu’il avait rechuté ?
— Parce que je l’ai vu il n’y a pas longtemps.
— Mon père nous a caché, à Mélanie et à moi, qu’il était malade. Je ne sais même pas quel cancer il a.
Elle n’ajoute aucun commentaire. Je la regarde finir son verre de vin et le reposer.
— Pourquoi êtes-vous venu ici, Antoine ? Je peux vous aider ?
Avant même que je puisse répondre, on entend la porte d’entrée se refermer et un homme corpulent avec un début de calvitie apparaît. Laurence me présente.
— Antoine Rey. Ça fait un bail ! Vous ressemblez de plus en plus à votre père.
Je déteste que les gens disent ça. Son nom me revient soudain. Cyril. Après quelques minutes de conversation sans importance, où il me présente ses condoléances, il quitte la pièce. Laurence regarde discrètement sa montre.
— Je ne voudrais pas abuser de votre temps, Laurence. Oui, j’ai besoin de votre aide.
Je m’interromps. Son regard franc et vif donne à son visage une certaine dureté. Presque masculine.
— Je voudrais consulter le dossier médical de ma mère.
— Je peux savoir pourquoi ?
— Il y a deux ou trois choses que je voudrais vérifier. Son certificat de décès, entre autres.
Elle plisse les yeux.
— Que voulez-vous savoir exactement ?
Je me penche et déclare d’un ton déterminé :
— Je veux savoir comment et où ma mère est morte.
Elle semble sous le choc.
— Est-ce nécessaire ?
Son attitude m’exaspère. Je le lui montre.
— Ça pose un problème ?
Ma voix est cassante. Elle sursaute comme si je venais de la frapper.
— Il n’y a pas de problème, Antoine. Vous n’avez aucune raison de vous mettre en colère.
— Alors vous pouvez me donner son dossier ?
— Il faut que je le cherche. Je ne sais pas trop où il est. Ça peut prendre du temps.
— Environ ?
Elle regarde de nouveau sa montre.
— Les dossiers de mon père sont tous ici, mais je ne peux pas chercher maintenant.
— Quand ?
La tension monte entre nous.
— Dès que possible. Je vous appellerai quand je l’aurai trouvé.
— Très bien, dis-je en me levant.
Elle se met debout également, son visage s’est empourpré.
— Je me souviens très bien de la mort de votre mère. J’avais une vingtaine d’années. Je venais de rencontrer Cyril et j’étais en plein dans mes études de médecine. Mon père m’a appelée pour me dire que Clarisse Rey avait succombé à une rupture d’anévrisme. Qu’elle était déjà morte quand il est arrivé, qu’il n’y avait plus rien à faire.
— J’ai malgré tout besoin de consulter son dossier.
— Remuer le passé est douloureux. Vous êtes assez âgé pour savoir cela.
Je cherche une carte dans une de mes poches et la lui tends.
— Voici mon numéro. Appelez-moi dès que vous aurez mis la main sur le dossier.
Je pars aussi vite que possible, sans dire au revoir, les joues brûlantes. Je referme la porte derrière moi et dévale l’escalier. Je n’attends même pas d’être dehors pour allumer une cigarette.
Malgré mon ressentiment, malgré la peur de l’inconnu, en courant vers ma voiture dans la nuit froide je me sens proche de ma mère, plus proche que jamais.
L’agence Rubis m’appelle le lendemain, en fin de journée. Au bout du fil, une jeune femme charmante et efficace, Delphine. Elle peut me fournir le dossier sans problème, il date de plus de trente ans… J’ai juste besoin de passer dans leurs locaux pour qu’on vérifie mon identité et que je signe un ou deux papiers.
La circulation est difficile et le trajet interminable, de Montparnasse à l’Opéra. Coincé dans les embouteillages, j’écoute la radio en respirant profondément pour ne pas laisser l’angoisse s’installer. Ces dernières semaines, je n’ai pas très bien dormi. Des nuits blanches pleines de questions en suspens. À me sentir oppressé. J’ai sans cesse envie d’appeler ma sœur pour lui révéler ce que j’ai appris, mais je repousse encore le moment. Je veux moi-même connaître toute l’histoire d’abord. Je veux avoir toutes les cartes en main. À commencer par le dossier Rey que l’agence Rubis s’apprête à me remettre. Puis le dossier médical du docteur Dardel. Enfin, je pourrai réfléchir et trouverai les mots pour le dire à Mélanie.
Delphine m’oblige à attendre dix bonnes minutes dans une salle d’attente cerise et ivoire un rien tape-à-l’œil. C’est donc au milieu de ce genre de décor que les épouses soupçonnant leur mari d’adultère attendent dans la fébrilité et l’angoisse. Il n’y a personne à cette heure tardive. Delphine apparaît enfin, tout en rondeurs, vêtue de rouge, avec un large sourire. Les détectives privés ne ressemblent guère à Columbo de nos jours.
Je signe une décharge et présente ma carte d’identité. Elle me tend une grande enveloppe scellée à la cire. Personne ne l’a ouverte depuis des années. Le nom « Rey » est tapé dessus en gros caractères noirs. Elle m’informe que cette enveloppe contient les originaux de ce qui a été envoyé à ma grand-mère. Une fois revenu dans ma voiture ; je n’ai qu’une hâte, l’ouvrir, mais je m’oblige à patienter.
À la maison, je me fais un café, j’allume une cigarette et m’installe à la table de la cuisine. Puis je respire un bon coup. Il est encore temps de jeter cette enveloppe. De ne jamais l’ouvrir. De ne jamais savoir. Je parcours des yeux la pièce familière. La bouilloire fumante, les miettes sur le plan de travail, un verre de lait à moitié bu. L’appartement est calme. Lucas est certainement en train de dormir. Margaux doit être encore devant son ordinateur. J’attends, sans bouger. Longtemps.
Puis je prends un couteau et j’ouvre l’enveloppe. Le sceau cède.
Des coupures de presse en noir et blanc provenant de Vogue et Jours de France glissent de l’enveloppe. Mes parents à divers cocktails, dîners mondains, événements sportifs. 1967, 1969, 1971, 1972. Monsieur et Madame François Rey. Madame portant du Dior, du Jacques Fath, du Schiaparelli. Lui avait-on prêté ces robes ? Je ne me rappelle pas l’avoir jamais vue les porter. Comme elle est belle ! Si fraîche, si jolie.
Encore des coupures de presse, cette fois extraites du Monde et du Figaro. Mon père au procès Vallombreux. Et deux autres, toutes petites : mon faire-part de naissance et celui de Mélanie, dans le carnet du jour du Figaro. Puis je tombe sur une enveloppe kraft qui contient trois clichés noir et blanc et deux en couleurs. Des gros plans de mauvaise qualité. Je n’ai cependant aucun mal à reconnaître ma mère. Elle est en compagnie d’une grande femme aux longs cheveux blond platine qui a l’air plus âgée qu’elle. Trois des photos ont été prises dans les rues de Paris. Ma mère regarde cette femme blonde en souriant. Elles ne se tiennent pas la main, mais il est évident qu’elles sont proches. C’est l’automne, ou peut-être l’hiver, elles portent toutes les deux des manteaux. Les deux photos couleur ont été prises dans un restaurant ou un bar d’hôtel. Elles sont assises à une table. La femme blonde fume. Elle est vêtue d’un chemisier violet et porte un collier de perles. En face, ma mère a le visage sombre, les yeux qui regardent vers le bas et la bouche serrée. Sur un des deux clichés, la femme blonde caresse la joue de ma mère.
J’étale soigneusement toutes les photos sur la table de la cuisine. Je les examine un moment. On dirait un patchwork. Ma mère et cette femme. Je sais que c’est elle que Mélanie a vue dans le lit avec notre mère. C’est cette Américaine dont m’a parlé Gaspard.
Dans l’enveloppe, se trouve une lettre dactylographiée adressée à ma grand-mère par l’Agence Viaris, datée du 12 janvier 1974. Un mois avant la mort de ma mère.
Madame,
Selon vos instructions et les termes de notre contrat, voici les informations que vous avez demandées concernant Clarisse Rey, née Élzyière, et Mlle June Ashby. Mlle Ashby, de nationalité américaine, est née en 1925 à Milwaukee, dans le Wisconsin, et possède une galerie d’art à New York, sur la 57e rue. Elle vient à Paris tous les mois pour ses affaires et séjourne à l’hôtel Regina, place des Pyramides, dans le 1er arrondissement.
De septembre à décembre 1973, Mlle Ashby et Mme Rey se sont rencontrées à l’hôtel Regina chaque fois que Mlle Ashby se trouvait à Paris, cinq au total. L’après-midi, Mme Rey montait directement dans la chambre de Mlle Ashby pour en ressortir quelques heures plus tard. Le 4 décembre, Mme Rey est venue après l’heure du dîner pour ne quitter l’hôtel que le lendemain matin à l’aube.
Veuillez trouver votre facture ci-jointe.
Agence Viaris, Détectives privés.
J’examine les photos de June Ashby. Assez belle. Elle a les pommettes hautes et des épaules de nageuse. Rien d’« hommasse » en elle. Plutôt quelque chose d’extrêmement féminin, au contraire, des attaches fines, un collier de perles autour du cou, des boucles d’oreilles. Qu’a-t-elle pu dire en anglais à Blanche le jour de leur confrontation, ces mots qui avaient l’air si horribles selon Gaspard. Je me demande où elle se trouve à présent et si elle se souvient de ma mère.
Je sens une présence et je me retourne brutalement. C’est Margaux. Elle se tient juste derrière moi en chemise de nuit. Avec sa queue-de-cheval, elle ressemble à Astrid.
— C’est quoi tout ça, papa ?
Ma première réaction est de vouloir cacher les photos, de les fourrer dans l’enveloppe et d’inventer je ne sais quelle histoire. Mais je n’en fais rien. Il est trop tard pour mentir. Trop tard pour se taire. Trop tard pour jouer les ignorants.

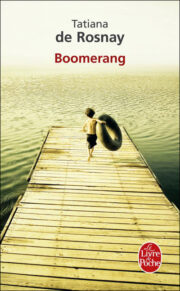
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.