— Non, je n’ai pas pu parler à mon père. Impossible.
— Ne t’en veux pas, Antoine. Ne te rends pas les choses encore plus douloureuses.
L’envie de dormir me saisit brusquement, comme si on jetait une épaisse couverture sur ma tête. Angèle me met au lit et je m’émerveille de la douceur de ses gestes, de ses mains attentives et respectueuses qui affrontent la mort tous les jours. Je sombre dans un sommeil agité. J’ai l’impression de m’enfoncer dans une mer trouble et sans fond. Je fais des rêves étranges. Ma mère à genoux dans son manteau rouge face au train. Mon père avec son sourire heureux d’autrefois, escaladant un sommet dangereux, raide et enneigé, le visage brûlé par le soleil. Mélanie dans une longue robe noire, flottant à la surface d’une piscine, noire elle aussi, les bras ouverts, des lunettes de soleil sur le nez. Et moi, tentant de me frayer un passage dans une forêt touffue, pieds nus dans un sol boueux et grouillant d’insectes.
Quand je me réveille, il fait jour et, en un instant d’affolement, je ne sais pas où je suis. Puis tout me revient. Je suis chez Angèle. Dans cette maison remarquablement rénovée du XIXe siècle, qui était, autrefois, une petite école primaire. Près de la rivière, au centre de Clisson, dans ce pittoresque village historique proche de Nantes dont je n’avais jamais entendu parler avant de la rencontrer. Du lierre grimpe sur la façade de pierre, deux grandes cheminées dépassent du toit de tuiles. Et l’ancienne cour de récréation est devenue, à l’abri de ses murs, un jardin enchanteur. Je suis allongé dans le lit confortable d’Angèle. Mais elle n’est pas près de moi. Sa place est froide. Je me lève et descends. Je suis accueilli par une odeur appétissante de café et de tartines grillées. Une lumière pâle et citronnée entre par les fenêtres. Dehors, le jardin est recouvert d’une fine pellicule de givre, on dirait le glaçage d’un gâteau. De là où je me tiens, je ne vois que le sommet des ruines du château fort de Clisson.
Angèle est assise à table. Un genou replié sur sa chaise, elle est plongée dans la lecture d’un document. Son ordinateur est ouvert près d’elle. En m’approchant, je vois qu’elle étudie le dossier médical de ma mère. Elle lève un œil. Ses yeux sont cernés. Elle n’a pas dû beaucoup dormir.
— Que fais-tu ?
— Je t’attendais. Je ne voulais pas te réveiller.
Elle se lève, me prépare une tasse de café. Elle est déjà habillée. Dans sa tenue habituelle. Jean et col roulé noirs, bottes.
— On dirait que tu n’as pas beaucoup dormi.
— J’ai parcouru le dossier médical de ta mère.
Son ton trahit une révélation à venir.
— Et alors ? Tu as remarqué quelque chose ?
— Oui, dit-elle. Assieds-toi, Antoine.
Je m’installe à côté d’elle. Il fait chaud dans la cuisine ensoleillée. Après ma nuit agitée de mauvais rêves, je ne suis pas sûr d’être prêt à affronter une nouvelle épreuve. Je rassemble mes forces.
— Et qu’est-ce que tu as vu dans ce dossier ?
— Tu sais que je ne suis pas médecin, mais je travaille dans un hôpital et je vois des morts tous les jours. Je lis leurs dossiers, je parle aux docteurs. J’ai bien étudié le dossier de ta mère pendant que tu dormais. J’ai pris des notes. Et j’ai fait des recherches sur Internet. J’ai aussi envoyé des mails à des amis médecins.
— Et ? insisté-je, soudain incapable d’avaler mon café.
— Ta mère avait commencé à avoir des migraines deux ans avant sa mort. Pas très fréquentes, mais fortes. Tu t’en souviens ?
— Une ou deux fois peut-être… Elle avait dû rester allongée dans le noir et le docteur Dardel était venu l’examiner.
— Quelques jours avant sa mort, elle a eu une crise et elle a vu le docteur. Regarde, c’est là.
Elle me tend le document photocopié où je reconnais l’écriture tordue du docteur Dardel. J’ai déjà vu ce document, il était dans ses dernières notes avant la mort de Clarisse. 7 février 1974. Migraine. Nausée, vomissements, douleurs oculaires. Vision dédoublée.
— Oui, j’ai déjà lu ces notes. Ça veut dire quoi ?
— Que sais-tu des anévrismes, Antoine ?
— C’est comme une petite bulle, une petite cloque qui se forme à la surface d’une artère cérébrale. La paroi d’un anévrisme est plus fine que celle d’une artère. Le danger survient quand cette membrane se rompt.
— C’est pas mal.
Elle se sert à nouveau du café.
— Pourquoi tu me demandes ça ?
— Parce que je crois que ta mère est en effet morte d’une rupture d’anévrisme.
Je la fixe, interdit. Puis je finis par balbutier :
— Alors, elle ne se serait pas battue avec Blanche ?
— Je te dis juste ce que je crois. C’est tout. C’est toi qui as le dernier mot dans cette histoire. C’est ta vérité.
— Tu crois que j’exagère, que je me fais des idées ? Que je suis parano ?
— Non, bien sûr que non.
Elle pose sa main sur mon épaule.
— Ne t’emballe pas. Ta grand-mère était une vieille bique homophobe, cela ne fait aucun doute. Mais écoute quand même ce que j’ai à te dire, d’accord ? Le 7 février 1974, le docteur Dardel examine ta mère avenue Kléber. Elle a une violente migraine. Elle est au lit, dans le noir. Il lui prescrit le médicament qu’elle prend habituellement et le lendemain, la crise est passée. Enfin, c’est ce qu’il pense. C’est ce qu’elle pense aussi. Mais un anévrisme cérébral peut enfler, lentement et sûrement, et peut-être était-il là depuis un moment, sans que personne ne s’en doute. Quand un anévrisme enfle, avant d’exploser et de saigner, il fait pression sur le cerveau ou sur le nerf optique, les muscles du visage ou du cou. Migraine, nausées, vomissements, douleurs oculaires, vision dédoublée. Si le docteur Dardel avait été un peu plus jeune et un peu plus dans le coup, avec ce genre de symptômes, il aurait envoyé ta mère à l’hôpital immédiatement. Mes deux amis médecins me l’ont confirmé par mail. Peut-être le docteur Dardel était-il débordé ce jour-là, peut-être était-il préoccupé par d’autres cas urgents, peut-être a-t-il sous-estimé la situation. Toujours est-il que l’anévrisme a grossi et que le 12 février, c’est-à-dire cinq jours plus tard, il s’est rompu.
— Comment crois-tu que c’est arrivé ? Dis-moi.
— C’est à peu près la même histoire. Elle allait à pied chez ta grand-mère ce matin-là, dans son manteau rouge. Elle ne devait pas se sentir très bien, pas bien du tout même. Elle devait encore avoir la nausée, peut-être avait-elle vomi avant. Elle avait sans doute la tête qui tournait et la démarche mal assurée. Sa nuque était probablement raide. Mais elle a voulu affronter ta grand-mère, malgré tout, pensant sans doute que c’étaient les derniers soubresauts de sa migraine. Elle ne se souciait pas de sa santé. Elle ne pensait qu’à June. À June et à ta grand-mère.
Je me cache le visage dans les mains. Imaginer ma mère souffrante remontant vers l’avenue Georges-Mandel, avec son corps qu’elle avait du mal à traîner, partant braver Blanche comme un courageux petit soldat, est insupportable.
— Continue.
— L’histoire se déroule à peu près comme la tienne. Gaspard ouvre la porte, il remarque qu’elle a mauvaise mine, qu’elle est essoufflée. Elle n’a qu’un but, affronter ta grand-mère. Blanche aussi a sans doute remarqué quelque chose, la pâleur alarmante du visage de Clarisse, sa façon de parler, son manque d’équilibre. La conversation est la même. Blanche sort les photos, le rapport du détective, et Clarisse campe sur sa décision. Elle ne cessera pas de voir June, elle aime June. Et soudain, l’accident. En un éclair. Une douleur intense. Comme un coup de pistolet dans son crâne. Clarisse vacille, porte les mains à ses tempes et s’écroule. Sur le coin de la table de verre peut-être. Mais, de toute façon, elle est déjà morte. Ta grand-mère ne peut rien faire. Le médecin non plus. Quand il arrive, il comprend. Il sait qu’il a commis une erreur en ne l’envoyant pas à l’hôpital… Il a dû porter ce poids toute sa vie.
À présent, je comprends la réticence de Laurence Dardel à me donner ce dossier. Elle savait qu’un œil expert décèlerait rapidement la faute de son père.
Angèle vient s’asseoir sur mes genoux, ce qui n’est pas facile vu la longueur de ses jambes.
— Est-ce que ça t’éclaire un peu ? me demande-t-elle tendrement.
Je l’enlace en posant mon menton au creux de son cou.
— Oui, je crois. Ce qui fait mal, c’est de ne pas savoir.
Elle me caresse les cheveux d’une main apaisante.
— Quand je suis rentrée de l’école ce jour-là, le jour où mon père s’est tiré une balle dans la tête, il n’y avait aucun mot. Il n’avait rien laissé. Ça nous a rendues dingues, ma mère et moi. Juste avant sa mort, il y a quelques années, elle m’a redit comme c’était terrible de n’avoir jamais su pourquoi il s’était suicidé, même après toutes ces années. Il n’avait pas de maîtresse, pas de problèmes financiers. Pas de soucis de santé. Rien.
Je la serre contre moi en pensant à la jeune fille de treize ans qui a découvert son père mort. Sans un mot. Sans explication. Je frissonne.
— On n’a jamais su pourquoi. Il a fallu vivre avec ça. J’ai appris à le faire. Ça n’a pas été facile, mais j’ai surmonté ma douleur.
Et je comprends, à ses mots, que c’est précisément ce que je vais devoir apprendre désormais.
— C’est l’heure, dit Angèle d’un air enjoué.
Nous prenons un café après avoir déjeuné dehors, sur le patio, devant la cuisine. Le soleil est exceptionnellement chaud. Le jardin revient peu à peu à la vie. Le printemps n’est pas loin, il caresse déjà mes narines, mes pauvres narines polluées de Parisien. C’est un parfum d’herbe, d’humidité, de fraîcheur, un parfum piquant. Délicieux.
Je la regarde, surpris.
— L’heure de quoi ?
— L’heure de partir.
— Où ?
Elle sourit.
— Tu verras. Enfile quelque chose de chaud. Le vent réserve parfois des surprises.
— Qu’est-ce que tu manigances ?
— Tu aimerais bien savoir, hein ?
Au début, j’étais mal à l’aise à l’arrière de la Harley. Je n’avais pas l’habitude des motos, je ne savais jamais de quel côté me pencher et, en bon garçon de la ville, j’étais convaincu que les deux-roues étaient trop dangereux pour que je leur accorde la moindre confiance. Angèle faisait le trajet en Harley tous les jours de Clisson à l’hôpital du Loroux, qu’il pleuve ou qu’il vente. Elle détestait les voitures, les embouteillages.
Elle avait acheté sa première Harley à vingt ans. Celle-ci était sa quatrième.
Une jolie femme sur une Harley vintage, ça ne passe pas inaperçu, j’ai pu m’en rendre compte. Le ronronnement caractéristique du moteur attire l’attention, comme la créature tout en courbes et en cuir noir juchée sur l’engin. Rouler à l’arrière est bien plus agréable que je ne l’imaginais. Je suis rivé à elle dans une position explicite, mes cuisses l’enserrent, mon sexe est collé à son cul divin, mon ventre et ma poitrine épousent les courbes de ses hanches et de son dos.
— Allez, le Parisien, on n’a pas toute la journée ! crie-t-elle en me jetant un casque.
— On nous attend ?
— Tu parles si on nous attend ! dit-elle pleine d’enthousiasme, en regardant sa montre. Et si tu ne te bouges pas, on sera en retard.
Nous filons le long de mauvaises routes de campagne bordées de champs pendant environ une heure. Le temps me parait court lové contre Angèle, grisé par les vibrations de la Harley et le soleil qui me caresse le dos.
Ce n’est qu’en voyant les panneaux annonçant le passage du Gois que je comprends où nous sommes. Je n’avais jamais réalisé à quel point Clisson est près de Noirmoutier. Le paysage me semble si différent à cette saison, des nuances brun et beige, pas de vert. Le sable aussi est plus foncé, plus terreux, mais il n’en est pas moins beau. Les premières balises semblent me saluer et les mouettes qui volent et crient au-dessus de ma tête ont l’air de se souvenir de moi. La grève s’étire au loin, ligne brune parsemée de gris, touchée par l’éclat de la mer bleu marine qui scintille sous le soleil, jonchée de coquillages et d’algues, de déchets divers, de bouchons de pêche et de bois flotté.
Il n’y a plus une voiture sur le passage. C’est l’heure de la marée haute, les premières vagues commencent à recouvrir la chaussée. L’île paraît déserte, contrairement à l’été, quand des foules denses se pressent pour observer la mer dévorer la terre. Angèle ne ralentit pas, elle accélère. Je lui tape sur l’épaule pour attirer son attention, mais elle m’ignore superbement, concentrée sur la Harley. Les rares personnes qui sont là nous montrent du doigt, l’air stupéfait, tandis que nous filons comme l’éclair. C’est comme si je les entendais dire : « Non ! Vous croyez qu’ils vont passer le Gois ? » Je tire sur sa veste, plus fort cette fois. Quelqu’un klaxonne pour nous prévenir, mais il est trop tard, les roues de la Harley font gicler l’eau de mer, en grandes gerbes, de chaque côté de la chaussée. Sait-elle vraiment ce qu’elle fait ? Enfant, j’ai lu trop d’histoires d’accidents sur le Gois pour ne pas penser que ce qu’elle tente est fou. Je m’accroche à elle comme à une bouée, priant pour que la Harley ne dérape pas, ne nous envoie pas la tête la première dans la mer, priant pour que le moteur ne soit pas noyé par une de ces vagues écumeuses qui grossissent de minute en minute. Angèle avale les quatre kilomètres en douceur. Je parierais que ce n’est pas la première fois qu’elle s’amuse à ça.

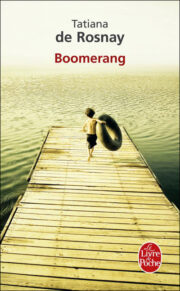
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.