C’est merveilleux, exaltant. Je me sens en sécurité soudain, absolument en sécurité, plus que je ne me suis senti dans toute ma vie, depuis la main de mon père dans mon dos. Protégé. Mon corps contre le sien, tandis que nous glissons sur l’eau, sur ce qui fut une route. L’île se rapproche, j’aperçois les balises, tels des phares guidant un bateau vers son havre. J’aimerais que ce moment dure toujours, que sa beauté et sa perfection ne me quittent jamais. Nous atteignons la terre sous les applaudissements et les cris des promeneurs qui sont regroupés près de la croix plantée à l’entrée du passage.
Angèle coupe le moteur et retire son casque.
— Je parie que tu as eu une sacrée trouille, me taquine-t-elle avec un grand sourire.
— Non ! me récrié-je en posant mon casque sur le sol pour pouvoir l’embrasser sauvagement, toujours sous une nouvelle salve d’applaudissements. Je n’ai pas eu peur, j’ai confiance en toi.
— Tu peux. La première fois que j’ai fait ça, j’avais quinze ans. C’était avec la Ducati d’un ami.
— Tu pilotais des Ducati à quinze ans ?
— Tu serais surpris de ce que je faisais à cet âge-là.
— Pas envie de savoir, dis-je avec désinvolture. Et comment on retourne chez toi maintenant ?
— On prendra le pont. Moins romantique, mais bon.
— Carrément moins romantique. Et puis, je ne serais pas contre, me retrouver coincé sur une balise avec toi. On ne s’ennuierait certainement pas…
Le gigantesque arc du pont est visible de là où nous sommes, bien qu’il se trouve à cinq kilomètres. La route a complètement disparu et la mer, immense et scintillante, a repris ses droits.
— Je venais ici avec ma mère. Elle adorait le Gois.
— Et moi, avec mon père, dit-elle. Nous avons passé quelques étés ici, nous aussi, quand j’étais enfant. Mais pas au bois de la Chaise, c’était trop chic pour nous, monsieur ! Nous allions à la plage de la Guérinière. Mon père était de la Roche-sur-Yon. Il connaissait l’endroit comme sa poche.
— Alors peut-être nous sommes-nous croisés ici, au Gois, quand nous étions petits ?
— Peut-être.
Nous nous asseyons sur la butte herbeuse près de la croix, épaule contre épaule. Nous partageons une cigarette. Nous sommes tout près de l’endroit où je me suis assis avec Mélanie, le jour de l’accident. Je pense à elle, enfermée dans son ignorance, par sa propre volonté. Je pense à tout ce que j’ai appris, qu’elle ne saura jamais, sauf si elle me questionne. Je prends la main d’Angèle et l’embrasse. Je pense à tous ces « si » qui m’ont conduit jusqu’à cette main, jusqu’à ce baiser. Si je n’avais pas organisé ce week-end à Noirmoutier pour les quarante ans de Mélanie. Si Mélanie n’avait pas eu ce flash-back. S’il n’y avait pas eu l’accident. Si Gaspard n’avait pas vendu la mèche. S’il n’avait pas conservé cette facture. Et tant d’autres « si ». Si le docteur Dardel avait envoyé ma mère à l’hôpital le 7 février, jour de sa migraine, aurait-elle été sauvée ? Aurait-elle quitté mon père pour vivre avec June ? À Paris ? À New York ?
— Arrête un peu.
C’est la voix d’Angèle.
— Arrête quoi ?
Elle pose son menton sur ses genoux. Elle contemple la mer avec le vent dans les cheveux. Elle a l’air si jeune tout à coup. Puis elle me murmure :
— Tu sais, Antoine, j’ai cherché partout ce mot. Alors que mon père était étendu là, son sang et sa cervelle éclaboussés dans tous les coins de la cuisine, j’ai cherché ce mot en hurlant, en pleurant, en tremblant des pieds à la tête. J’ai regardé du sol au plafond, j’ai passé cette foutue baraque au peigne fin, le jardin, le garage, en pensant à ma mère qui n’allait pas tarder à rentrer de chez le notaire où elle travaillait. Il fallait que je trouve ce mot avant qu’elle arrive. Mais rien. Pas de mot d’adieu. Et ce « pourquoi » monstrueux qui enflait et me hantait. Était-il malheureux ? Que n’avions-nous pas vu ? Avions-nous été à ce point aveugles, ma mère, ma sœur et moi ? Et si j’avais remarqué quelque chose ? Et si j’étais rentrée plus tôt de l’école ? Et si je n’avais pas été à l’école du tout ? Se serait-il suicidé ? Ou serait-il encore en vie aujourd’hui ?
Je vois où elle veut en venir. Elle poursuit, d’une voix plus ferme, mais où je perçois encore la vibration émouvante de la douleur.
— Mon père était un homme calme, réservé, comme toi, bien plus taiseux que ma mère. Il s’appelait Michel. Je lui ressemble. Les yeux surtout. Il ne semblait pas déprimé, il ne picolait pas, était en bonne santé, sportif, il aimait lire – tous les livres qui se trouvent chez moi sont à lui –, il avait beaucoup d’admiration pour Chateaubriand, Romain Gary, il aimait la nature et la Vendée, la mer. Il avait l’air d’un type tranquille, heureux. Le jour où je l’ai trouvé mort, il portait son plus beau costume, un costume gris qu’il ne mettait que pour les grandes occasions, à Noël, au Nouvel An. Il portait aussi une cravate et ses plus belles chaussures, des noires. Ce n’était pas une tenue de tous les jours. Il travaillait dans une librairie. Il s’habillait le plus souvent avec des pantalons de velours et des pull-overs. Il était assis à table quand il s’est tiré une balle dans la tête. J’ai pensé que le mot était coincé sous son corps, puisqu’il était tombé en avant après le coup, mais je n’ai pas osé le toucher. J’avais peur des cadavres, à l’époque, pas comme maintenant. Mais quand on est venu enlever son corps, il n’y avait sous lui aucune note. Rien. Alors j’ai pensé que ce mot d’adieu arriverait au courrier, qu’il l’avait peut-être posté avant de se tuer, mais là non plus, rien. C’est seulement quand j’ai débuté dans mon métier et que j’ai eu mon premier suicidé que, de façon tout à fait inattendue, j’ai pu commencer à faire mon deuil. Mais c’était plus de dix ans après sa mort. Je reconnaissais mon angoisse et mon désespoir dans les familles des suicidés dont j’avais à m’occuper. J’écoutais leurs histoires, je partageais leur peine, parfois il m’arrivait de pleurer avec eux. Beaucoup m’ont raconté pourquoi leurs proches s’étaient suicidés, beaucoup savaient. Peine de cœur, maladie, désespoir, anxiété, peur, les raisons étaient diverses. Puis un jour, alors que je m’occupais du corps d’un homme de l’âge de mon père, qui s’était suicidé parce qu’il ne supportait plus la pression à son boulot, ça m’a frappé d’un coup. Cet homme était mort, comme mon père. Sa famille savait pourquoi il avait commis ce geste, la mienne non. Mais quelle différence cela faisait-il ? La mort était au bout, dans un cas comme dans l’autre. Il ne restait qu’un cadavre à embaumer, à mettre dans un cercueil et à enterrer. Quelques prières et le temps du deuil. Savoir ne me rendrait pas mon père et n’adoucirait pas le chagrin. Savoir ne rend jamais la mort plus facile.
Une petite larme tremble au bord de sa paupière. Je l’essuie avec mon pouce.
— Tu es une femme merveilleuse, Angèle Rouvatier.
— Pas d’eau de rose avec moi, s’il te plaît, me prévient-elle. Je déteste ça. Allons-y, il se fait tard.
Elle se lève et se dirige vers la Harley. Je la regarde mettre son casque, ses gants, et démarrer l’engin d’un coup de pied sec. Le soleil a baissé et il commence à faire froid.
Nous préparons tranquillement le dîner tous les deux, côte à côte. Une soupe de légumes (poireaux, carottes, pommes de terre), du citron, du thym du jardin, un poulet rôti avec du riz basmati, un crumble aux pommes. Et pour arroser le tout, une bouteille de chablis bien frais. La maison est chaleureuse, accueillante. Je commence à prendre conscience du bonheur que m’offre son calme, sa taille, sa simplicité bucolique. Je ne pensais pas qu’un citadin comme moi pourrait apprécier un décor si rustique. Serais-je capable de vivre ici avec Angèle ? De nos jours, avec les ordinateurs, Internet, les portables et le TGV, ce type de vie est envisageable. Je pense à ce que l’avenir me réserve. Rabagny est sur le point de me proposer un contrat lucratif sur un brevet issu du dôme de l’Esprit. Je vais bientôt retravailler pour lui et pour Parimbert, sur un projet très ambitieux, à l’échelle européenne, qui va faire rentrer pas mal d’argent. Rien ne m’empêche de bosser d’ici. C’est une question d’organisation.
Mais est-ce qu’Angèle veut de moi chez elle ? Je l’entends déjà. Je ne suis pas du genre à me marier. Je ne suis pas très famille. Je ne suis pas jalouse. Peut-être que le charme d’Angèle tient à ce que je sais que je ne la posséderai jamais. J’ai beau adorer faire l’amour avec elle, ce qu’elle apprécie apparemment, et l’émouvoir, parce que l’histoire de ma mère l’a bouleversée, elle ne voudra jamais vivre avec moi. Elle est comme le chat dans les Histoires comme ça de Kipling. Le chat qui allait son chemin tout seul.
Après le dîner, je me souviens subitement du DVD sur lequel a été transféré le film en super-huit. Comment ai-je pu l’oublier ? Il est dans le salon avec les photos et les lettres. Je cours le chercher et le tends à Angèle.
— Qu’est-ce que c’est ? demande-t-elle.
J’explique que c’est un film que l’associée de June, Donna Rogers, m’a envoyé de New York. Elle le met dans son ordinateur.
— Je crois qu’il vaut mieux que tu le regardes seul, murmure-t-elle en me caressant les cheveux, et avant même que je ne me décide, elle a déjà jeté son perfecto sur ses épaules et pris la direction du jardin.
Je m’assois devant l’écran et j’attends fébrilement. La première image qui apparaît montre le visage de ma mère en gros plan, dans la lumière du soleil. Ses paupières sont fermées comme si elle dormait, mais un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Très lentement, elle ouvre les yeux, pose sa main devant pour se faire de l’ombre. Entre la joie et la douleur, je les admire, incrédule. Ils sont si verts, plus verts que ceux de Mélanie, doux, aimants, lumineux. Tellement charmants.
Je n’ai jamais vu de films avec ma mère. Et la voilà, sur l’écran de l’ordinateur d’Angèle, miraculeusement ressuscitée. Je peux à peine respirer, paralysé, entre euphorie et émotion. Des larmes incontrôlables coulent le long de mes joues que j’essuie immédiatement. Le film est d’une qualité étonnante. Moi qui m’attendais à de pauvres images délavées et rayées… À présent, elle marche sur la plage. Mon pouls s’accélère. C’est la plage des Dames, l’estacade, la tour Plantier, les cabines en bois. Elle porte son drôle de maillot de bain orange. Je ressens une étrange sensation. Je sais que je suis là, dans le coin, je fais un château de sable, je l’appelle, mais June ne me filme pas. Ce n’est pas moi qui l’intéresse. Le film passe aux balises du Gois et je vois ma mère, de loin, frêle silhouette marchant le long de la chaussée à marée basse, un jour de vent et de grisaille. Elle porte un pull blanc et un short, ses cheveux noirs flottent dans le vent. Elle s’approche, les mains dans les poches, avec son inoubliable démarche de danseuse, les pieds légèrement tournés vers l’extérieur, le dos et le cou bien droits. Si gracieuse, si aérienne. Elle marche là où Angèle et moi avons roulé en moto cet après-midi, elle marche vers l’île, vers la croix. Son visage est flou, puis de plus en plus net. Elle sourit. Elle se met soudain à courir vers la caméra, rit, relève une mèche qui lui tombe devant les yeux. Son sourire est plein d’amour, si plein d’amour. Puis elle place une de ses mains bronzées sur son cœur, y dépose un baiser et brandit sa paume devant la caméra. Ce petit carré de peau rose est la dernière image du film. La dernière image que je vois d’elle.
Je clique pour redémarrer la lecture, hypnotisé par les images de ma mère vivante, qui bouge, respire, sourit. Je ne saurais dire combien de fois je le visionne. Encore et encore. Jusqu’à ce que je le connaisse par cœur, jusqu’à avoir l’impression d’être là-bas avec elle. Jusqu’à ce que je ne supporte plus de la voir tant c’est douloureux. Mes yeux sont mouillés de larmes et les images se brouillent. Ma mère me manque tant que j’ai envie de m’étendre sur le sol pour pleurer. Ma mère n’a pas connu et ne connaîtra jamais mes enfants. Ma mère ne saura jamais quel homme je suis devenu. Moi, son fils. Un homme qui mène sa vie comme il peut, un homme qui tente de faire de son mieux. Quelque chose est libéré en moi et s’échappe. La douleur s’en va. Demeure à sa place une tristesse qui, je le sais, m’habitera toujours.
Je sors le DVD et le replace dans sa pochette. La porte qui mène au jardin est entrouverte, je m’y glisse. L’air est frais et parfumé. Les étoiles scintillent. On entend un chien aboyer au loin. Angèle est assise sur un banc de pierre. Elle observe les étoiles.
— Tu veux m’en parler ? demande-t-elle.
— Non.
— Ça va ?
— Oui.
Elle s’appuie contre moi, je l’enlace et nous demeurons là, à respirer l’air frais et calme de la nuit, où résonnent les aboiements d’un chien, à contempler la voûte étoilée. Je pense à la dernière image, la paume de ma mère devant la caméra. Je pense à la Harley volant au-dessus du Gois. Au dos souple d’Angèle contre ma poitrine, à ses mains gantées tenant avec sûreté le large guidon. Et je me sens protégé, à l’abri, comme cet après-midi. Parce que je sais que cette femme, avec qui je vais passer ou non le restant de mes jours, qui peut me mettre dehors demain matin ou me garder à jamais, cette femme extraordinaire dont la mort est le quotidien vient de m’offrir le baiser de la vie.

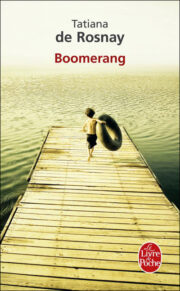
"Boomerang" отзывы
Отзывы читателей о книге "Boomerang". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Boomerang" друзьям в соцсетях.