Le déguisement amusa Hortense. Elle et Félicia étaient de même taille et celle-ci possédait plusieurs jeux d’habits masculins.
— C’est très commode quand on veut passer inaperçue… ou quand on veut se faire remarquer comme la baronne Dudevant qui d’ailleurs vient de décider de prendre un pseudonyme : elle se fait appeler George… Sand, je crois bien. Tout dépend de l’endroit où l’on se rend : dans un salon, nous ferions sensation mais dans un café, à cette heure-ci, c’est habillées comme d’habitude qu’on nous remarquerait…
Une chemise blanche à jabot, une redingote prune cintrée et quelque peu juponnante, un pantalon gris firent d’Hortense un personnage hybride et charmant. La difficulté se présenta avec les chaussures mais la jeune femme possédait des escarpins plats qui s’accommodèrent assez bien du pantalon à sous-pieds. Quand Félicia eut tressé ses cheveux, les eut ramenés au-dessus de la tête et eut placé dessus un haut-de-forme gris en laissant dépasser tout autour quelques mèches, Hortense ressembla à un très jeune homme qui d’ailleurs ne manquait pas d’allure. Une badine à tenir sous le bras compléta la transformation.
Félicia, pour sa part, avait choisi un costume vert bouteille et un pantalon noir et Hortense s’amusa beaucoup en la voyant coller autour de ses maxillaires un mince collier de barbe postiche qui en faisait un fort beau garçon, suffisamment viril pour être crédible.
Ainsi équipées, les deux amies quittèrent l’hôtel aussi discrètement que possible. Envoyé en éclaireur, Timour avait rapporté qu’aucune présence suspecte, aucune voiture inquiétante ne se trouvaient aux alentours. Elles partirent à pied, au pas de promenade, et gagnèrent le boulevard des Invalides où elles étaient certaines de trouver des fiacres. Elles en trouvèrent un presque aussitôt, en effet, et quelques instants plus tard elles roulaient en direction du Palais-Royal.
Le cœur battait un peu à Hortense à l’idée de se rendre dans ce lieu dont la réputation n’était pas des plus pures. Une vague anxiété se mêlait en elle à une curiosité bien de son âge. Elle le dit à Félicia qui éclata de rire :
— Pour… un Parisien, je vous trouve bien provincial, mon cher ! Il est vrai que vous êtes si jeune ! Mais on ne peut se vanter de connaître notre capitale si l’on n’a pas visité au moins une fois le Palais-Royal. C’est très… pittoresque, vous verrez…
Depuis l’année précédente, le fameux palais-centre commercial, était débarrassé des galeries de bois qui enlaidissaient la belle architecture de Victor Louis et cachaient en partie les jardins. De même, on avait fait disparaître les enseignes et autres verrues qui déparaient les harmonieuses façades.
Même élevée dans un couvent, une Parisienne se devait d’avoir au moins entendu parler du Palais-Royal, à mots couverts, bien sûr, car on disait que c’était un mauvais lieu où une femme honnête ne saurait mettre le pied sinon dans la journée et à des endroits bien précis : ceux où il lui était possible de faire son marché. Ainsi, dès les premières lueurs du jour, bourgeoises et cuisinières de grandes maisons se retrouvaient chez les grands marchands de comestibles : Hyrment, spécialisé dans les charcuteries fines, les truffes, les homards, les liqueurs et les vinaigres, Chevet, le maître du gibier à poil, à plume et aussi des produits de la mer, enfin Corcellet, le plus beau magasin des célèbres galeries où l’on trouvait de tout à foison mais surtout des pâtés de foies gras de Strasbourg ou de Toulouse, de veau de rivière de Rouen, de mauviettes de Pithiviers, de perdrix de Périgueux et aussi des langues de Troyes, des mortadelles d’Italie, des saucissons d’Arles, du bœuf fumé de Hambourg, des nonettes de Reims, des pruneaux d’Agen, des pâtes d’abricot de Clermont, des cotignacs d’Orléans… en fait presque toutes les spécialités gourmandes de France et d’Europe. D’autres magasins encore créaient dans les galeries une animation, même une grande affluence : couturières, modistes, tailleurs, chapeliers, marchandes de dentelles, de gants ou de corsets, bijoutiers et fleuristes attiraient en foule jolies femmes, femmes de toutes sortes et hommes de toutes catégories.
Cela, c’était le Palais-Royal du grand jour. Celui dans lequel Félicia introduisit son amie était presque aussi animé mais combien différemment : c’était l’heure des restaurants élégants, et aussi des salles de jeu, des tripots, des cafés et des filles publiques. Les maisons de plaisir étaient assez nombreuses dans les étages qui surmontaient les boutiques pour que leurs pensionnaires fussent trop visibles. Certaines se contentaient de robe décolletées à outrance, d’autres portaient des tuniques de voile qui ne laissaient rien ignorer de leurs charmes.
Dans les galeries, le public était surtout composé d’hommes et, si l’on apercevait des femmes, c’était à travers les vitres des restaurants, les plus célèbres de Paris : le Véfour, Very ou les Frères Provençaux qui brillaient de mille feux et illuminaient les arcades…
Félicia se dirigeait au milieu de cette foule avec l’assurance d’une habituée. Son but était le café Lemblin, fondé par un ancien garçon du café de la Rotonde, qui était le rendez-vous déclaré des bonapartistes. Ce café-là, comme le Palais-Royal lui-même, avait une double vie. De jour, une élite de gourmands venait y déguster son chocolat de Bayonne, son thé de Chine et son café des Antilles accompagnés de pâtisseries. On y rencontrait Chappe, Dupont de l’Eure et Brillat-Savarin, mais la nuit venue, ceux qui poussaient la porte vitrée étaient le plus souvent d’anciens généraux de Napoléon, des officiers en demi-solde et toutes sortes de nostalgiques de l’Empire défunt. Plus de thé, plus de chocolat ! Le café, y subissant une solide adjonction d’eau-de-vie, y devenait une vigoureuse boisson d’hommes nommée superbement « gloria ».
Suivie par son amie, Félicia pénétra avec décision dans le café, évalua du regard ceux qui s’y trouvaient puis, après un signe de tête au patron qui saluait du fond de son comptoir, traversa la salle aux boiseries claires déjà noircies par la fumée des pipes ou des cigares, et gagna l’arrière-salle. Là une dizaine d’hommes étaient réunis autour d’une longue table.
L’odeur de café et d’alcool y était plus forte que dans la première pièce. Derrière la buée odorante qui montait des verres épais, Hortense vit un éventail de visages jeunes ou plus âgés mais tous marqués de ces plis que tracent, sur une figure d’homme, l’énergie ou le désenchantement. Des regards gris, bleus, noirs ou bruns se fixèrent sur les deux faux garçons tandis que tous, d’un même mouvement, se levaient, habitués apparemment au travesti de Félicia. Celui qui paraissait le chef et qui siégeait au centre, vint vers elle. C’était un homme d’environ trente-cinq ans, au visage maigre et volontaire. Il se nommait Buchez et c’était l’un des maîtres du mouvement carbonaro, qu’il avait d’ailleurs introduit en France.
— C’est l’amie dont vous me parlez dans votre lettre, princesse ? demanda-t-il après avoir salué brièvement.
— Oui. La fille du banquier Granier de Berny dont mon frère était sûr qu’il a été assassiné. Elle court, je crois, de graves dangers…
On s’écarta pour leur faire place à la grande table et on leur offrit une tasse de café qu’elles demandèrent instamment dépourvu d’alcool. Puis Félicia entama le récit des mésaventures parisiennes de son amie, ne mentionnant ses déboires auvergnats que juste ce qu’il fallait pour la compréhension du récit.
Quand elle eut fini, Buchez quitta sa place et se mit à marcher de long en large, l’œil visiblement soucieux.
— Ce qui est arrivé cet après-midi, fit-il après un moment de silence, prouve une chose désagréable : votre maison est surveillée, princesse…
— Pas par la police, en tout cas, coupa un homme déjà âgé dont la haute stature portait une tête assez belle, sommée d’une forêt de cheveux gris mais dont les petits yeux, enfoncés sous d’épais sourcils, trahissaient une certaine dose de ruse. Je le saurais…
— Je ne songeais pas à la police non plus, cousin Vidocq. Depuis longtemps nous soupçonnions ce prince San Severo de malversations mais avouez que nous ne le croyions pas capable d’aller jusqu’au crime…
— Vous pensez vraiment que c’est lui ? dit Hortense.
— Cela ne fait aucun doute, ma chère ! C’est une chance que le colonel Duchamp se soit trouvé là à point nommé pour vous sauver la vie. A propos, princesse, il fait réellement partie de nos « bons cousins ». C’est nous qui l’avons fait venir à Paris pour une mission particulière. Vous pouvez avoir toute confiance en lui : c’est un homme d’une rare énergie et d’une droiture absolue…
— Malheureusement, dit Félicia, il ne peut se charger de la protection de mon amie puisqu’il est déjà investi d’une mission et ce qui s’est passé aujourd’hui peut se reproduire…
— Il est bien certain, reprit Buchez, que si madame avait pu se trouver un asile en Auvergne elle y eût été plus en sûreté qu’ici. Mais dans l’état actuel des choses, elle y rencontrerait aussi un isolement dangereux…
— Il est toujours possible de lui procurer un autre abri, dit Vidocq. Le village de Saint-Mandé où j’habite est parfaitement tranquille. On pourrait sûrement lui trouver un logement…
— Ce serait une autre forme d’isolement, coupa Félicia, Ma maison est solide, bien défendue par des serviteurs à toute épreuve. C’est encore là qu’elle sera le plus en sûreté…
— A condition de n’en sortir que le moins possible et sous bonne escorte, reprit Vidocq. Son ennemi finira peut-être par se fatiguer…
— La cause est entendue : je la garde mais, je vous en conjure, essayez de l’aider dans la tâche qu’elle entreprend : laver son père de l’accusation de meurtre et de suicide et le venger… Vous êtes journaliste, Buchez, vous devez pouvoir apprendre certaines choses ? Et vous, Vidocq, le fameux chef de la police de Louis XVIII, comment n’êtes-vous pas au fait de cette histoire ?
— Je suis certain que le banquier et sa femme ont été tués, tout comme votre frère en était certain, protesta l’interpellé, mais le coup a été si bien monté que les traces sont difficiles à relever et les preuves plus encore. Je vous rappelle d’ailleurs qu’en décembre 1827 je n’étais plus à la tête de la Police judiciaire. Je le regrette d’ailleurs car à cette heure nous saurions où se trouve votre frère…
— On ne sait toujours rien ? murmura Félicia, la voix soudain altérée.
— On sait qu’il n’est pas à Paris. Mais la France est grande. Notre cousin Dugied qui couvre la Bourgogne et la Franche-Comté a pu nous donner deux assurances : Gianfranco Orsini ne se trouve ni au château de Dijon ni au fort de Joux. Arnold Scheffer dit qu’il n’est pas non plus au château d’if, à Marseille, ni à l’île Sainte-Marguerite. A présent, c’est au tour de Rouen l’aîné, chargé de la Bretagne, de donner ses résultats. Il nous a déjà fait savoir que votre frère ne se trouvait pas au Mont-Saint-Michel mais il y a encore beaucoup d’autres prisons à explorer… et malheureusement, nous avons beaucoup à faire ici même si nous voulons en finir avec ce maudit régime…
Un homme vêtu dans la meilleure tradition des demi-soldes : redingote sombre pincée à la taille, cravate noire, pantalons à la houzarde tombant sur les bottes garnies d’éperons, la Légion d’honneur à la boutonnière et le « bolivar » planté sur la crinière, venait de faire irruption.
— Une escouade de police vient de s’arrêter devant le café, lança-t-il. Il faut filer !…
— Pas tous ! protesta Buchez. Il n’a jamais été défendu de boire un gloria avec de vieux compagnons. Mais, vous Vidocq, toi Flotard et toi, Sigaud, il vaut mieux que vous disparaissiez ! Vous aussi, mesdames. On va vous montrer le chemin…
Le chemin, c’était d’abord une trappe menant dans la cave. Sous la conduite de Vidocq, les quatre personnages désignés s’y engagèrent l’un après l’autre tandis que l’on faisait disparaître tasses et verres en surnombre. Les carbonari restants reprirent place à table et Buchez s’en alla même commander d’autres consommations. Juste à ce moment, les argousins, le gourdin brandi et l’œil soupçonneux, pénétraient l’un après l’autre dans le café…
Le bruit de leurs pas se répercutait dans le caveau souterrain, encombré de barriques, de sacs de thé ou de café et de tout ce dont on a besoin dans un café bien achalandé.
— La trappe n’est même pas cachée, dit Hortense. Ils vont nous découvrir sans peine…
— Aussi n’allons-nous pas rester là, fit Vidocq.
Il prit un rat-de-cave sur une étagère, l’alluma à son briquet puis, avec l’aide d’un de ses compagnons fit basculer tout le devant d’une grosse barrique dans laquelle il invita les deux femmes à le suivre. Les deux autres hommes s’y engagèrent à leur suite et le dernier referma l’étrange porte qu’un ingénieux mécanisme ouvrait et refermait à volonté.

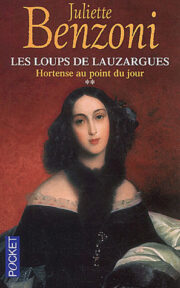
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.