Incapable de dormir, Hortense passa la plus grande partie de cette nuit à sa fenêtre, écoutant elle aussi l’écho lointain des cris et des coups de feu. Vers minuit, des commandements hurlés et le bruit d’une troupe en marche se firent entendre dans le voisinage : une compagnie de Suisses quittait, pour l’Hôtel de Ville, la caserne de Babylone…
Où était Félicia à cette heure ? Dans quelle aventure insensée se lançait-elle ?… Insensée ? Pas pour elle, après tout ! Il y avait tant de vaillance dans cette fière créature qu’une vie de femme ne pouvait que l’user sans l’étouffer vraiment. Il y avait du chef de bande dans Félicia Orsini et son image de reine des amazones dressée sur une barricade et jouant du pistolet, cette image qui se reformait sans cesse dans l’imagination d’Hortense n’avait rien de ridicule.
— Qu’elle vive seulement ! priait la jeune femme. Qu’elle revienne pour jouir au moins des joies violentes du triomphe après tant de douleurs !
L’aurore vint, rose et pure, sans nuage, lâchant comme un ballon la boule de feu du soleil qui, dans sa course, allait se chauffer à blanc. Hortense demanda un bain froid car même si elle n’avait pas sommeil, elle craignait à présent la torpeur qu’apporte une nuit blanche.
Vers dix heures, elle vit arriver dans un frou-frou de taffetas violet la douairière de Vauxbuin qui habitait l’hôtel d’en face. Le cheveu un peu en désordre et sa poudre mise n’importe comment, la vieille dame semblait dans tous ses états.
— Dieu soit loué, vous êtes là, ma chère comtesse ! s’écria-t-elle en agitant son face-à-main. Je n’en peux plus de tourner en rond dans ma maison avec tous ces bruits qui courent. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.
— Moi non plus si cela peut vous être d’une aide quelconque…
— Pensez-vous que l’on va venir nous égorger ? Tous ces buveurs de sang qui sont à nouveau lâchés ! Allons-nous revoir les jours affreux de 93 ?… En ce cas, il faudrait émigrer encore mais je ne suis plus d’âge à courir les routes, hélas !
En dépit de son anxiété, Hortense sourit. On n’avait certes pas à craindre quoi que ce soit de semblable. Le peuple n’en voulait qu’aux ordonnances du Roi qui balayaient la royauté constitutionnelle pour rappeler le pouvoir absolu… Mais la douairière ne voulait pas se laisser convaincre.
— Cela commence de la même façon. On est allé rechercher dans son château de la Grange-Bléneau ce diable de La Fayette ! Dieu sait quelles misères il va faire encore au pauvre roi !… Hier j’ai envoyé de mes gens aux renseignements. Bien peu sont rentrés. Les autres doivent être à faire le coup de feu avec tous ces énergumènes. Quelle époque !
— Vous oubliez les soldats ! Le maréchal Marmont a des troupes nombreuses sous son commandement.
La bouche fripée de la vieille dame s’arqua en un summum de mépris qui fit tomber sa mouche mal collée.
— Ce moins-que-rien affublé d’un titre de carnaval ?… Vous y croyez, vous ? On dit déjà que, dans certain régiment de ligne, on manifeste des hésitations, on aurait tendance à ne pas considérer comme ennemis ces émeutiers de malheur. Que ferons-nous si les troupes fraternisent et se tournent contre nous ?
— Il reste les Suisses. Ce sont des mercenaires et ils n’ont aucune raison de se retourner contre le Roi. En outre, ils sont nos voisins.
— Ma petite, vous ne savez pas grand-chose ! Apprenez que, le 10 août 1792, ces braves gens avaient toutes les raisons d’abandonner la cause royale. Pourtant ils se sont fait tuer, vaillamment, l’un après l’autre sur les marches des Tuileries où l’on glissait dans le sang…
Hortense faillit répondre que Mme de Vauxbuin parlait certainement par ouï-dire car en 92 elle avait, de son propre aveu, rejoint Coblentz depuis belle lurette. Ce qui n’enlevait rien d’ailleurs au sacrifice des Suisses. Un peu agacée, la jeune femme se demandait comment elle allait faire pour se débarrasser de sa visiteuse qui continuait à égrener la liste des bruits affreux qu’on lui avait rapportés – la manufacture des vivres aurait été enlevée par les brigands privant ainsi les soldats de pain et les principaux postes de garde de la capitale seraient déjà tombés – quand un nom lui fit dresser l’oreille. La vieille dame venait de parler de Vincennes…
— Veuillez m’excuser, dit Hortense, je me suis laissée distraire : que disiez-vous ?
L’autre la fusilla du regard :
— C’est pourtant grave ! Je vous disais qu’une forte bande de ces misérables était partie pour s’emparer de la poudrière de Vincennes. Or, cette poudrière est bien défendue… par des hommes qui ont mission de la faire sauter plutôt que de la remettre à l’ennemi, quel qu’il soit…
— Et… si cette poudrière saute ?…
— Le dommage sera terrible. Tout sautera avec elle et les ravages pourront s’étendre sur une demi-lieue…
Le cœur d’Hortense manqua un battement. Une demi-lieue ? La maison de Mme Morizet n’était qu’à un quart de lieue à peine de la Poudrière. Brusquement, la vieille dame venait de perdre sa mine arrogante et se laissait tomber dans un fauteuil.
— Un de mes petits-fils est là-bas, avoua-t-elle, tout en chassant avec rage les larmes qui lui montaient aux yeux…
Hortense sentit soudain une sympathie lui venir pour cette femme, raide vestige de l’Ancien Régime que l’angoisse forçait à laisser parler son cœur. Et comme la douairière cherchait fébrilement un mouchoir, qu’elle avait dû oublier, elle se pencha vers elle en lui offrant le sien.
— Vous avez vraiment peur, marquise ?
— Oui… vraiment ! Puis-je rester ici, avec vous ?… Je ne peux plus supporter ma maison…
— Restez autant que vous le voudrez. Livia va vous faire un peu de son merveilleux café et prendra soin de vous. Moi, je vais vous quitter pour un moment…
— Et où voulez-vous donc aller ?
— J’ai… un devoir à remplir. Pardonnez-moi et, si la comtesse Morosini revient, dites-lui que je suis allée à Saint-Mandé…
— Mais… c’est presque à Vincennes cela. Comment voulez-vous y aller ? Aucune voiture ne peut traverser Paris à cette heure.
— Eh bien, j’irai à pied…
En laissant là Mme de Vauxbuin médusée et vaguement admirative, elle monta dans sa chambre pour y prendre des souliers solides et un chapeau de paille. Puis, après quelques mots à Livia tout aussi effarée que la vieille dame, elle lui confia cette dernière et s’élança dans la fournaise de la rue.
En écoutant sa visiteuse elle avait été un instant distraite des bruits de la ville. Quand elle fut dehors, elle entendit nettement le canon qui tonnait. C’était un bruit incongru dans ce quartier paisible et, atteignant la caserne des Suisses, elle ne put s’empêcher de demander à une sentinelle :
— Est-ce vraiment… le canon que l’on entend ?
L’homme des Cantons, une sorte de géant à la figure rouge brique, opina gravement du bonnet :
— Ganon ?… foui Matame… C’être le ganon… Il faut rendrer chez fous…
Peu désireuse de discuter la question, elle fit signe que non et reprit sa route, rejoignant la rue du Bac puis la rue de Sèvres où l’agitation était grande. Il y avait des femmes et des enfants à toutes les portes, à toutes les fenêtres. Des vieux avaient remis d’anciens uniformes. Ceux des guerres de l’Empire arboraient des décorations et tenaient de véritables congrès en pleine rue. Un homme passa, portant un panier couvert comme en ont les marchands de gâteaux. Il distribuait des cartouches à tous les hommes et à quelques femmes qui en réclamaient. Il en tendit deux à Hortense qui les refusa.
— Je n’ai pas d’armes…
— Alors, rentrez chez vous la p’tite dame ! C’est encore assez tranquille par ici. Ça chauffe seulement place du Panthéon et autour des mairies mais ça ne va pas durer. Vous entendez le canon ?
On l’entendait en effet de plus en plus. C’était sans doute celui des Tuileries…
— Je n’ai pas peur du canon, dit-elle avec un sourire. Je vais voir mon fils…
— Alors tâchez moyen d’lui conserver sa mère. C’est pas fréquent d’en avoir une aussi jolie !…
Elle vit sa première barricade au carrefour de la Croix-Rouge. Elle était en construction. Sous l’attaque de jeunes hommes aux bras nus, les pavés sautaient l’un après l’autre et commençaient à former des tas auprès de deux voitures renversées qui servaient d’ossature. On y traînait des meubles que l’on entassait les uns sur les autres, des sacs de terre et des tonneaux dont tous n’étaient pas vides. Des femmes assises par terre déchiraient du linge pour faire de la charpie et des bandes. D’autres hommes préparaient des armes, miraient les canons dans le soleil, comptaient les cartouches. Il y avait là, comme la veille, des ouvriers et des bourgeois. Ceux-ci mettaient bas leurs habits qu’ils pliaient soigneusement dans un coin pour prendre la pioche et s’attaquer aux pavés ou aider à porter un meuble… Et tout ce monde riait, plaisantait, chantait même et semblait s’entendre à merveille. N’eût été la grande barrière hérissée de fusils on aurait pu croire qu’il s’agissait là d’une fête…
On héla joyeusement Hortense quand elle s’approcha. L’un des jeunes hommes qu’à son uniforme noir militairement boutonné elle reconnut comme un élève de l’École Polytechnique et qui semblait le chef lui demanda du haut de la barricade si elle venait les aider.
— Je voudrais surtout passer. J’ai à faire par là…
— Vous pouvez passer, on laisse un petit espace libre, là sur le côté gauche. Venez !
Déjà il avait sauté de son perchoir et venait à elle s’inclinant courtoisement et lui offrant la main pour franchir les pavés qui avaient roulé…
— On ne se bat pas, par ici, remarqua Hortense. Pourquoi faites-vous cela ?
— On ne se bat pas encore mais on se battra. Des barricades, il s’en élève de semblables dans toutes les rues qui pourraient servir de passage aux Suisses pour rejoindre les Tuileries. Et puis il y a aussi les régiments casernés près de la place d’Enfer et des barrières du sud… Le mot d’ordre est d’isoler le Louvre, les Tuileries et l’Hôtel de Ville…
— Cela vous servira à quoi ? Est-ce que le Roi n’est pas à Saint-Cloud ? Les Tuileries sont vides.
— Vides ? Avec ce traître de Marmont et tous les ministres qu’il prétend protéger ? Ces gens ont voulu leur malheur, madame. Qu’ils ne s’en prennent qu’à eux ! Le peuple, lui, ne s’arrêtera plus qu’à la victoire ou à l’anéantissement… Où habitez-vous ?
— Rue de Babylone mais…
— C’est un mauvais endroit à présent mais vous y serez encore mieux que dans les rues, surtout dans la direction où vous voulez vous rendre… Enfin, c’est votre affaire, ajouta-t-il en voyant que la jeune femme fronçait les sourcils, mais n’approchez pas de la Seine. On s’y bat pour les ponts…
Il la salua de nouveau puis retourna se consacrer à son ouvrage. Hortense poursuivit son chemin, de plus en plus difficilement car, un peu partout, d’autres barricades s’élevaient, plus ou moins semblables à celle qu’elle venait de rencontrer. A chacune elle trouvait le même enthousiasme, la même gentillesse. Le bruit de la bataille se rapprochait mais elle n’avait pas encore atteint le faubourg Saint-Germain. Seul le quartier Latin bougeait et se vidait de ses étudiants qui, en masse, descendaient vers la Seine, criant et chantant, armés de ce qu’ils avaient pu trouver dans les armureries, coiffés de larges bérets ou de chapeaux de papier…
Déjà fatiguée par sa course à travers les rues, Hortense dut déployer un véritable courage pour continuer. Le tumulte en effet régnait sur la Seine. Le passage du Pont-Neuf, occupé par un régiment de ligne, était impossible. On tirait de tous les côtés et l’immense silhouette du Louvre et des Tuileries n’apparaissait plus que comme un fantôme surgi des grisailles de la fumée.
Il y avait foule sur le quai des Grands-Augustins mais il était possible de passer. Après s’être assise un moment sur une borne et désaltérée à une fontaine, Hortense reprit son chemin. Personne ne faisait attention à elle d’ailleurs. Il y avait sur le quai presque autant de femmes que d’hommes. Elle faillit être emportée par un cortège d’étudiants qui, aux cris de « Vive l’Empereur ! », « Vive Napoléon II ! » s’engouffrait sur le pont Saint-Michel. Mais elle n’échappa pas à une troupe hurlante d’ouvriers, de jeunes gens et de femmes qui l’entraîna à travers la Cité et, sans trop savoir comment, elle se retrouva sur le quai Lepelletier au milieu d’une foule dense, en marche vers l’Hôtel de Ville et sous un soleil de plomb. Elle ne comprit pas tout de suite qu’elle était déjà au cœur de la bataille et se crut en enfer. Les balles sifflaient, l’odeur de poudre brûlée était écœurante et aussi celle de ces corps en sueur qui l’environnaient de toutes parts. Son chapeau lui fut arraché en l’étranglant à moitié. Ses cheveux croulèrent sur ses épaules tandis qu’une brutale poussée qui lui froissa un bras lui arracha un cri de douleur… Autour d’elle c’était un pandémonium de faces noircies où la sueur traçait de longues rigoles et où, parfois, le sang mettait sa pourpre tragique.

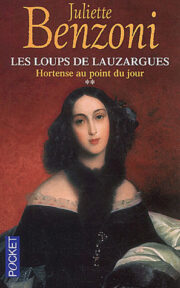
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.