Une vague de dégoût l’envahit, si violente qu’elle dut s’accrocher aux dragonnes de la voiture pour lutter contre une véritable nausée. Son cœur battait la chamade. Ses mains étaient glacées et un instant elle crut qu’elle allait s’évanouir. Pourtant, son esprit demeura clair et, quand la vague écœurante se retira, elle laissait derrière une idée simple, claire et implacable : puisqu’elle ne pouvait obtenir justice contre San Severo, elle le tuerait, tout simplement… et pas plus tard que ce soir !
Rentrée dans sa chambre, Hortense s’y prépara avec un soin extrême. En bas, Félicia recevait la douairière de Vauxbuin et quelques-uns des anciens habitués de son salon tous avides de raconter comment ils avaient vécu ce que l’on commençait à appeler « les Trois Glorieuses ». Ils emplissaient le salon d’un pépiement de volière qui par les fenêtres ouvertes montait jusqu’à Hortense.
Elle n’avait aucune envie de se joindre à eux. Ce soir elle allait jouer sa vie contre une autre car elle n’ignorait pas ce que serait son sort si San Severo réussissait à mettre la main sur elle. C’était dans la gueule du loup qu’elle allait se jeter. Un loup qui ne ressemblait malheureusement pas à Luern, le compagnon fidèle de Jean le meneur…
Calmement, elle alla s’asseoir devant son petit secrétaire, prit du papier, tailla une plume et se mit à écrire d’abord un testament dans lequel elle expliquait les raisons de son geste. Tout à l’heure, elle le ferait signer par Félicia et par Livia. Elle y exprimait le désir, au cas où il lui arriverait malheur, d’être enterrée à Lauzargues afin que son âme n’eût pas trop de chemin à faire pour retrouver Jean.
La seconde lettre fut pour lui et ce fut le seul instant de douceur de ce terrible jour. En écrivant à l’homme qu’elle aimait, la jeune femme laissa simplement couler de son cœur tout cet amour, toute cette passion qu’elle n’aurait peut-être plus jamais le droit de lui donner. Mais cette douceur n’amollit en rien sa résolution. Jean agirait, elle le savait, exactement comme elle allait agir… Il faudrait bien qu’il comprenne et qu’il lui pardonne d’être allée seule au-devant du danger, sans faire appel à lui.
Elle écrivit une troisième lettre pour l’excellente Mme Morizet, lui confiant Étienne pour le temps qu’il plairait à son père de le lui laisser et la remerciant chaudement de ses soins et de son amour pour le petit… Cela fait, elle cacheta les trois lettres et les laissa bien en évidence sur le secrétaire.
Elle sortit ensuite les vêtements d’homme qu’elle avait choisi de porter. Ils seraient plus commodes pour l’exécution de son plan car elle ne voulait pas compromettre son vieux Mauger en se faisant ouvrir la porte par lui. Le mur du jardin était assez haut mais il lui était déjà arrivé de l’escalader et, dans ce costume, ce serait infiniment plus facile qu’en jupe.
Les vêtements étalés sur son lit, elle passa aux pistolets dont Félicia lui avait fait don, après leur expédition en Bretagne. C’étaient de belles armes, assez légères, portant bien la balle et Hortense avait appris à s’en servir. A une distance raisonnable, elle était certaine de faire mouche. Ce qu’il adviendrait d’elle ensuite, c’était l’affaire du Destin. Peut-être serait-elle arrêtée si elle ne s’enfuyait pas à temps, jugée, condamnée ?…
Elle ne put se défendre d’un frisson d’horreur en face d’un tel destin mais, en même temps, son imagination lui montrait San Severo dirigeant une arme sur sa mère, après avoir abattu son père, et le courage lui revint. Avec des mains qui ne tremblaient pas, elle vérifia les armes, les nettoya et finalement les chargea…
Elle y mettait les balles quand Félicia entra. Le coup d’œil rapide de la Romaine fit le tour de la chambre, vit les armes dans les mains de son amie, les habits préparés, les lettres sur le secrétaire. Félicia avait compris.
— Vous en êtes là ? Que s’est-il donc passé, Hortense ?
— L’impensable. San Severo est mieux en cour que jamais. Il cousine avec la reine, il a aidé le Roi à coiffer la couronne encore chaude de la tête de Charles X. Le prince de Talleyrand m’a bien fait comprendre que je ne détruirais que moi-même en demandant justice contre lui…
Brièvement, elle raconta la scène qui s’était déroulée dans le salon de Mme de Dino…
— … et vous avez décidé de faire justice vous-même, conclut Félicia. N’allez-vous pas vous détruire plus sûrement encore ? Comment atteindrez-vous votre ennemi au milieu de ses gens, au milieu de…
— Vous alliez dire sa maison, n’est-ce pas ? C’est justement là ma chance. Cette maison je la connais mieux que lui. J’en connais chaque recoin, chaque passage. Le peu que j’y suis restée, j’ai pu constater que rien, pas même la disposition des meubles, n’avait été changé depuis la mort de mes parents. Ce misérable déguise son crime en se faisant le prêtre du sanctuaire. Il prétend avoir aimé ma mère…
— C’est peut-être vrai mais il a aimé l’argent davantage. Et puis, elle a dû le repousser… Ainsi donc, c’est décidé ? Vous passez à l’attaque ?
— Ce soir même. Je compte me rendre rue de la Chaussée-d’Antin vers minuit. C’est l’heure du crime, n’est-ce pas ? ajouta-t-elle avec un petit sourire…
— Parfait. Je serai prête !
— Vous ne pouvez pas venir avec moi, protesta Hortense. Il est inutile de nous sacrifier à deux s’il faut en arriver là. Et puis, votre épaule n’est pas guérie. Elle vous rend incapable d’un effort et moi je vais escalader un mur…
— Toute seule ?
— Je l’ai déjà fait… Ce sont « mes » murs après tout !
— Sans doute mais vous le ferez encore mieux avec l’aide de Timour. Quant à moi, je resterai dans la voiture que vous laisserez à quelque distance et que je garderai. Vous n’imaginez tout de même pas que je vais vous laisser faire cette folie toute seule après ce que vous avez risqué pour moi en Bretagne ? En vérité, je crois même que je me sens offensée que vous n’ayez pas pensé immédiatement à me demander mon aide !
— Ne le soyez pas, Félicia. Cela tient à ce que je vous aime beaucoup…
Les deux femmes s’embrassèrent. C’était un geste peu courant entre elles. Leur amitié n’avait pas besoin de perpétuelles démonstrations. C’était, depuis l’arrivée d’Hortense à Paris, celle de deux camarades de combat. On ne s’attarda pas aux attendrissements d’ailleurs. Le baiser échangé, Félicia repartit en annonçant qu’elle allait prendre ses propres dispositions.
Il était un peu plus de onze heures quand les deux femmes quittèrent la rue de Babylone. Timour avait été envoyé en éclaireur et Félicia conduisait elle-même le léger tilbury dont elle aimait à se servir quand l’envie lui prenait de « dévorer du vent », comme elle le disait. La nuit était aussi belle, aussi étoilée qu’elle l’avait été durant la révolte mais nettement moins chaude. Deux ou trois orages avaient mis ordre aux excès de la tempéra-turc…
Il avait été convenu que l’on laisserait la voiture de l’autre côté du boulevard, rue Louis-le-Grand, devant le Dépôt des cartes et plans de la Marine. Revêtue d’un manteau de groom, coiffée du « tube » à cocarde, Félicia serait censée attendre, dans cet endroit obscur, un maître en veine de galanterie. Timour exact au rendez-vous apprit aux deux femmes que, chez San Severo, la soirée s’était achevée mais qu’un visiteur de dernière minute venait d’arriver.
— Parfait, dit Hortense. Nous n’aurons aucune peine à passer par les cuisines… Priez pour nous, Félicia !
— Je n’ai pas attendu, ma chère, votre permission…
Suivie de son garde du corps, Hortense gagna une ruelle étroite, tracée entre les murs des hôtels particuliers, qui servait de dégagement aux jardiniers et d’entrée aux fournisseurs. Il y avait bien là une petite porte basse creusée dans le mur du jardin mais un rapide examen montra qu’elle était trop bien défendue pour être forcée. La seule solution était celle à laquelle Hortense avait tout d’abord pensé : le mur.
Grâce aux épaules de Timour, elle en atteignit le faîte avec une grande facilité. Quant au Turc, d’une agilité qui égalait sa force, il n’avait besoin de personne. Un moment, ils restèrent tous deux assis sur le faîte abrités par les basses branches d’un gigantesque tilleul. Le parfum de l’herbe fraîchement coupée vint jusqu’à eux et aussi celui des roses, ces roses que Victoire de Lauzargues avait tant aimées, qui emplissaient les serres de Berny mais aussi ce jardin.
Hortense refusa l’attendrissement du souvenir. Elle n’était pas là pour respirer des fleurs mais pour accomplir sa, justice, en rupture complète avec les préceptes de l’Église et la loi de Dieu. Mais elle se permit un sourire en pensant à la mine que ferait la sainte Mère Madeleine-Sophie Barat si elle pouvait à cette heure voir son ancienne élève, assise en pleine nuit sur un mur et armée jusqu’aux dents…
D’où ils étaient placés, Hortense et Timour pouvaient voir la porte des cuisines. Le personnel était justement en train d’en sortir pour gagner les soupentes qui, au-dessus des écuries, leur servaient de logis. Quand le dernier fut sorti, les deux compagnons se laissèrent glisser à terre, se tinrent un instant tapis dans un buisson de delphiniums géants qui n’arrivait pas à contenir Timour tout entier. Puis s’élancèrent sur la pointe des pieds.
Ainsi que le pensait Hortense, la porte de la cuisine n’était pas fermée. C’était le valet de chambre du maître, le seul qui dormait dans la maison, qui la fermait en même temps que les autres portes. Il ne la fermerait que tout à l’heure puisque San Severo avait encore une visite.
La cuisine était vide, ainsi que les offices, Ils furent traversés rapidement et, par l’escalier de service, on gagna le premier étage, Hortense avait remarqué que la bibliothèque était éclairée, C’était là sans doute que se tenait le prince.
Le palier était obscur mais la jeune femme connaissait trop les aîtres pour s’y tromper, Toujours suivie de Timour dont la présence lui était d’un singulier réconfort, elle entra dans la petite pièce voisine où se tenait habituellement le secrétaire quand le banquier choisissait de travailler à la maison…
Le petit bureau était moins sombre que le reste de la maison car un rai de lumière y pénétrait par la porte de la bibliothèque restée entrouverte. Hortense s’en approcha le plus possible puis s’immobilisa. La voix de San Severo se faisait entendre, tout son accent napolitain exalté sous l’empire de la colère :
— Vous n’aurez rien de plus, mon cher ! Vous semblez oublier que c’est moi qui ai fait tout le travail… le vilain travail ? Vous vous êtes contenté d’en recueillir les fruits. J’estime donc que vous avez été très suffisamment payé. Le reste m’appartient…
— Vraiment ? Est-ce que vous n’oubliez pas que, sans moi, vous n’auriez jamais été placé à la tête de la banque ?…
Le timbre glacé et méprisant de cette voix fit glisser un frisson le long de l’échine d’Hortense. Elle fit un mouvement brusque et quelque chose tomba à terre mais heureusement le bruit léger ne fut pas entendu… Alors, doucement, tout doucement, avec d’infinies précautions pour ne pas faire crier le parquet, elle s’approcha.
— Il n’a jamais été question que vous gardiez la fortune de Granier, gronda le marquis de Lauzargues. Cette fortune appartient…
— A votre nièce ? Une nièce qui vous hait et vous fuit ?
— Laissez cette folle ! Cette fortune appartient à mon petit-fils Foulques-Étienne de Lauzargues. Et je vous somme de me remettre les revenus des mois écoulés… ainsi que le prix du château de Berny que vous avez vendu sans autorisation…
Par la mince fente, Hortense voyait parfaitement son oncle. Dans la lumière douce de la lampe-bouillotte qui reposait sur la grande table de travail en acajou, il érigeait sa silhouette arrogante nimbée de sa crinière blanche et, en dépit de la colère qui bouillonnait en elle car le destin à cet instant lui mettait sous les yeux, non des gentilshommes mais les plus ignobles complices, elle ne put s’empêcher d’admirer l’élégance suprême avec laquelle il portait sa grande cape noire à col de velours retenue par une chaîne d’or… Elle ne voyait pas San Severo qui devait tourner le dos à la porte. Mais il était sans doute assez près d’elle car elle entendait sa respiration un peu forte… Enfin, il parla :
— On voit bien que vous habitez l’Auvergne, mon cher marquis. Vous n’êtes plus au fait des nouvelles et il faut, je crois, mettre votre montre à l’heure. Ce n’est plus Charles X qui règne aux Tuileries…
— Je le sais pardieu bien ! Qu’est-ce que cela change dans nos accords ?
— Cela change beaucoup. Vous aviez l’oreille de l’ancien roi et, de ce fait, quelque supériorité sur moi qui en étais mal connu, peut-être insuffisamment apprécié. A présent, c’est tout le contraire. Je ne dirais pas que je suis chez moi aux Tuileries mais… peu s’en faut !

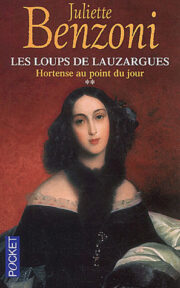
"Hortense au point du jour" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hortense au point du jour". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hortense au point du jour" друзьям в соцсетях.