— Le comte Tchernytchev ! s’écria-t-elle ! Vite ! Il est en danger ! Ils vont le tuer !
Celui dont elle avait pris le bras se retourna, la regarda... Et si puissante était l’atmosphère d’irréalité de cette nuit désastreuse que Marianne fut à peine surprise de reconnaître Napoléon en personne. Noir de suie, son uniforme de colonel des chasseurs plein de trous, il s’apprêtait à emporter une femme blessée qui gémissait doucement sur un banc de pierre. C’était sans doute lui qui, en revenant vers l’ambassade sinistrée, avait ramené les secours qui, maintenant, prenaient possession du parc.
— Qui va le tuer ? dit-il seulement.
— Des hommes... là, dans le bosquet ! Ils m’ont attaquée et le comte est venu à mon secours ! Vite, ils sont trois, armés... et il est seul sans autre défense que ses mains...
— Qui sont ces hommes ?
— Je ne sais pas ! Des bandits ! Ils sont venus par-dessus le mur...
L’Empereur se redressa. Sous les sourcils froncés, ses yeux gris étaient durs comme de la pierre. Il appela :
— Eugène ! Duroc ! Par ici ! Il paraît qu’on assassine maintenant.
Et flanqué du vice-roi d’Italie et du duc de Frioul, l’Empereur des Français vola, de toute la vitesse de ses jambes, au secours de l’attaché russe. Rassurée sur le sort de Tchernytchev, Marianne revint machinalement vers les bassins. Elle ne savait plus bien ni que faire ni où aller. Sans surprise comme sans joie, elle vit enfin arriver les pompiers, ou tout au moins un semblant de pompiers car ils n’étaient que six... et incroyablement ivres par-dessus le marché. Elle entendit les cris de fureur de Savary.
— Vous n’êtes que six ? Où sont les autres ?
— On... on ne sait pas, mon... mon général !
— Et votre chef ? Cet imbécile de Ledoux ? Où est-il ?
— A... à la campagne, mon général.
— Six ! hurla Savary ivre de rage, six sur deux cent quatre-vingt-treize ! Et où sont les pompes ?
— Là... mais on n’a pas d’eau. Les bouches à eau des Grands Boulevards sont fermées à clé et on n’a pas la clé.
— Et elle est où cette clé ?
Le pompier eut un geste évasif qui porta à son comble le courroux du ministre de la Police. Marianne le vit partir comme une flèche, traînant après lui le malheureux qui faisait des efforts désespérés pour conserver son équilibre et ne se doutait certainement pas qu’il allait affronter une seconde plus tard une colère infiniment plus redoutable que celle d’un ministre.
Néanmoins, les secours s’organisaient. C’était la Garde Impériale, ramenée par Napoléon et jointe à un régiment de tirailleurs, qui tentait maintenant de sauver l’ambassade et ses habitants. On était allé chercher la grande échelle à la bibliothèque de la rue de la Loi et les bassins étaient largement mis à contribution. Mais Marianne se désintéressa bientôt de ce qui se passait autour d’elle. Puisque l’Empereur avait pris la direction des opérations, tout allait s’arranger. Elle entendit sa voix métallique tonner quelque part dans le jardin.
Son esprit était vide, sa tête douloureuse. Elle se sentait meurtrie dans tout son corps et cependant ne parvenait pas à trouver la force d’essayer d’en sortir, de chercher une voiture pour rentrer chez elle. Quelque chose s’était brisé en elle et c’était avec une sorte d’indifférence qu’elle regardait l’incroyable scène de dévastation que présentait le parc bouleversé. Cet énorme incendie qui, en quelques instants, avait décimé une société joyeuse, élégante, raffinée, pour ne laisser qu’un champ de mort, était trop à l’image de sa propre vie pour qu’elle n’en fût pas profondément atteinte. Le bal tragique lui avait assené le dernier coup, celui qu’elle ne se sentait plus capable de supporter. Et nul n’était à blâmer qu’elle-même. Comment avait-elle pu s’aveugler à ce point sur ses véritables sentiments ? Il avait fallu tant de détours, tant de luttes contre l’évidence, contre l’avis même de ses meilleurs amis, tant de stériles combats contre l’invisible pour en arriver enfin à cette issue cruelle, se résumant en une seule image, celle de Jason emportant une autre femme, pour que l’éclatante vérité vînt enfin, et trop tard, éblouir ses yeux : elle aimait Jason, elle l’avait toujours aimé, alors même qu’elle se croyait éprise d’un autre et qu’elle s’imaginait le haïr. Comment n’avait-elle pas été alertée quand, dans sa chambre de jeune fille, à Selton Hall, il l’avait prise dans ses bras pour lui voler ce baiser sous lequel elle s’était sentie défaillir ? Comment n’avait-elle pas compris, à sa joie quand il avait surgi dans les souterrains de Chaillot, à sa déception quand il avait quitté
Paris sans la revoir, à son émotion devant le bouquet de camélias posé dans sa loge, au soir de son unique concert public, à son impatience et, enfin, à sa cruelle déconvenue quand elle l’avait attendu en vain, tout au long des routes d’Italie et jusqu’à la dernière minute, avant de s’engager dans un mariage insensé ? Elle entendait encore la voix, gentiment dubitative d’Adélaïde : « Vous êtes bien sûr de ne pas l’aimer ?... »
Ah oui ! elle en était sûre alors, dans sa folie et dans l’orgueil qu’elle avait éprouvé à s’attacher, par les brûlantes chaînes de l’amour physique, le géant de l’Europe. Dans le réveil brutal qui était le sien, à cette minute entre toutes cruelle, Marianne analysait enfin lucidement la vérité du sentiment qui l’attachait à l’Empereur. Elle l’avait aimé avec orgueil et avec crainte, avec une joie que pimentait une délicieuse sensation de fruit défendu et de danger, elle l’avait aimé avec l’ardeur de sa jeunesse et d’un corps avide qui avait, grâce à lui, découvert l’envoûtant sortilège que fait naître l’accord parfait de deux chairs. Mais elle comprenait maintenant que son amour était fait d’émerveillement et de gratitude. Elle était tombée au pouvoir de cette séduction étrange qu’il exerçait sur les êtres humains et, quand elle avait souffert de son abandon, la jalousie alors éprouvée était âpre, brûlante, stimulante en quelque sorte. Elle n’était pas cette déchirure, cette angoisse, ce tremblement affolé de tout son être devant la double image de Jason et de Pilar. Et maintenant qu’elle avait perdu, à jamais perdu, ce bonheur que le destin avait si longtemps laissé à portée de sa main, Marianne sentit qu’elle avait aussi perdu le goût de vivre.
Plus violente encore qu’à son arrivée au bal, la sensation de n’être qu’une marionnette vide lui revint avec le sentiment d’une vie gâchée par sa propre faute. Par orgueil, par folie et par aveuglement, elle avait laissé Jason lui échapper, se tourner vers une autre et lier son destin à cette autre. C’était Pilar qui vivrait avec lui, dans le pays où pousse le coton, où chantent les Noirs, c’était elle qui partagerait chaque instant de sa vie, qui dormirait chaque nuit dans ses bras, qui porterait ses enfants...
Autour de Marianne, le parc était livré au combat de rues. Les régiments qui étaient entrés en scène livraient bataille aux pillards tandis que des infirmiers bénévoles emportaient des corps dont certains étaient déjà des cadavres. D’autres soldats, armés de seaux d’eau, tentaient d’enrayer le sinistre et de sauver l’hôtel de l’ambassade. Personne ne prêtait attention à cette femme qui, à l’abri d’un buisson, ne faisait que regarder.
L’énorme brasier, dont la chaleur la brûlait à distance, la fascinait. Les arbres voisins avaient pris feu et de longues flammes s’élançaient, triomphantes et voraces, de l’amas des poutres et des troncs qui s’abattaient. Les cris, les gémissements s’étaient tus. Seule, la grande voix du feu emplissait la nuit. Les yeux pleins de larmes, Marianne l’écoutait comme si de ce cœur ardent pût jaillir la réponse à sa propre brûlure. Du fond dé sa mémoire, un vers de Shakespeare remonta :
« Un feu qui brûle en éteint un autre... »
Son amour pour Jason, si soudainement découvert, avait éteint son amour pour l’Empereur, ne laissant qu’une tendresse et une admiration, pierres brillantes au milieu des cendres chaudes. Mais cet amour qui, maintenant, la torturait, quel autre feu viendrait l’éteindre avant que le désespoir ne conduisît Marianne aux portes de la folie ? Jason était loin ! Il avait emporté sa jeune femme hors de ce champ de mort et, sans doute à cette heure, il devait être auprès d’elle, cherchant à calmer sa frayeur avec des gestes tendres et des mots d’amour.
Il avait oublié Marianne et, de cet oubli, elle allait mourir. La révélation était venue trop tard et, comme la foudre tombant sur un arbre, elle avait anéanti Marianne. Il fallait, maintenant, qu’elle s’en allât discrètement sur la pointe des pieds.
Sa mémoire, soudain, remit devant ses yeux l’image de la princesse de Schwartzenberg se jetant dans les flammes à la recherche de son enfant. Elle était entrée dans le feu comme on entre dans un sanctuaire, sans une hésitation, sans même un geste de recul, avec une certitude aveuglante : celle d’y retrouver quelqu’un. Et la porte étroite de la mort, terrifiante et cruelle, s’était changée pour elle en une porte de gloire, celle du sacrifice librement consenti, celle aussi de la paix et de l’éternité. Il suffisait d’un peu... de si peu de courage !
Les yeux grand ouverts, Marianne quitta son abri de feuillage et marcha vers le brasier. Elle ne tremblait pas. La douleur est un puissant opium contre la peur et son tourment était plus puissant que ce chanvre indien dont les prêtres gavaient les veuves hindoues pour les mener passives jusqu’au bûcher de leur époux. Elle voulait y échapper sans que personne eût à souffrir de sa mort. Un accident, rien qu’un accident !... Alors, comme tout à l’heure la pauvre princesse, Marianne se mit à courir vers l’incendie. Une pierre, sur son chemin, la fit choir brutalement, lui causa une douleur aiguë mais ne l’éveilla pas de son envoûtement. Elle se releva, reprit sa course, les oreilles emplies par un vent d’orage au milieu duquel il lui sembla entendre crier son nom. Cela non plus ne l’arrêta pas. Quel que puisse être celui qui appelait, il ne cherchait qu’à la rendre à la monotonie d’une vie dont elle ne voulait plus, à un long sommeil à l’écart de la vraie vie qui, portant en lui des germes de mort, la dissoudrait lentement dans la solitude. La mort qu’elle choisissait, cruelle mais rapide, ouvrait sur une paix plus longue, mais qui n’engendrait ni regrets ni souvenirs.
L’ardeur des flammes était telle que, en recevant leur souffle brûlant au seuil du brasier, Marianne, instinctivement, cacha son visage et recula d’un pas. Elle en eut honte aussitôt, murmura les premières paroles d’une prière et voulut se jeter en avant. Sa robe déchirée prit feu. Une langue brûlante lécha son corps, causant une douleur atroce qui la fit hurler. Mais, au moment précis où elle allait se laisser tomber dans le gouffre de flammes, une masse noire tomba sur elle, l’enveloppa et roula avec elle sur la terre humide. Quelqu’un s’était interposé entre la mort et elle à l’instant suprême, la condamnant à vivre...
Sentant le poids d’un corps, elle se débattit, tenta d’échapper à l’étreinte paralysante sous laquelle les flammes avaient été étouffées et, folle de fureur, chercha à mordre la main qui la maintenait. L’inconnu s’écarta, se releva sur les genoux puis, sèchement et par deux fois, la gifla... Contre le fond rouge de l’incendie, elle ne voyait qu’une silhouette noire vers laquelle, aveuglément, elle voulut se jeter, toutes griffes dehors afin de rendre coup pour coup. Mais l’homme saisit ses deux poignets et les immobilisa. En même temps, une voix glaciale intimait :
— Tenez-vous tranquille ou je recommence ! Pardieu, vous êtes en pleine crise de démence ! Une seconde de plus et vous périssiez carbonisée ! Folle ! Maudite folle ! N’y aurait-il jamais dans votre tête d’écervelée autre chose que du vent, de l’égoïsme et de la stupidité ?
Amollie soudain, comme la corde de l’arc libérée par l’archer fatigué, Marianne écoutait Jason déverser sur elle un torrent d’injures avec le ravissement qu’elle eût réservé à une musique céleste. Elle n’essayait même pas de savoir par quel miracle il était là, par quel prodige inouï il avait pu l’arracher aux flammes alors qu’elle l’avait vu partir si peu de temps auparavant. La seule chose qui comptât pour, elle, c’était justement qu’il fût là. Sa colère n’était rien, que la preuve d’un petit reste d’intérêt et, pour qu’il demeurât ainsi, à genoux auprès d’elle, Marianne était prête à se laisser insulter tout le reste de la nuit. La douleur même de ses poignets qu’il meurtrissait était une joie de plus.
Avec un soupir de bonheur, et sans souci de ses blessures, elle se laissa retomber dans l’herbe et sourit de tout son cœur à la noire silhouette de son ami.
— Jason ! murmura-t-elle. Vous êtes là... vous êtes revenu...

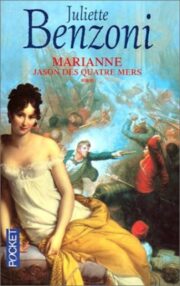
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.