Il lâcha brusquement ses poignets et cessa de crier, considérant avec une sorte d’hébétude la forme gracieuse étendue devant lui, à peine couverte de quelques lambeaux de drap d’or entre lesquels la peau meurtrie apparaissait avec de longues traînées de sang. De sa manche, il essuya machinalement son front en sueur, rejetant en arrière ses cheveux qui collaient, cherchant à apaiser la terreur mêlée de colère qui s’était emparée de lui quand, dans cette femme courant follement vers l’incendie, il avait reconnu Marianne. Et maintenant, elle le regardait comme une apparition céleste, avec ses grands yeux verts tout brillants de larmes, elle le regardait en souriant comme si de cuisantes brûlures ne mordaient pas sa chair, Comme si cette dernière était insensible... Mais lui-même ne sentait pas les brûlures de ces flammes qu’il avait étouffées entre leurs deux corps, tout entier à la joie d’être arrivé à temps. Jamais il n’avait éprouvé une aussi grande fatigue. C’était comme si ces dernières minutes l’avaient vidé de toute son énergie...
Marianne, elle, était en pleine extase. L’univers de bruit et de fureur qui les entourait avait totalement disparu pour elle. Seule demeurait cette forme sombre qui la regardait sans rien dire, respirant lourdement parce que son cœur cognait trop fort dans sa poitrine. Elle voulut le toucher, chercher dans sa force un refuge trop longtemps attendu et tendit les bras pour l’attirer vers elle. Mais le geste ébauché s’acheva dans un cri d’agonie. Une douleur terrible, fulgurante, venait de lui déchirer les entrailles.
Instantanément Jason fut debout et regarda sans comprendre Marianne se tordre dans l’herbe à ses pieds.
— Qu’... qu’avez-vous ? Vous êtes blessée ?
— Je... ne sais pas ! Mais j’ai mal... j’ai... oh !
De nouveau il se pencha vers elle, voulut relever sa tête qui roulait dans tous les sens, mais une longue plainte s’échappa des lèvres décolorées, tandis que le corps s’arquait sous l’assaut d’une nouvelle douleur. Quand cette douleur fut apaisée, Marianne, le visage couleur de cendre, haletait comme une bête malade. Elle jeta sur Jason, presque aussi pâle qu’elle-même, un regard terrifié... Quelque chose de chaud mouillait ses jambes et, dans le temps d’un éclair, elle venait de comprendre ce qui lui arrivait.
— Mon... mon enfant ! souffla-t-elle. Je vais... le perdre !
— Comment ? Vous êtes... enceinte ?
Elle fit oui des paupières pour garder ses forces car une nouvelle douleur naissait au fond d’elle-même.
— C’est vrai ! Vous êtes mariée ! Et où est donc votre prince, Altesse Sérénissime ?
Comment pouvait-il se moquer d’elle quand il la voyait souffrir à ce point ? Elle s’agrippa de toutes ses forces à son bras pour mieux lutter, poussa une longue plainte puis gémit :
— Je ne sais pas ! Très loin ! En Italie... Par pitié allez chercher de l’aide ! L’enfant... l’Empereur... je voudrais...
Le reste se perdit dans un cri. Jason bondit sur ses pieds, jura superbement, puis prit sa course vers un groupe de personnes qui, massées près du petit temple, regardaient avec des yeux de somnambules la grande salle et la galerie achever de se consumer. On voyait maintenant, de l’autre côté des flammes mourantes, les murs noircis de l’ambassade, ses fenêtres éclatées et le peuple de valets et de soldats qui cherchaient à éteindre les pièces atteintes par le feu. Il aperçut Napoléon, courut à lui. Marianne n’avait-elle pas parlé de l’Empereur en même temps que de l’enfant ?
Quelques instants plus tard, Marianne, qui émergeait d’une nouvelle vague de souffrance, vit se pencher sur elle les deux visages de Napoléon et de Jason. Elle entendit la voix tendue de l’Empereur :
— Elle fait une fausse couche ! gronda-t-il. Vite ! Une civière ! Il faut la porter hors d’ici ! Et trouver Corvisart... Il doit être quelque part vers la ferme à soigner les blessés. Holà ! vous autres ! Par ici !...
Marianne n’entendit pas la suite, ne vit pas qui l’Empereur appelait ainsi. Elle était seulement consciente du fait que Jason s’éloignait et elle se souleva pour le rappeler. La main de Napoléon la força doucement à s’étendre de nouveau puis, ôtant vivement sa veste, il la roula en boule et la glissa sous la tête de la jeune femme.
— Doucement, carissima mia !... Ne bouge pas ! On va venir, on va t’aider, te soigner ! N’aie pas peur, surtout ! Je suis là !
Il chercha sa main moite et la serra. Elle leva vers fui des yeux pleins de reconnaissance. Il l’aimait donc encore un peu ? Elle n’était donc pas tout à fait seule au monde avec son cœur déçu et son corps torturé. Cette main ferme et chaude qui tenait la sienne était bonne, rassurante... Oubliant qu’elle avait voulu mourir, Marianne s’y raccrocha comme l’enfant perdue qu’elle était aurait pu se raccrocher à son père... à cette différence que, peut-être, le bel officier de Mestre-de-Camp-Général n’aurait pas eu cette douceur, cette tendresse pour sa fille en détresse.
Reprise par une marée de souffrance, elle sentit malgré tout qu’on l’enlevait doucement, qu’on l’emportait aussi vite que possible à travers le jardin dévasté où le vent du soir faisait voler les cendres encore chaudes. Avidement, durant une accalmie, elle chercha Jason, ne le vit pas et murmura son nom. La main de l’Empereur qui n’avait pas quitté la sienne la serra plus fort. Il se pencha.
— Je l’ai renvoyé auprès de sa femme. Tu n’avais plus besoin de lui puisque je suis là... Il n’est qu’un ami pour toi.
Un ami !... Le mot, qu’elle-même aurait prononcé de si bon cœur la veille encore, la crucifia. Un ami... rien qu’un ami et peut-être moins encore si cette Pilar le lui défendait ! Tout à l’heure, pourtant, elle avait cru qu’il lui revenait ! Mais non ! Tout était fini ! Jason était retourné vers sa femme et il n’y avait plus rien à espérer, sinon, peut-être, la mort qui, tout à l’heure, n’avait pas voulu d’elle. Le sang coulait toujours, lentement, de son corps blessé. Avec lui s’en allait la vie...
Elle eut un petit soupir tremblant, résigné, puis s’abandonna à la souffrance...
4
LE CHOCOLAT DE MONSIEUR CAREME
Le baron Corvisart baissa les manches de sa chemise, attacha soigneusement ses manchettes de linon plissé, passa l’habit de fin drap bleu que lui tendait Fortunée Hamelin puis, après un coup d’œil rapide à un miroir pour s’assurer que l’ordre de ses beaux cheveux blancs était toujours aussi parfait, il revint lentement vers le lit de Marianne. Un instant, il considéra silencieusement le visage amaigri de la jeune femme, puis ses mains, qui, sur la blancheur des draps, semblaient de fragiles objets d’ivoire.
— Vous voilà hors d’affaire, jeune dame ! dit-il enfin. Maintenant, il faut reprendre des forces, manger, commencer à vous lever... Vous êtes sauvée, mais je n’aime pas votre mine ! Il faut changer cela !
— Croyez bien que j’en suis navrée, mon cher docteur, et que je voudrais beaucoup vous faire plaisir. Vous m’avez soignée avec tant de patience et de dévouement ! Mais je n’ai envie de rien... et surtout pas de nourriture ! Je me sens si lasse...
— Et si vous ne mangez pas, vous vous sentirez chaque jour un peu plus lasse encore, gronda le médecin de l’Empereur. Vous avez perdu beaucoup de sang, il faut vous en refaire ! Vous êtes jeune, que diable ! Vigoureuse sous votre aspect délicat ! A votre âge, on ne se laisse pas dépérir pour une fausse couche et quelques brûlures ! Comment croyez-vous que l’Empereur me recevra quand je lui dirai que vous n’obéissez pas à mes prescriptions et que vous refusez de recommencer à vivre ?
— Ce n’est pas votre faute.
— Ouais ! Si vous vous imaginez que Sa Majesté l’entendra de cette oreille ! Quand elle donne des ordres, elle compte être obéie et nous avons chacun reçu un ordre : moi de vous guérir, vous de recouvrer la santé au plus vite. Nous n’avons le choix ni l’un ni l’autre. Et je vous rappelle que, chaque matin, quand je me rends à son petit lever, l’Empereur s’inquiète de vous.
Marianne tourna la tête sur son oreiller pour qu’il ne vît pas les larmes qui montaient à ses yeux.
— L’Empereur est très bon, fit-elle d’une voix enrouée.
— Il l’est surtout pour ceux qu’il aime ! rectifia Corvisart. Quoi qu’il en soit, j’ai l’intention de lui dire demain matin que vous êtes guérie. Arrangez-vous pour ne pas me faire mentir, ma chère princesse !
— J’essaierai, docteur, j’essaierai.
Le médecin sourit puis, d’un geste impulsif, tapota affectueusement la joue de sa malade.
— A la bonne heure, ma petite fille ! J’aime mieux ce langage. A demain ! Je vais donner des ordres à vos gens et je reviendrai voir comment vous les avez suivis ! Madame Hamelin, je suis votre serviteur.
S’inclinant devant la belle créole, Corvisart alla prendre sur une console son chapeau, sa canne et ses gants, et sortit de la chambre en refermant doucement la porte. Lentement, alors, Fortunée quitta son fauteuil et vint s’asseoir au bord du lit de son amie l’enveloppant de son parfum de rose. La robe qu’elle portait, en simple batiste brodée de fleurettes multicolores, était accordée à la chaleur de cette journée d’été et lui donnait l’air d’une jeune fille. Une grande capeline de paille naturelle se balançait par son ruban au bout de ses doigts sortant de mitaines blanches. En face d’elle, Marianne se sentait étrangement vieille et lasse. Elle lui jeta un regard si désolé que Fortunée fronça les sourcils.
— Je ne te comprends pas, Marianne, dit-elle enfin. Depuis bientôt une semaine que tu es malade, tu t’es comportée exactement comme si tu cherchais par tous les moyens à en finir avec la vie ! Cela ne te ressemble pas.
— Cela ne me ressemblait pas. Maintenant, c’est vrai, je n’ai plus envie de vivre. Pour quoi ? Pour qui ?
— C’était... si important cet enfant ?
A nouveau les larmes montèrent aux yeux de Marianne et, cette fois, elle n’essaya pas de les retenir. Elle les laissa couler librement.
— Bien sûr, c’était important ! C’était même tout ce qu’il pouvait y avoir encore d’important dans ma vie, c’était ma seule raison d’exister. J’aurais vécu pour lui, avec lui, par lui. Il portait tous mes espoirs... et pas seulement les miens...
Depuis qu’en reprenant connaissance, à l’issue de la nuit tragique, elle avait appris qu’elle avait perdu l’enfant, Marianne se désespérait et se faisait les plus sanglants reproches. Tout d’abord, pour avoir, durant ses heures terribles, complètement oublié qu’elle allait être mère. Du moment où elle avait revu Jason, tout ce qui, jusque-là, avait eu pour elle quelque importance avait soudainement disparu devant la découverte aveuglante d’un amour qu’elle avait porté en elle durant des mois sans jamais le soupçonner. Le parc illuminé par le feu d’artifice avait été son chemin de Damas, à elle et, comme jadis Saul de Tarse, elle en était sortie aveugle, aveugle à tout ce qui l’entourait, aveugle au monde, aveugle à sa propre vie, aveugle à ce qui n’était pas cet amour dont la profondeur s’était révélée telle que Marianne ne pouvait, sans vertige, se pencher sur lui. Et elle avait follement mis en péril la vie de l’enfant en jouant la sienne, en cherchant à la perdre ! Pas une minute elle n’avait songé à lui... ni à cet autre qui, là-bas, dans la villa de Toscane, attendrait indéfiniment l’annonce d’une naissance à laquelle il avait accroché toute sa misérable vie d’emmuré !
Corrado Sant’Anna ne l’avait épousée qu’à cause de l’enfant de sang impérial auquel il pourrait donner son nom. Et voilà que, par sa propre faute, Marianne avait perdu tout espoir d’accomplir sa part du contrat. Le prince avait fait un marché de dupe !
— Tu penses à ton mystérieux époux, n’est-ce pas ? dit Fortunée doucement.
— Oui. Et j’ai honte de moi, j’ai honte, tu entends, parce que, ce nom que je porte, il me semble maintenant que je l’ai volé ?
— Volé ? Pourquoi donc ?
— Je te l’ai déjà dit, fit Marianne avec lassitude : le prince Sant’Anna ne m’a épousée qu’à cause de cet enfant, parce qu’il était du sang de l’Empereur et qu’alors le prince pouvait, sans déchoir, en accepter la paternité.
— Alors, parce que tu l’as perdu, tu te juges indigne de vivre et, si j’ai bien compris tes projets immédiats, tu as décidé simplement de te laisser dépérir jusqu’à ce que mort s’ensuive ?
— C’est assez ça... Mais ne crois pas que je cherche à me punir en souhaitant la mort. Non, je te l’ai dit : je n’ai plus envie de vivre, tout simplement.
Fortunée se leva, fit quelques pas irrités dans la chambre, alla jusqu’à la fenêtre qu’elle ouvrit en grand, puis revint se planter en face du lit.

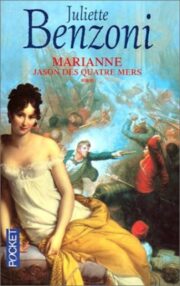
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.