— Parce que, fit-il gravement, la femme que j’ai vue, au bal et dans l’incendie, n’était plus celle que j’avais connue. C’était une femme glacée, lointaine, au regard vide... une femme qui voulait mourir. Car, possédant tout ce qu’une créature humaine peut souhaiter : beauté, richesse, honneurs, plus l’amour d’un homme exceptionnel... et enceinte par-dessus le marché, vous avez voulu mourir et d’une mort atroce. Pourquoi, Marianne ?
Une vague de chaleur parcourut le corps de la jeune femme, réveillant les fibres profondes anesthésiées par la souffrance physique et le désespoir moral. Ainsi, il avait joué la comédie de l’indifférence, de l’ironie ? A le voir là, près d’elle, avec cette expression tendue qui avouait son inquiétude, elle en prenait une conscience plus aiguë de son amour pour lui. Cette impression fut si violente qu’un instant elle éprouva une folle envie de lui dire toute la vérité, de lui dire que, si elle avait voulu mourir, c’était de la douleur de l’avoir perdu. Elle fut sur le point de lui avouer, à cette minute, combien elle l’aimait et combien cet amour l’émerveillait. Mais elle se reprit à temps. L’homme qui était en face d’elle était un homme marié. Il n’avait plus le droit ni sans doute l’envie de s’entendre parler d’amour, car seule l’amitié l’avait mené ici. Et Marianne avait trop d’honnêteté foncière pour ne pas respecter le mariage chez les autres, même si son expérience en la matière se traduisait par un double désastre.
Elle trouva cependant le courage de sourire, sans s’apercevoir -que son sourire était plus triste que des larmes et, comme il répétait « Pourquoi ? » elle répondit enfin :
— Peut-être à cause de tout cela, tout au moins de ce qui, en cela, n’est en réalité qu’un leurre. L’Empereur est marié, Jason, heureux de l’être... et je ne suis plus pour lui qu’une amie tendre et dévouée. Je crois qu’il aime sa femme. Quant à moi...
— Vous l’aimez toujours, n’est-ce pas ?
— Je l’aime... bien, et surtout je l’admire passionnément.
— Mais l’enfant, l’enfant était-il un leurre lui aussi ?
— Non. Il était même le seul lien qui nous attachât irrévocablement l’un à l’autre. Peut-être est-ce mieux ainsi, pour lui tout au moins, car pour moi cela complique singulièrement les choses avec le prince Sant’Anna... mais, au fait, s’écria tout à coup Marianne, si vous êtes venu ici tous ces jours-ci, vous avez certainement rencontré Arcadius ?
— Naturellement.
— Alors, ne me dites pas qu’il ne vous a rien raconté ? Je suis certaine qu’il vous a tout dit sur ce mariage.
— En effet, fit Jason tranquillement. Il m’a tout dit... mais je voulais entendre votre version des choses. Il m’a dit d’abord qu’une lettre m’attendait toujours à Nantes, chez Patterson... à Nantes où je n’ai pas touché terre parce qu’un corsaire anglais m’avait pris en chasse et que j’ai dû fuir pour éviter le combat.
— Eviter le combat, vous ?
— Les Etats-Unis ne sont pas en guerre avec l’Angleterre, mais j’aurais dû passer outre, réduire cet
Anglais et revenir à Nantes. Tant de choses eussent été différentes ! Vous ne savez pas à quel point j’ai pu me reprocher mon obéissance aux lois.
Il s’était levé et, comme Fortunée tout à l’heure, avait marché lentement jusqu’à la fenêtre. Son dur profil et ses larges épaules se découpèrent sur le fond verdoyant du jardin. Marianne retint son souffle, envahie qu’elle était d’une émotion à la fois douce et angoissante devant la colère, réelle cette fois, que trahissait la voix de Jason.
— Vous avez regretté de n’avoir pas eu cette lettre ? Est-ce que... vous auriez accepté ce que je vous demandais ?
En trois pas il revint à elle, saisit ses deux mains dans les siennes et mit un genou à terre auprès du lit pour être au même niveau que Marianne.
— Et vous ? demanda-t-il âprement, vous auriez rempli loyalement votre engagement envers moi ? Vous m’auriez suivi ? Vous auriez tout quitté ? Vous seriez vraiment devenue ma femme sans arrière-pensée, sans regret ?
Bouleversée, Marianne plongea son regard dans les yeux de son ami, cherchant à deviner une vérité qu’elle pressentait merveilleuse, mais à laquelle elle n’osait croire.
— Sans regret, sans arrière-pensée, Jason... et même avec une joie dont je n’ai eu conscience que voici bien peu de temps. Vous ne saurez jamais à quel point je vous ai attendu... jusqu’à la dernière seconde, Jason, jusqu’à la dernière seconde. Et, quand il a été trop tard...
— Taisez-vous !
Il enfouit soudain son visage dans la blancheur des draps et, sur sa main, Marianne sentit la chaleur de sa bouche. Tout doucement, presque en tremblant, elle posa sa main libre sur les épais cheveux noirs du marin, effleura d’une caresse les mèches rebelles, heureuse de cette faiblesse qu’il montrait soudain, lui, l’homme indestructible, plus heureuse encore de le sentir aussi bouleversé qu’elle-même.
— Vous comprenez maintenant, dit-elle tout bas, pourquoi, l’autre soir, j’ai voulu mourir. Quand je vous ai vu avec... Oh ! Jason ! Jason ! Pourquoi vous êtes-vous marié ?
Aussi brusquement qu’il s’était jeté vers elle, il s’en arracha, se releva et lui tourna le dos.
— Je vous croyais à jamais perdue pour moi, gronda-t-il sourdement. On ne lutte pas contre Napoléon, surtout quand il aime ! Et je savais qu’il vous aimait... Pilar, elle, avait besoin d’aide. Elle était en danger de mort. Son père, don Agostino, ne cachait pas ses sympathies pour les Etats-Unis. A sa mort, voici quelques semaines, le gouverneur espagnol de Fernandina s’en est pris aussitôt à Pilar, son unique héritière. Il a confisqué ses terres et elle allait être jetée dans une prison sans beaucoup d’espoir d’en sortir. La seule façon de la sauver et de la mettre définitivement à l’abri était de lui donner la nationalité américaine. Je l’ai épousée.
— Etiez-vous obligé d’aller si loin ? Ne pouviez-vous l’emmener dans votre pays, l’installer, veiller sur elle ?
Jason haussa les épaules.
— Elle est espagnole. Les choses ne sont pas si simples avec ces gens-là ! Et je devais beaucoup à son père. Au moment de la mort de mes parents, don Agostino a été le seul à m’offrir son aide. Je connais Pilar depuis toujours.
— Et, bien sûr, elle vous aime... depuis toujours ?
— Je crois... oui !
Marianne se tut. Eblouie par la révélation de son amour, elle découvrait seulement maintenant qu’elle ne savait rien, ou à peu près rien, de ce qu’avait été la vie de Jason Beaufort, avant qu’il n’apparût, un soir d’automne, dans le salon de Selton Hall. Il avait vécu tant d’années sans elle, sans même soupçonner qu’elle existât ! Jusqu’à présent, Marianne n’avait songé à Jason que par rapport à elle-même et qu’en fonction du rôle qu’il jouait dans sa vie, mais, derrière lui, dans ce pays immense, mystérieux pour elle et même vaguement inquiétant, il avait tissé des liens, creusé une trace qui lui était propre. Sa mémoire était pleine de paysages dans lesquels Marianne ne s’était jamais inscrite, de visages qu’elle n’avait jamais vus et qui, cependant, suscitaient chez Jason des sentiments divers allant, peut-être, de la haine à l’amour. Ce monde-là, en partie tout au moins, c’était aussi celui de Pilar. Il lui était familier ; elle s’y mouvait à l’aise et ces images communes devaient tisser entre elle et Jason l’un de ces liens faits des mêmes goûts, des mêmes souvenirs qui se révèlent souvent plus étroits et plus solides que les chaînes flamboyantes de la passion. Et Marianne résuma ce qu’elle éprouvait en une petite phrase triste :
— Je vous aime et, cependant, je ne vous connais pas !
— Moi, il me semble que je vous ai toujours connue, s’écria-t-il en l’enveloppant d’un regard lourd de souffrance, et pourtant cela ne sert à rien. Nous avons laissé passer l’heure que le destin avait marquée pour y croiser nos chemins. Maintenant, il est trop tard !
Une soudaine révolte souleva Marianne hors de son habituelle réserve.
— Pourquoi trop tard ? Vous l’avez dit, vous n’aimez pas cette Pilar.
— Pas plus que vous n’aimez l’homme qui vous a donné son nom, mais le fait n’en demeure pas moins. Vous portez ce nom, comme Pilar porte le mien. Dieu sait combien j’ai horreur de jouer les moralistes ! Et j’éprouve une irrésistible sensation de ridicule à le faire avec vous, mais, Marianne, nous n’avons pas le choix. Nous devons respecter ceux qui nous ont fait confiance... ou tout au moins ne rien faire dont ils pourraient avoir à souffrir.
— Ah ! fit Marianne. Elle est jalouse...
— Comme une Espagnole. Elle sait que je ne l’aime pas vraiment, mais elle s’attend à du respect, à de l’affection et à ce qu’au moins je donne extérieurement à notre mariage les couleurs, sinon de l’amour, du moins de l’entente parfaite.
De nouveau un silence, que Marianne employa à peser les paroles de Jason. La joie de tout à l’heure s’éteignait devant la dure réalité. Homme de toutes les aventures, de tous les risques et de toutes les audaces, Jason, cependant, et Marianne le savait bien, ne transigeait jamais avec lui-même et il s’attendait à ce que la femme qu’il aimait fît preuve de la même force... Il n’y avait pas grande discussion à apporter à ce genre de détermination. Marianne soupira.
— Si j’ai bien compris, vous êtes venu me dire adieu... Je suppose que vous partez bientôt. Votre femme n’a pas l’air d’apprécier son séjour ici.
Une flamme amusée brilla un instant dans les yeux de l’Américain.
— Elle trouve que les femmes y sont trop belles et trop hardies. Bien sûr, elle a confiance en moi, mais elle préférera cent fois, quand je ne suis pas auprès d’elle, me savoir en mer que dans un salon. Nous restons ici encore une quinzaine. Un ami de mon père, le banquier Baguenault, nous a offert l’hospitalité dans son hôtel de la rue de Seine à Passy... une très belle maison dans un grand jardin qui a été, jadis, la propriété d’une amie de la reine Marie-Antoinette. Pilar s’y plaît assez à condition de ne pas en sortir et j’ai quelques affaires à régler. Ensuite, nous regagnerons l’Amérique. Mon bateau nous attend à Morlaix.
Le ton était redevenu celui de la conversation mondaine et Marianne, au fond de son nid de dentelles, en soupira de regret. L’éclat passionné de tout à l’heure s’était éteint par la volonté inflexible de Jason. Jamais ils n’y reviendraient sans doute. Cette volonté les séparait aussi fermement que l’océan immense qui bientôt s’étendrait entre eux. Le bateau dont elle avait parfois rêvé, c’était une autre qu’il emporterait. Quelque chose se terminait qui n’avait jamais commencé et Marianne sentit qu’elle ne pourrait plus bien longtemps retenir ses larmes. Elle ferma les yeux un instant, serra les dents, prit une profonde respiration puis, finalement, murmura :
— Alors... disons-nous adieu maintenant, Jason ! Je vous souhaite... d’être heureux.
Il s’était levé, reprenait sa canne et son chapeau, mais, les yeux rivés au sol, ne la regardait pas.
— Je n’en demande pas tant, fit-il avec une dureté involontaire. Souhaitez-moi seulement la paix intérieure ! Ce sera très suffisant. Quant à vous...
— Non... par pitié, ne me souhaitez rien !
Il se retourna, marcha vers la porte. Le regard éperdu de Marianne suivit sa haute silhouette. Il allait partir, sortir de sa vie, rejoindre le monde de Pilar alors que la somme de leurs souvenirs communs était encore si mince ! Une sorte de panique s’empara d’elle et, comme il posait la main sur le bouton de la porte, elle ne put retenir un cri.
— Jason !
Lentement, très lentement, le regard bleu revint à elle chargé d’une lassitude qui bouleversa Marianne. Jason, tout à coup, paraissait plus vieux.
— Oui ? fit-il d’une voix contenue.
— Ne voulez-vous pas... puisque nous ne nous reverrons plus, m’embrasser avant de me quitter ?
Elle crut qu’il allait bondir vers elle. L’élan qui le saisit fut visible, presque palpable. Mais il se contint au prix d’un effort qui fit blanchir les jointures de sa main brune sur le pommeau d’ivoire de la canne et alluma des éclairs de fureur dans ses yeux.
— N’avez-vous rien compris ? gronda-t-il entre ses dents serrées. Que croyez-vous qu’il arriverait si, en ce moment, je vous touchais seulement du bout des doigts ? Dans quelques instants vous seriez devenue ma maîtresse et il ne me serait certainement plus possible de m’arracher à vous. En quittant cette chambre, j’aurais perdu tout respect de moi-même... et peut-être de vous. Je ne serais plus autre chose que votre esclave... et je ne vous le pardonnerais pas !
Epuisée cette fois, Marianne, qui s’était soulevée pour tendre une main vers lui, se laissa retomber dans ses oreillers.

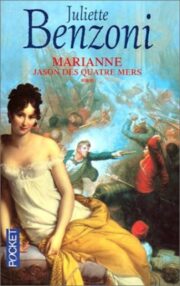
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.