Tchernytchev découvrit toutes ses dents en un sourire que Marianne ne put s’empêcher de juger féroce, mais sa voix était douce comme un velours en répondant :
— Vous savez bien que je suis un Tartare ! Un jour, sur le chemin de Samarcande, où l’herbe ne poussait plus depuis que les cavaliers de Gengis Khan l’avaient écrasée, un pauvre caravanier trouva la plus belle des émeraudes, échappée sans doute au butin d’un pillard. Il était pauvre, il avait faim, il avait froid et la pierre représentait une énorme fortune. Pourtant, au lieu de la vendre et de vivre désormais dans l’aisance et la joie, le pauvre caravanier garda l’émeraude, la cacha dans un pli de son turban crasseux et, de ce jour, n’eut plus ni faim ni soif car il avait perdu le boire et le manger. Seule comptait l’émeraude. Alors, pour être certain que nul ne la lui prendrait, il s’enfonça dans le désert, plus loin, toujours plus loin, jusqu’à des grottes profondes et inaccessibles où il n’avait rien d’autre à attendre que la mort. Et la mort vint... la plus lente, la plus cruelle, mais il la vit venir en souriant parce que l’émeraude était contre son cœur.
— L’histoire est jolie, fit Marianne calmement, et la parabole des plus flatteuses, mais, mon cher comte, je vais en arriver à me réjouir de vous voir repartir prochainement pour Saint-Pétersbourg ! Vous êtes vraiment un ami trop dangereux !
— Vous vous trompez, Marianne, je ne suis pas votre ami. Je vous aime et je vous veux, rien d’autre. Et ne vous réjouissez pas trop de mon départ : je reviendrai bientôt ! D’ailleurs...
Il n’alla pas plus loin. D’un peu partout des « chut ! » indignés et vigoureux fusaient autour d’eux et, sur la scène, Talma levait vers la loge un regard lourd de reproches. Marianne abrita un sourire derrière son éventail et se mit en devoir d’écouter. Satisfait, Talma-Néron revint à Junie et lança superbement :
Songez-y donc, Madame, et pesez en vous-même,
Ce choix digne des soins d’un prince qui vous aime,
Digne de vos beaux yeux trop longtemps captivés,
Digne de l’univers à qui vous vous devez...
— Mais, écoutez-le donc, madame ! ricana tout bas le Russe, ce soir, Néron parle comme un livre ! On dirait qu’il m’a entendu.
Marianne se contenta de hausser les épaules, sachant bien que la moindre réponse entraînerait la suite du dialogue et du mécontentement des spectateurs. Mais, ce soir, Racine l’ennuyait et elle n’avait pas envie d’écouter. D’ailleurs, ce n’était pas pour Britannicus, ni même pour Talma qu’elle était venue au théâtre, mais uniquement pour y voir Jason et surtout être vue de lui. Elle, se mit en devoir d’examiner discrètement son entourage.
L’Empereur étant retourné à Compiègne avec l’Impératrice, il y avait assez peu de personnes appartenant à la Cour et la loge impériale eût sans doute été vide si la princesse Pauline ne l’avait occupée. La plus jeune des sœurs de Napoléon, en effet, n’appréciait guère les festivités de Compiègne et préférait de beaucoup passer l’été dans son château de Neuilly, dont elle terminait tout juste l’installation. Ce soir, elle rayonnait de joie de vivre entre Metternich, superbe dans un habit bleu sombre qui allait bien à son élégante silhouette et à ses cheveux blonds, et un jeune officier allemand, Conrad Friedrich, qui était le dernier amant en date de la plus jolie des Bonaparte.
Avec Marianne, la princesse était la seule femme de l’assistance à avoir osé transgresser les ordres impériaux. Sa robe de mousseline neigeuse, décolletée aux limites de la décence, semblait surtout destinée à déshabiller avec subtilité un corps justement célèbre et à mettre en valeur une magnifique parure de turquoises d’un bleu lumineux qui étaient le dernier cadeau de Napoléon à Notre-Dame des Colifichets.
Marianne ne s’étonna nullement de voir Pauline adresser un éclatant sourire à Tchernytchev. Il y avait beau temps que le fringant courrier du Tzar était passé par l’alcôve de la princesse. Il est vrai que ce sourire vint s’achever sur Talma qui, d’émotion, faillit manquer un vers. Pauline non plus ne venait pas au théâtre pour écouter mais pour s’y faire admirer et constater l’effet, toujours assez vif, que sa présence produisait sur les hommes de l’assistance.
Non loin de la loge impériale, le prince de Cambacérès, énorme et surdoré à son habitude, somnolait dans son fauteuil, noyé dans les béatitudes d’une heureuse digestion, tandis qu’auprès de lui le ministre des Finances Gaudin, élégant et archaïque à la fois, avec son habit à la dernière mode et sa perruque à marteaux, semblait trouver dans sa tabatière infiniment plus de délices que sur la scène. Dans une loge un peu sombre, Marianne aperçut Fortunée Hamelin, en tendre conversation avec un hussard qu’il ne lui fut pas possible d’identifier, mais que la belle Mme Récamier surveillait avec une nonchalance affectée et une très réelle attention. A côté, chez l’Intendant général aux Armées, la belle comtesse Daru, sa femme, en robe de satin bleu paon, rêvait auprès de son cousin, un jeune auditeur au Conseil d’Etat, nommé Henri Beyle, dont le large visage sans beauté était sauvé de la vulgarité par un front magnifique, un œil vif et perçant et une bouche au pli sardonique. Enfin, dans une vaste loge de face, le maréchal Berthier, prince de Wagram, se dépensait sans compter pour dispenser une égale galanterie à sa femme, une princesse de Bavière laide, bonne et placide, et sa maîtresse, la tumultueuse, beaucoup trop grosse et vipérine marquise Visconti, une vieille liaison qui avait toujours eu le don d’exaspérer Napoléon. La plupart des autres spectateurs étaient des étrangers, Autrichiens, Polonais, Russes, Allemands, venus à Paris pour le mariage et dont une bonne moitié ne comprenaient visiblement rien à Racine. Parmi ceux-ci, la palme de la beauté revenait à l’éclatante et blonde comtesse Potocka, la plus récente conquête du beau Flahaut. Tous deux occupaient une loge discrète, elle rayonnante, lui encore pâle de sa convalescence, mais ne regardant qu’eux-mêmes.
« Talma n’a pas de chance ! pensa Marianne tandis que l’acte s’achevait néanmoins dans un tonnerre d’applaudissements, ceux qui n’avaient pas écouté ou pas compris cherchant ainsi visiblement à se faire pardonner. Il faut que l’Empereur soit là pour que les spectateurs se donnent vraiment la peine d’écouter... Quand il y est, personne n’ose broncher... »
Avec l’entracte, la salle de la Comédie-Française s’emplissait de bruit, de rires et de conversations. Le bon ton voulait qu’une grande activité s’emparât des hommes qui devaient aller saluer dans leurs loges toutes les femmes de leurs amis, celles-ci recevant hommages et visites avec autant de grâce et de dignité que dans leurs demeures. Dans certaines loges, pourvues de petits salons, on croquait des bonbons, on dégustait des sorbets et des liqueurs. Le théâtre n’étant plus alors qu’un prétexte à papotages, une manifestation comme une autre de la vie mondaine.
Marianne connaissait bien cette coutume et, dès l’instant où le rideau était retombé sur le salut des artistes, elle avait attendu fiévreusement ce qui allait suivre. Jason viendrait-il la saluer ou bien demeurerait-il dans la loge, auprès de Talleyrand et des autres invités du prince ? Elle brûlait d’envie de le voir de plus près, de toucher sa main, de chercher dans ses yeux un regard comme il en avait eu tellement pour elle durant la folle équipée de Malmaison. Et, s’il quittait la loge, viendrait-il vers elle... ou réserverait-il à une autre dame cette précieuse visite ? Peut-être que la présence de Tchernytchev auprès d’elle le gênait ? Peut-être qu’elle aurait mieux fait de ne pas se faire escorter de cet homme encombrant ? Mais elle avait tort de se tourmenter.
A l’exemple des autres hommes, Tchernytchev s’était levé. Avec ennui, il s’excusait auprès de Marianne de devoir la quitter un instant : d’un geste impérieux et qui ne laissait place à aucune équivoque, la princesse Pauline l’avait appelé.
— Allez ! fit la jeune femme, l’esprit et les yeux ailleurs, essayant seulement de cacher sa joie.
Elle surveillait la loge de Talleyrand où le prince, en s’appuyant sur sa canne, se levait avec effort et s’apprêtait à sortir en compagnie de Jason. Les yeux de Marianne brillèrent d’impatience. Si Jason escortait Talleyrand, celui-ci ne pourrait pas ne pas le conduire auprès de la princesse Sant’Anna ! Elle allait donc le voir !...
Cependant, voyant que Marianne n’avait pas l’air de se soucier de lui, Tchernytchev fronçait les sourcils et remarquait avec humeur :
— Cela m’ennuie de vous laisser seule !
— Je ne le serai pas longtemps... Allez donc ! La princesse s’impatiente...
En effet, Pauline Borghèse répétait à l’adresse du Russe son geste d’invitation. Réprimant un mouvement de contrariété, Tchernytchev se dirigea vers la porte de la loge et, sur le seuil, dut s’effacer pour laisser passer Fortunée Hamelin. Fraîche comme une laitue dans une robe de brocart vert cru rebrodée de petites perles de cristal qui lui donnait l’air de sortir tout juste d’un jet d’eau, la créole lui décocha avec un sourire provocant :
— Apparemment, Son Altesse n’aime pas que l’un de ses étalons favoris aille gambader dans les prairies voisines ! dit-elle gaiement. Courez, mon cher comte, sinon vous risquez d’être fort mal reçu !
Le beau colonel se hâta d’obéir en se gardant bien de relever le propos. Fortunée était assez connue pour une certaine verdeur de langage qui, d’ailleurs, ne lui messeyait pas. Rayonnante, elle s’avança vers son amie qui se détournait pour lui sourire, cachant de son mieux sa contrariété de n’être plus seule. La loge, tout d’un coup, embauma la rose.
— Ma foi, soupira Mme Hamelin en s’installant auprès de son amie, je n’ai pu résister à l’envie de venir voir les choses d’un peu plus près, quand j’ai reconnu notre Américain dans la loge du cher prince.
— Et ton hussard ? demanda Marianne ironiquement, qu’en as-tu fait ?
— Je l’ai envoyé boire du café. Il avait un peu trop tendance à s’endormir et je n’aime pas que l’on somnole bêtement quand je suis là ! C’est offensant. Mais dis-moi, mon cœur, ce Murillo revêche drapé dans ses dentelles noires, serait-il l’épouse légitime de notre intéressant pirate ? Elle sent la très catholique Espagne à dix lieues et je parie qu’elle se parfume à l’encens.
— Oui... C’est la señora Pilar. Mais Jason n’est pas un pirate.
— Permets-moi de le regretter. Il ne s’encombrerait pas alors de préjugés hors d’âge et aussi poussiéreux qu’une sierra espagnole. Quoi qu’il en soit, pirate ou pas, j’espère qu’il fait actuellement route vers cette loge pour venir te saluer ?
— Peut-être ! fit Marianne avec un pâle sourire, mais rien n’est moins sûr.
Elle trouvait, en effet, que les deux hommes mettaient bien du temps à parcourir la galerie.
— Allons donc ! Talleyrand sait son monde et comme il l’a pris en remorque je suis certaine que nous allons les voir apparaître d’un instant à l’autre. Sois sans crainte, ajouta-t-elle en posant une main apaisante sur les genoux de son amie, je sais sur le bout des doigts mon rôle de confidente... et j’ai une foule de questions à poser au cher prince. Vous pourrez causer...
— Avec cette paire d’yeux noirs braqués sur nous ? As-tu seulement remarqué de quel œil la señora me regarde ?
— Des yeux noirs sont toujours des yeux noirs ! fit la créole avec un haussement d’épaules philosophe, et, personnellement, je trouverais cela plutôt amusant ! Tu ne sais pas quel plaisir savoureux on éprouve à faire enrager une jalouse.
— A propos d’yeux noirs, qui est l’autre Parque en robe noire, qui tient l’autre côté du prince de Bénévent, cette femme mûre mais encore belle ?
— Comment ? Tu ne la connais pas ? s’exclama Fortunée sincèrement surprise. Elle et son mari, ce vieil Ecossais rouquin qui a l’air d’un héron somnolant sur une patte, sont pourtant des meilleurs amis de Talleyrand. Jamais entendu parler de Mrs Sullivan, la belle Eleonora Sullivan, et de l’Ecossais Quintin Crawfurd ?
— Ah ! C’est elle ?...
Marianne se souvenait, en effet, d’une amère confidence de Mme de Talleyrand, au temps où elle remplissait auprès d’elle les fonctions de lectrice. La princesse avait parlé avec colère d’une certaine Mrs Sullivan, une intrigante qui, après avoir été l’épouse morganatique du duc de Wurtemberg et avoir trempé dans toutes sortes de conspirations, avait vécu maritalement avec un agent anglais, Quintin Crawfurd, qu’elle avait fini par épouser pour sa grande fortune. Marianne se souvenait aussi de ce que cette antipathie était surtout motivée par le fait que Mrs Sullivan-Crawfurd, malgré un âge déjà plus que certain, gardait sur les hommes une singulière emprise. En particulier, bien entendu, sur Talleyrand, avec lequel elle entretenait des relations que la princesse jugeait fort troubles, car elles semblaient mêler l’attrait physique aux affaires immobilières. C’étaient les Crawfurd qui avaient vendu au prince le superbe hôtel de Matignon et, par contre, ils habitaient actuellement son ancien hôtel de la rue d’Anjou.

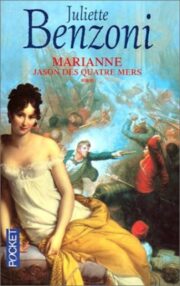
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.