— Alors... le duel ?
— Remis aux calendes grecques... ou tout au moins à la première fois où ces messieurs se retrouveront ensemble dans la même région... ce qui n’est pas pour demain puisque, dans une semaine, Beaufort rentre en Amérique.
Une vague de chaleur envahit le cœur glacé de Marianne. Le soulagement qu’elle éprouva alors fut si profond que les larmes lui montèrent aux yeux. Par la vitre baissée de sa voiture, elle tendit, spontanément, la main vers son vieil ami.
— Comment vous remercier ? Vous êtes mon bon génie.
Mais Talleyrand secoua la tête, la mine soudain assombrie.
— J’ai bien peur que non ! Si vous vous débattez dans cet affreux gâchis qu’est votre vie, j’en suis en grande partie responsable ! Ce n’est pas d’aujourd’hui que je regrette de vous avoir présentée... à qui vous savez ! Sans cette fâcheuse idée, vous seriez peut-être heureuse aujourd’hui. J’aurais dû comprendre... le soir où vous avez rencontré chez moi Jason Beaufort. Maintenant, il est trop tard, vous êtes mariés chacun de votre côté...
— Je ne renoncerai jamais à lui ! J’aurais dû, moi aussi, comprendre plus tôt, mais je refuse d’entendre dire qu’il est trop tard. Il n’est jamais trop tard pour aimer.
— Si, ma chère... quand on a mon âge !
— Même pas ! s’écria Marianne avec tant de passion que le sceptique homme d’Etat tressaillit. Si vous le vouliez vraiment, vous pourriez aimer encore... ce qui s’appelle aimer ! Et peut-être, qui sait, connaître le plus grand, le seul amour de votre vie.
Le prince ne répondit pas. Les mains nouées sur le pommeau d’or de sa canne et le menton posé sur ses mains, il parut s’ensevelir dans une sorte de rêve éveillé. Marianne vit qu’une étincelle brillait dans ses yeux pâles, habituellement si froids, et se demanda si, en l’écoutant, il n’avait pas évoqué un visage, une silhouette... peut-être un amour auquel il n’aurait pas osé penser, le croyant impossible. Doucement, comme s’il avait parlé, mais se répondant en réalité à elle-même, Marianne murmura :
— Les amours impossibles sont les seules auxquelles je crois... parce que ce sont les seules qui donnent du sel à la vie, les seules qui méritent que l’on se batte pour elles...
— Qu’appelez-vous amours impossibles, Marianne ? Votre amour pour Jason, car vous l’aimez, n’est-ce pas ? n’est pas de ceux que l’on peut qualifier ainsi. Amour difficile, simplement.
— Je crains que non. Sa réalisation me paraît aussi impossible que... (Elle chercha un instant puis lança, très vite) que si, par exemple, vous étiez épris de votre nièce Dorothée et souhaitiez en faire votre maîtresse.
Le regard de Talleyrand tourna, se posa sur celui de Marianne. Il était redevenu plus froid et plus indéchiffrable que jamais.
— Vous avez raison, dit-il gravement. C’est, en effet, un bon exemple d’amour impossible ! Bonne nuit, ma chère princesse... Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, mais je vous aime beaucoup.
D’un accord tacite, les deux voitures se séparèrent et Marianne, avec un soupir de bonheur, se laissa aller dans les coussins, fermant les yeux pour mieux savourer la paix retrouvée. Elle avait terriblement sommeil maintenant. La tension nerveuse, en se retirant, la laissait épuisée, avide uniquement de retrouver sa chambre paisible, la fraîcheur de ses draps. Elle allait pouvoir si bien dormir, maintenant que Jason ne courait plus aucun danger et que Talleyrand avait réparé sa faute stupide !
Elle baignait toujours dans la même gratitude en rentrant chez elle. Ce fut en chantonnant même qu’elle gravit légèrement le grand escalier de pierre et se dirigea vers sa chambre. Quand elle aurait à nouveau la tête claire, elle trouverait bien un moyen de faire entendre raison à Jason Beaufort et de lui faire comprendre qu’il ne pouvait pas l’obliger à se séparer de lui pour toujours. Quand il saurait à quel point elle l’aimait, alors peut-être...
En poussant la porte de sa chambre, la première chose qu’elle aperçut fut une paire de chaussures brillantes et typiquement masculines, posées sur un tabouret de taffetas bleu-vert.
— Arcadius ! s’écria-t-elle pensant que le propriétaire des bottes était son ami Jolival, soudainement revenu de voyage, j’ai bien trop sommeil...
La phrase mourut sur ses lèvres. Sous sa main, la porte s’était ouverte en grand, découvrant l’homme qui l’attendait ainsi, étendu dans une bergère. Et Marianne comprit que l’heure du sommeil n’était pas encore venue car celui qui se levait nonchalamment pour un salut aussi profond qu’ironique, c’était Francis Cranmere...
LE PIEGE D’UNE NUIT D’ETE
6
UNE FENETRE OUVERTE SUR LA NUIT...
Les nerfs de Marianne avaient été trop secoués, durant cette soirée, pour que, à la vue de son premier mari, elle éprouvât autre chose qu’un sentiment d’ennui. Si dangereux que pût être le personnage et quelque raison qu’elle eût toujours de le craindre, elle en était arrivée à ce point de détachement qu’elle n’en avait même plus peur. Aussi, sans montrer la moindre émotion, referma-t-elle tranquillement la porte de sa chambre. Puis, sans accorder à ce visiteur intempestif autre chose qu’un regard très froid, elle se dirigea vers sa table à coiffer, jeta son écharpe sur le tabouret de velours et commença à ôter ses longs gants, mais sans pour cela perdre de vue l’image de Francis que reflétait la haute glace.
Elle éprouva une certaine satisfaction à remarquer qu’il semblait déçu. Sans doute s’était-il attendu à un mouvement d’effroi, peut-être à un cri. Cette froideur et ce silence étaient, pour lui, tout à fait inattendus... Poussant le jeu jusqu’au bout, Marianne rectifia d’un doigt distrait l’ordonnance de sa coiffure, prit un flacon de cristal parmi tous ceux qui encombraient la table et passa un peu de parfum sur son cou et ses épaules. Après quoi, elle demanda :
— Comment êtes-vous entré ? Mes serviteurs ne vous ont certainement pas vu, sinon ils m’auraient prévenue.
— Pourquoi donc ? Un serviteur, cela s’achète.
— Pas les miens. Ils ne risqueraient pas leur place pour quelques écus. Alors ?
— La fenêtre, bien entendu ! soupira Francis en se réinstallant dans sa bergère. Les murs de votre jardin ne sont pas tellement hauts... et il se trouve que je suis votre voisin depuis trois jours.
— Mon voisin ?
— Ignorez-vous que vous avez une voisine anglaise ?
Non, Marianne ne l’ignorait pas. Elle entretenait même d’assez bonnes relations avec Mme Atkins, chez qui sa cousine Adélaïde avait jadis trouvé refuge quand elle était recherchée par la police de Fouché. C’était une ancienne actrice du théâtre de Drury Lane, qui s’appelait alors Charlotte Walpole, mais elle avait acquis droit au respect et en même temps droit de cité à Paris en tentant, au prix de sa vie et de sa fortune, de faire évader du Temple la famille royale après la mort de Louis XVI. La police impériale la tolérait. Ce qui étonnait surtout Marianne, c’était que cette femme douce, distinguée et douée d’une bonté profonde pût entretenir des relations amicales avec un homme tel que Francis et elle ne cacha pas sa façon de penser. Lord Cranmere se mit à rire.
— J’irai même jusqu’à dire que cette chère Charlotte m’aime beaucoup. Savez-vous, Marianne, que vous êtes l’une des rares femmes à me trouver odieux et à me détester ? La plupart de vos contemporaines me trouvent charmant, aimable, galant...
— Peut-être n’ont-elles pas eu la joie de vous épouser ! De là cette différence... Ceci dit, j’aimerais que notre conversation ne s’éternisât pas. Je suis... très fatiguée !
Francis Cranmere appuya les bouts de ses doigts les uns aux autres et se mit à les contempler avec application.
— Il est vrai que vous n’êtes pas restée très longtemps à la Comédie-Française. Est-ce que vous n’aimez pas « Britannicus » ?
— Parce que vous étiez aussi au théâtre ?
— Mais oui. Et j’ai pu admirer en connaisseur votre entrée en compagnie de ce superbe animal qu’est le beau Tchernytchev. En vérité, on ne peut rêver couple mieux assorti... sinon, peut-être, celui que vous pourriez former avec Beaufort ! Mais il semble que, de ce côté, les choses n’aillent pas tout droit. Apparemment, vous êtes toujours à couteaux tirés, vous et lui ? Toujours cette vieille histoire de Selton ? Ou bien n’aimez-vous pas son épouse espagnole ?
Ce verbiage volontairement futile commençait à agacer Marianne. Se retournant d’une seule pièce, elle fit face à Francis et coupa sèchement.
— Assez ! Vous n’êtes pas venu ici, ce soir, pour potiner mais, certainement, dans un but précis. Alors dites-le et allez-vous-en ! Que voulez-vous ? De l’argent ?
Lord Cranmere enveloppa la jeune femme d’un regard amusé puis se mit à rire franchement.
— Je sais que vous n’en manquez plus et que cela ne signifie plus grand-chose pour vous. J’admets volontiers que, pour moi, c’est le contraire qui se produit, mais nous n’en sommes pas encore là...
Il cessa de sourire, se leva et fit deux pas en direction de Marianne. Son beau visage avait revêtu une expression de gravité que la jeune femme ne lui avait jamais vue car elle n’était mitigée ni de hauteur ni de menace.
— En fait, Marianne, c’est un traité de paix que je suis venu vous offrir, si vous voulez bien l’accepter.
— Un traité de paix ? Vous ?
Lentement, Francis alla jusqu’à une petite table sur laquelle Agathe avait disposé une collation au cas où sa maîtresse aurait faim en rentrant du théâtre. Il se versa un verre de Champagne, en but environ la moitié et reprit, avec un soupir de satisfaction :
— Mais oui. Je crois que nous aurions à y gagner l’un comme l’autre. Lors de nos dernières rencontres, je m’y suis très mal pris avec vous. J’aurais dû faire preuve de plus de douceur, de doigté. Cela ne m’a pas réussi.
— En effet et, à ne vous rien cacher, je vous croyais mort à cette heure !
— Encore ! Ma chère, fit-il avec une grimace, j’aimerais que vous perdiez cette habitude de me compter perpétuellement au nombre des défunts ! C’est très déprimant... à la longue ! Mais si, par là, vous faites allusion à ce molosse que la police avait attaché à ma personne, sachez que je l’ai perdu en route, tout simplement ! Que voulez-vous, les meilleurs limiers se déroutent quand on sait la chasse. Mais, où en étais-je ? Ah oui ! Je disais que j’avais regretté de m’être montré si brutal envers vous. Il eût été infiniment préférable de s’entendre.
— Et quel genre d’entente proposez-vous ? demanda Marianne que l’allusion à la poursuite dans laquelle s’était lancé son ami Black Fish avait à la fois contrariée et rassurée.
Contrariée parce que, de toute évidence, le policier avait laissé son gibier lui filer entre les doigts et rassurée parce que, si Black Fish avait seulement perdu Francis, du moins était-il encore vivant. Quand elle avait reconnu l’Anglais, elle avait cru entendre la voix furieuse du Breton affirmant : « Je l’aurai ou j’y laisserai ma peau ! », et son cœur s’était serré en pensant à tout ce que signifiait la présence de Francis bien vivant. Ses craintes étaient vaines et c’était très bien ainsi... Il arrive que les événements trahissent les résolutions les mieux trempées.
Cependant Francis avait calmement achevé son verre de Champagne et s’était dirigé vers le petit secrétaire placé entre les deux fenêtres, ouvertes toutes deux sur la nuit du jardin. Parmi les papiers qui le chargeaient, il avait pris un cachet de jade et d’or qui servait à Marianne pour cacheter ses lettres. Et, un instant, il avait contemplé les armes gravées sur le plat.
— Une entente cordiale, bien entendu, dit-il lentement, et aussi une entente... défensive. Vous n’avez plus rien à craindre de moi, Marianne. Notre mariage est rompu, vous êtes remariée et vous portez désormais l’un des plus grands noms d’Europe. Je ne peux que vous en féliciter car, pour moi, la chance s’est montrée moins généreuse. Je dois vivre traqué, caché, dans l’ombre, et tout cela pour servir mon pays qui, d’ailleurs, me paie fort mal. Ma vie est...
— Une vie normale d’espion ! trancha Marianne que les nouveaux sentiments de Francis, étrangement amènes et généreux, laissaient méfiante et sceptique.
Il eut un demi-sourire qui n’atteignit pas ses yeux.
— Vous ne désarmez pas facilement, hein ? Eh bien, soit ! Une vie d’espion ! Mais qui me permet de connaître bien des choses, d’approcher bien des secrets qui seraient, je crois, assez susceptibles de vous intéresser.
— La politique ne m’intéresse pas, Francis, et j’entends, plus que jamais, m’en tenir à l’écart. Mieux vaudrait pour vous quitter cette maison au plus vite... avant que j’oublie que j’ai porté votre nom pour me souvenir uniquement du fait que vous êtes un ennemi de mon pays et de mon souverain !

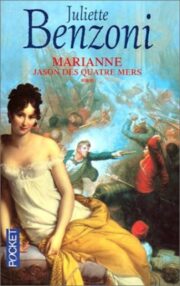
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.