— Eh bien ! Récupérez votre amie, madame, et venez ! Il y a des gens dont on ne se débarrasse pas facilement, à ce que l’on dirait ! ajouta-t-il d’un ton railleur qui fit comprendre à Marianne qu’il n’ignorait pas l’identité de l’amie en question.
Vivement, elle s’inclina puis, galamment aidée par le général de Nansouty qui offrit sa main gantée pour qu’elle y posât le bout de sa botte, elle s’enleva en selle avec une aisance qui arracha un sourire discret à l’officier de hussards. Il s’y connaissait trop en cavaliers pour être dupe du mensonge courtisan de Marianne. Si quelqu’un était tombé, ce n’était sûrement pas cette irréprochable amazone... mais, sachant son monde, Nansouty se borna à ce sourire.
Il ne fallut à Marianne que quelques secondes pour retrouver Fortunée, quelques autres pour lui raconter ce qui venait de se passer et la chance inattendue, l’espoir nouveau qui en avaient résulté pour elle.
— S’il te reçoit, c’est le principal ! commenta Mme Hamelin. Tu vas passer, sans doute, un bien mauvais quart d’heure, mais l’important, est d’être entendue. Tu as une chance de gagner la partie.
Sans plus s’attarder, les deux femmes rendirent la main à leurs montures et s’élancèrent dans la direction prise par l’Empereur. A la première croisée des chemins elles trouvèrent Roustan qui les attendait, immobile statue équestre de sultan plantée sous un pin sylvestre. Après leur avoir fait signe de le suivre, il piqua des deux vers le château, non sans effectuer un léger détour destiné à éviter que les deux amazones se trouvassent mêlées aux gens de la cour.
Une demi-heure plus tard, par le jardin Anglais l’étang des Carpes et la cour de la Fontaine, Marianne entrait dans ce palais de Fontainebleau, dont elle avait désespéré de forcer l’entrée, n’ayant croisé que des serviteurs. Au rez-de-chaussée, Roustan, après avoir installé Fortunée dans un petit salon désert, ouvrit devant Marianne la porte d’une grande pièce donnant sur un jardin, s’inclina et, de la main, lui indiqua un fauteuil. Une fois de plus, elle se trouvait dans le cabinet de Napoléon. C’était le quatrième dont elle faisait ainsi connaissance, mais, malgré son décor Louis XVI et ses meubles Empire, la pièce, grâce à l’habituel désordre de papiers, de cartes, d’objets personnels et de portefeuilles en maroquin rouge, lui parut tout de suite familière. Comme aux Tuileries, à Saint-Cloud et à Trianon, il y avait la tabatière ouverte, la plume d’oie jetée n’importe où, la grande carte déployée et le chapeau posé sur une console. Cela la réconforta et, avec l’impression d’être un peu chez elle, tant la puissante personnalité de l’Empereur s’entendait à recréer partout son atmosphère, elle attendit avec plus de confiance ce qui allait venir.
Cela vint avec le cérémonial habituel : pas rapides sur les daller de la galerie, porte claquée, traversée en trombe de la pièce, mains au dos, jusqu’à la grande table de travail, vif coup d’œil pour apprécier la révérence de cour et, finalement, entrée en matière sans nuances.
— Alors, madame ? Quelle raison impérieuse vous a poussée à enfreindre mes ordres et à venir m’importuner jusqu’ici ?
Le ton agressif, volontairement blessant, eût amené, chez une Marianne dans son état normal, une réaction du même ordre. Mais elle comprenait que, si elle voulait sauver Jason, il lui fallait fouler son orgueil aux pieds, se faire petite et humble, surtout en face d’un souverain qui, un moment auparavant, avait mordu la poussière à cause d’elle.
— Sire, reprocha-t-elle doucement, c’est la première fois que Votre Majesté me dit que je l’importune. A-t-elle donc oublié qu’elle a en moi une sujette fidèle et soumise ?
— Fidèle, je l’espère, mais soumise, en aucun cas ! Vous êtes un vrai trublion, madame, et si je n’y mettais bon ordre vous décimeriez ma grande armée tout entière. Quand on ne se bat pas en duel à cause de vous, on tue pour vous !...
— Ce n’est pas vrai ! s’écria Marianne emportée par une indignation plus forte que sa résolution d’humilité. Personne n’a jamais tué pour moi et ceux qui l’ont prétendu...
— Ne se sont pas tellement trompés car, en admettant même qu’aucun crime n’ait été commis en votre honneur, j’espère que vous n’oserez pas nier que, dans la même nuit, deux hommes se sont provoqués et que deux autres se sont battus pour vous.
— Pas deux autres, Sire : un autre, le même homme, était à l’origine des deux duels.
Du plat de la main, Napoléon frappa la table qui résonna.
— Ne coupez pas les cheveux en quatre, madame ! Je n’aime pas cela ! Une chose est certaine : mes gendarmes ont pris deux duellistes en flagrant délit chez vous. L’un a fui, l’autre n’a pas pu. Depuis quand êtes-vous la maîtresse de Fournier-Sarlovèze ?
— Je ne suis pas sa maîtresse, Sire, expliqua Marianne avec lassitude, je ne l’ai jamais été ! Et Votre Majesté le sait très bien puisqu’elle n’ignore pas les liens très forts qui l’attachent à Mme Hamelin, mon amie... Au surplus, je supplie l’Empereur d’abandonner cette malheureuse affaire. Ce n’est pas d’elle que je suis venue l’entretenir.
— Mais c’est de celle-là qu’il me plaît de parler car je veux en connaître le fin mot. En prison, le général Fournier a toujours refusé de s’expliquer là-dessus, s’en tenant à sa stupide version d’un assaut d’armes amical avec un camarade étranger. Comme si c’était vraisemblable, alors que Tchernytchev, chargé par le prince Kourakine d’une mission urgente auprès du Tzar, avait dû renoncer à se battre avec ce maudit Beaufort ! Ce n’était, certes, pas le moment de faire des armes !
Ainsi, les gendarmes qui avaient envahi son jardin, la nuit du duel, avaient reconnu l’attaché russe et le geste chevaleresque de Fournier avait été vain ? Elle hocha la tête.
— Votre Majesté sait donc qu’il s’agissait du comte Tchernytchev ?
Napoléon lui décocha un sourire moqueur que la jeune femme jugea aussitôt cruel et diabolique.
— Je m’en doutais... mais, en fait, madame, c’est vous qui venez de me l’apprendre !
— Sire ! s’insurgea Marianne. Plaider le faux pour savoir le vrai est indigne !
— C’est à moi, madame, de juger ce qui est indigne ou non ! Et je vous prie de baisser le ton si vous voulez que je vous écoute jusqu’au bout ! Maintenant, ajouta-t-il après un court silence qu’il employa à scruter le visage rougissant de la jeune femme, maintenant j’attends de vous le récit complet... et véridique, de ce qui s’est passé chez vous cette nuit-là ! Vous entendez ? Je veux la vérité, toute la vérité ! Et ne vous avisez pas de mentir car je vous connais trop pour ne pas le sentir immédiatement.
Le regard de Marianne s’effara devant la perspective qui s’ouvrait devant elle. Raconter ce qui s’était passé dans sa chambre ? Evoquer devant cet homme, qui avait été pour elle le plus passionné des amants, la scène dégradante que lui avait infligée Tchernytchev ? C’était une épreuve qui lui paraissait au-dessus de ses forces. Mais, déjà, Napoléon quittait sa table de travail et, en faisant le tour, venait s’y adosser, bras croisés, debout devant la jeune femme qu’il enveloppa d’un regard impérieux.
— Allons, madame, j’attends !...
Une idée soudaine traversa l’esprit de Marianne. Il voulait savoir « tout » ce qui s’était passé chez elle cette nuit-là ? Mais alors, c’était l’occasion rêvée, inespérée de lui raconter d’abord l’odieux chantage qui avait préludé à la machination dont Jason avait été la victime ? Dans ces conditions qu’importaient sa pudeur et son amour-propre... Courageusement, elle releva la tête, plantant son regard fier dans celui de Napoléon.
— Vous voulez tout savoir, Sire ? Je vais tout vous dire et, sur la mémoire de ma mère, je vous jure que ce sera la vérité entière.
Et Marianne parla. Avec peine d’abord, s’efforçant de trouver des mots qui fussent simples et convaincants. Puis, peu à peu, elle se prit à son propre drame. L’horreur de cette nuit de juillet s’empara d’elle de nouveau, précipitant les mots, leur conférant tout leur poids d’angoisse et de honte. Elle dit tout : le marchandage avec Francis Cranmere, ses fausses confidences, la peur qu’elle avait éprouvée pour la vie de Jason, puis l’intrusion du Russe, ivre au point d’être retourné à la sauvagerie la plus primitive, le viol et le supplice qu’il lui avait infligés, enfin l’intervention quasi miraculeuse de Fournier-Sarlovèze, le duel, l’arrivée des gendarmes et l’aide que le général avait apportée à son adversaire pour que sa fuite évitât un regrettable incident diplomatique. Pas une seule fois l’Empereur ne l’interrompit, mais, à mesure qu’elle parlait, elle voyait se crisper sa mâchoire et son regard gris-bleu prendre la teinte sinistre de l’acier.
Quand ce fut fini, à bout de forces, Marianne cacha son visage dans ses mains qui tremblaient.
— Vous savez tout, maintenant, Sire ! Et j’affirme qu’il n’est pas un seul mot de ce récit qui ne soit véridique ! J’ajoute, fit-elle très vite en laissant retomber ses mains, que la visite de lord Cranmere a marqué le début de ce drame pour lequel...
— Un moment ! Nous n’en sommes pas là ! coupa sèchement Napoléon. Vous avez juré que ceci était l’expression même de la vérité...
— Et je le jure encore, Sire !
— Inutile ! Si les choses se sont passées ainsi que vous l’avez dit, vous devez en porter la preuve sur vous : montrez-la-moi !
Marianne rougit brusquement jusqu’à la racine de ses cheveux noirs et son regard s’affola.
— Vous voulez dire... cette brûlure ? Mais, Sire, elle se trouve... sur ma hanche !
— Eh bien ? Déshabillez-vous !
— Ici ?...
— Pourquoi non ? Personne n’entrera ! Et ce ne sera pas la première fois, il me semble, que vous abandonnerez vos vêtements devant moi ? Le temps n’est pas si éloigné où vous y preniez même un certain plaisir.
Les larmes montèrent aux yeux de Marianne à l’entendre évoquer, si froidement et avec un ton sarcastique, des instants qui comptaient toujours parmi ses plus chers souvenirs mais qui, désormais, lui semblaient faire partie d’une autre vie.
— Sire, dit-elle faiblement, ce temps-là est plus éloigné que Votre Majesté ne l’imagine...
— Je ne partage pas cette manière de voir ! Et si vous voulez que je vous croie, madame, il faut m’apporter vos preuves. Sinon, vous pouvez partir : je ne vous retiens plus...
Lentement, Marianne se leva. Dans sa gorge, une boule allait et venait, lourde d’angoisse et de chagrin, insupportable... L’avait-il donc si peu aimée qu’il exigeât d’elle ce sacrifice de sa pudeur et de leurs amours passées ? Il avait raison quand il disait que, naguère encore, elle aimait offrir son corps à ses regards parce que alors ses regards étaient autant de caresses. Mais il la regardait maintenant aussi froidement qu’un marchand d’esclaves évaluant une pièce de cheptel humain. Et puis il y avait, à présent, un abîme entre la femme du Butard et de Trianon et celle qui, sur la planche d’une prison, s’était donnée si passionnément à l’homme qu’elle aimait et dont la vie dépendait peut-être de ce naufrage intime...
Détournant les yeux, elle commença à ouvrir le spencer de drap vert qui serrait son buste. Ses doigts tremblaient sur les brandebourgs de soie noire mais la courte veste tomba sur le tapis. La longue jupe d’amazone glissa sur ses hanches puis la chemise dont Marianne dégagea ses épaules. Voilant sa poitrine de ses deux bras croisés, elle tourna légèrement sa hanche blessée.
— Voyez, Sire, dit-elle d’une voix blanche.
Napoléon se pencha. Mais, quand il se redressa, son regard assombri s’enfonça dans celui de la jeune femme et le retint prisonnier durant un instant de silence.
— Faut-il que tu l’aimes ! murmura-t-il enfin.
— Sire !...
— Non ! Tais-toi ! C’est cela, vois-tu, que j’ai voulu savoir. Tu ne m’aimes plus, n’est-ce pas ?
Cette fois, ce fut elle qui chercha son regard.
— Si ! Je jure que je vous aime toujours. Mais... différemment !
— C’est bien ce que je disais. Tu m’aimes... bien !
— Mais vous-même, Sire ? Vos sentiments envers moi sont-ils demeurés les mêmes ? Et l’Impératrice n’est-elle pas... très chère à votre cœur ?
Il eut l’un de ses rares et si charmants sourires.
— Si ! Tu as raison ! Néanmoins... je crois qu’il me faudra de longues années avant de pouvoir te contempler sans émotion. Rhabille-toi !...
Tandis qu’avec des gestes, fébriles maintenant, elle remontait sa chemise, sa jupe et réendossait son spencer. Napoléon se mit à fourrager dans les papiers qui encombraient son bureau, cherchant quelque chose. Finalement, il sortit une grande feuille de papier, couverte d’une écriture fine et déjà revêtue du grand sceau impérial, et la tendit à Marianne :

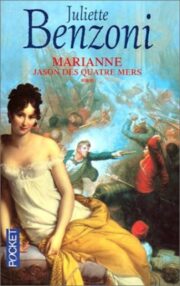
"Jason des quatre mers" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.