Le cœur battant plus vite, elle glissa doucement la lame du canif heureusement retrouvé sous la plaque de cire, la détacha et, avec mille précautions, ouvrit le paquet. Il contenait, enfermés dans un petit mouchoir marqué de taches brunes, une rose séchée et un autre morceau de papier sur lequel on avait écrit quelques mots :
« François m’a donné cette rose et s’est blessé pour me la cueillir… »
Le « V » brodé sur le petit mouchoir et l’écriture que les années n’avaient pas réussi à rendre adulte signaient clairement le court billet. Les larmes aux yeux, Hortense caressa doucement, du bout d’un doigt un peu tremblant, la fleur fanée, le carré de batiste taché de sang, ces riens qui avaient été le trésor d’une petite fille… Mais qui pouvait être ce François, ce chevalier donnant son sang pour une rose ? Un voisin, un ami de passage ? Ignorant encore tout de l’univers qui l’entourait et surtout de ce qu’avait été celui de sa mère, Hortense se promit d’interroger prudemment Godivelle. Si quelqu’un savait quelque chose, c’était elle…
Remettant à plus tard la rédaction de son futur journal elle refit soigneusement le mince paquet après avoir déposé un baiser sur la fleur et sur le mouchoir. Mais, au lieu de le remettre dans sa cachette, elle choisit de l’enfermer dans le coffret de bronze et de nacre où elle serrait ses bijoux de jeune fille et ce qu’elle avait de plus précieux : quelques lettres de sa mère, un court billet de son père. C’était miracle que ce fragile dépôt eût échappé au nettoyage minutieux et attentif auquel on avait soumis le secrétaire de Victoire. Et Hortense savait déjà que les miracles n’ont lieu qu’une fois.
Pensant qu’à cette heure Godivelle devait être occupée à préparer le repas et que c’était un moment bien choisi pour bavarder avec elle, Hortense remit deux ou trois bûches dans son feu, lança un coup d’œil à son miroir pour vérifier la rigueur de sa coiffure, jeta un châle sur ses épaules, prit ses lettres afin de les remettre à Jérôme pour qu’il les porte au plus proche relais de poste[10], puis descendit à la cuisine.
Elle n’y trouva que Pierrounet. Armé du « buffadou », long bâton de sureau sculpté au couteau et percé sur toute sa longueur comme une pipe, le jeune garçon soufflait sur les braises à s’en faire éclater les poumons. Il était rouge comme une pomme reinette mûre et, quand la jeune fille pénétra dans la cuisine, il lui adressa un coup d’œil lourd d’angoisse…
— Le bonjour, not’demoiselle, chuchota-t-il précipitamment. Faites excuses si je ne me lève pas mais j’ai laissé pâlir le feu et la tante va sûrement me frotter les oreilles s’il ne flambe pas dru quand elle va revenir…
Sans attendre la réponse d’Hortense, il se remit à souffler plus vigoureusement que jamais dans son bâton. Avec quelque succès semblait-il : une petite flamme commençait à courir à travers les branchettes de pin posées sur la braise tout juste rose. Bientôt la brassée tout entière s’embrasait, emplissant le cantou de ses pétillements joyeux et d’une exquise senteur de résine chaude.
Avec un soupir de soulagement, Pierrounet reposa son buffadou, ajouta quelques écorces sèches, des branches de taille moyenne et, pour finir, trois ou quatre bûches. Puis il sourit à Hortense avec la satisfaction de qui vient de sauver ses oreilles d’un sort douloureux.
— La tante peut revenir à présent, dit-il.
— Savez-vous où elle est ?
— Chez Monsieur le Marquis. Mais elle va pas tarder. C’est pour ça qu’il fallait que je me dépêche…
Godivelle arriva presque aussitôt, en effet, flanquée d’un homme aux allures de paysan dont la grosse veste en peau de chèvre et la longue moustache noire étaient encore raides de froid.
— Sieds-toi là, mon gars ! dit-elle en désignant l’un des sièges du cantou. Je vais te donner à manger pendant que Monsieur le Marquis se prépare. Baille ta pelisse à Pierrounet qu’il te la fasse sécher…
Tandis que l’homme s’installait, elle rejoignit Hortense à l’autre bout de la vaste cheminée. Son vieux visage rayonnait de joie, une joie qui se reflétait dans les yeux de Pierrounet.
— On l’a retrouvé ! chuchota-t-elle. A moitié mort de froid d’avoir marché dans la rivière pour tromper les chiens et un pied blessé mais il est sauvé… à l’abri. Monsieur le Marquis va aller le rejoindre et nous le ramènera demain si le temps te permet.
— Où est-il ?
— A deux lieues d’ici, chez la demoiselle de Gombert qui est grande amie de Monsieur le Marquis. Elle a envoyé son fermier nous prévenir, ajouta-t-elle en désignant du menton le paysan qui se chauffait, tendant au feu ses mains solides.
Ayant lâché son gros paquet de joie, Godivelle se consacra au messager, sortant de la maie le chanteau de pain pour y couper de belles tranches régulières, tranchant avec habileté dans le rose du jambon, cassant quelques œufs pour préparer une omelette, tirant un pichet de vin de Montmurat raide comme planche mais que l’homme avala, un grand sourire d’aise sous sa moustache.
Servi avec un zèle touchant par Pierrounet, le repas déroula son rite lent dans un grand silence, par respect pour la nourriture qui est don de Dieu et pour le bon fonctionnement de l’estomac. Chacun savait que parler fait avaler de l’air qui ne vaut rien pour la digestion. Les joues du messager vernies par le vin et la chaleur du feu avaient pris une belle teinte rouge vif quand il torcha sa moustache du revers de sa main. A cet instant précis, comme dans un ballet bien réglé, le marquis fit son entrée, prêt à partir.
Son élégance frappa Hortense. Sous la grande cape noire il portait un habit vert bouteille et des culottes collantes qui se perdaient dans des bottes souples. Sa chemise à plastron plissé était un miracle de fraîcheur. Quant au chapeau de castor qu’il portait crânement sur l’oreille, il était visiblement neuf. Le mystère de cet équipement à la dernière mode fut expliqué un peu plus tard par Godivelle : le trimestre de pension d’Hortense était arrivé quinze jours avant elle…
— Je vais chez une dame, expliqua-t-il à la mine naïvement surprise de sa nièce. Il convient de s’habiller en ces circonstances….
Il prit un temps puis, la tenant toujours sous le regard de ses yeux glacés comme s’il la défiait de leur échapper :
— Vous savez à présent, je suppose, que mon fils n’est pas malade et qu’il a fait une fugue ?
— Non, puisque vous n’avez pas jugé bon de me l’apprendre.
— Vous m’étonnez ! Les courants d’air vont vite, dans cette maison, et se glissent partout. Or vous me semblez avoir l’oreille fine.
— Encore faut-il qu’elle ait quelque chose à saisir…
Le démon malin qui l’habitait la poussa à ajouter, doucement :
— C’est un bien mauvais temps pour faire une fugue. Ou alors il faut avoir de bien fortes raisons…
— Les raisons d’un jeune fou sont toujours fortes pour lui-même. Il en va tout autrement pour autrui, riposta le marquis en tournant le dos à sa nièce.
Puis, s’adressant à l’homme qui achevait son repas « Si vous êtes reposé, François, nous pouvons partir ! »
— A vos ordres, Monsieur le Marquis !
François ?… Le nom frappa Hortense comme une balle. Elle regarda l’homme qui s’était levé en hâte et réendossait sa pelisse fumante. Jusqu’à présent, elle n’y avait pas prêté plus d’attention qu’au coffre à sel ou à la miche de pain mais ce prénom la forçait à s’en occuper. Non sans une violente protestation intérieure : l’idée qu’il pût être le François de la lettre la révoltait. Ce n’était pas possible ! Cela ne pouvait pas être possible !…
Pourtant, comme si déjà elle était certaine, comme si déjà elle cherchait des excuses, elle lui trouva quelque allure, un visage bien taillé, à la fois énergique et aimable sous la longue moustache noire, de beaux yeux sombres qui regardaient droit. Il pouvait avoir quarante-cinq ans mais les épaisseurs de l’âge mûr ne l’avaient pas encore touché, comme il advient souvent à qui mène au grand air une vie rude.
Attiré peut-être par ce regard insistant l’homme aussi la regarda. Ce fut très bref. Déjà le fermier prenait son chapeau noir, saluait et disparaissait sur les pas du marquis. Hortense, alors, secoua l’espèce de charme qui l’avait tenue prisonnière un moment de ce « François » inattendu. Qu’allait-elle imaginer ? Que sa mère, ce miracle de grâce raffinée, ait pu conserver comme une relique une fleur offerte par un rustre, un mouchoir taché de son sang ? Quelle stupidité ! Comme si l’homme était le seul François au monde et même dans ce petit monde réduit de l’Auvergne profonde ! Le héros à la rose devait être quelque jeune homme de bonne famille aux mains délicates. Avec des mains comme les siennes, le fermier François n’aurait même pas senti des épines qui, d’ailleurs, n’auraient pas entamé son cuir brun…
Pourtant, l’idée s’accrochait. Assez pour que Hortense quittât la cuisine derrière les deux hommes et les suivît jusqu’au seuil du château. L’un derrière l’autre ils descendaient le chemin en escalier, silhouettes noires sur la blancheur de la neige où ils laissaient des traces profondes. Jérôme, avec la voiture attelée et le cheval du fermier, les attendait au bas de la pente.
Le marquis monta en voiture. Le fermier sauta en selle avec l’habileté d’un cavalier consommé. Décidément, cet homme méritait attention. Au moins celle d’Hortense pour qui un véritable homme de cheval faisait obligatoirement partie d’une certaine élite.
— C’est bien de « Mademoiselle » de Combert, ça ! fit derrière son dos la voix bougonne de Godivelle qui avait suivi elle aussi. Faire venir Monsieur Foulques jusque chez elle quand ça aurait été tellement plus simple de faire atteler sa voiture et de ramener le jeune Étienne !
— Il a pris froid et il est blessé. Ce n’était sans doute pas prudent de le faire sortir aujourd’hui.
— Ça ne sera peut-être pas plus prudent de le faire sortir demain et ça m’étonnerait que le maître s’éternise à Combert.
— Il n’aime pas y aller ?
— Oh si ! Que trop même ! Ce qui m’étonne c’est que la demoiselle Dauphine n’ait pas encore réussi à se faire épouser ! Faute d’argent, je pense…
— Dauphine ? Je n’ai jamais entendu ce nom. C’est bien joli pourtant !
— C’est un nom qu’on donne encore dans nos anciennes familles nobles. La demoiselle aussi est jolie bien qu’elle ait passé fleur. Elle a quelque bien et elle brûle d’être marquise de Lauzargues.
Le ton de Godivelle annonçait clairement que, pour sa part, elle n’adhérait en rien à ce projet.
— Pourquoi ne l’est-elle pas, alors ? Le marquis a-t-il tant aimé sa femme qu’il ne puisse se résigner à donner sa place ?
— Non. Mais il est pauvre. Et il a trop d’orgueil pour accepter de ne pas être toujours et partout le maître… le premier…
— Ne m’avez-vous pas dit, si je ne me trompe, que la défunte marquise lui avait apporté une dot ? Quelle différence ?
Le souci ajouta quelques plis au vieux visage :
— Il est normal qu’une fille apporte dot. Et puis… nous n’étions pas si misérables à l’époque. Le partage était plus égal…
— Le marquis aime-t-il Mademoiselle de Gombert ?
— Je vous ai dit qu’il n’avait jamais aimé personne. Elle lui plaît, ça c’est sûr ! Mais, de toute façon, il ne la mariera jamais !
— Comment pouvez-vous en être aussi sûre ? Le marquis est moins pauvre à présent puisque je suis là. Je crois savoir que mes tuteurs doivent payer une pension généreuse. Ainsi, du moins, l’a ordonné le Roi. Alors, pourquoi…
— Vous devriez rentrer, demoiselle Hortense ! ronchonna Godivelle qui n’avait peut-être plus très envie de parler. Vous allez attraper la mort. Ce sera déjà bien suffisant si on nous ramène un malade !…
— Pourquoi, continua Hortense en haussant le ton, le marquis ne prendrait-il pas une compagne pour continuer son chemin ? La vieillesse est triste quand on est seul.
— Pourquoi ?…
Godivelle détourna la tête, visiblement mal à l’aise comme si elle avait sur le cœur un poids dont elle brûlait de se défaire. Elle hésita, regarda la jeune fille qui attendait… Puis brusquement se décida :
— Après tout, vous finirez bien par le savoir. Monsieur Foulques ne se mariera pas parce que, pour se marier, il faut aller à l’église… et qu’il a juré de ne plus jamais y mettre les pieds ! A présent, rentrez ou ne rentrez pas, demoiselle ! Moi j’ai à faire.
Virant sur ses chaussons de feutre avec une légèreté inattendue, elle disparut sans faire plus de bruit qu’un chat, laissant Hortense aux prises, une fois de plus, avec l’impression de malaise qu’elle éprouvait souvent depuis son arrivée. Elle entendait encore la voix froide du marquis, lui disant la veille, sur la tour : « Je ne vais jamais à la messe. » Elle en avait été choquée, mais infiniment moins qu’elle ne l’était à présent. Même dans sa vie protégée de fillette elle avait appris que nombreux étaient les hommes, surtout ceux qui avaient vécu la grande Révolution et l’Empire, qui désertaient la messe. On laissait cela aux femmes, aux enfants mais tout de même on faisait au moins acte de présence à l’église aux grandes occasions et surtout lorsqu’il s’agissait de mariage. Or, le marquis de Lauzargues, dernier tenant d’une vieille famille chrétienne, refusait de se marier pour n’être pas obligé d’entrer dans une église. Et cela depuis la mort d’une épouse qu’il n’aimait pas ! Qu’est-ce que tout cela pouvait signifier ?

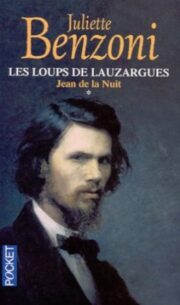
"Jean de la nuit" отзывы
Отзывы читателей о книге "Jean de la nuit". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jean de la nuit" друзьям в соцсетях.