Pour se payer de sa peine, Fräulein, qui n’aimait pas laisser perdre la nourriture, rentra chez elle, ajouta trois grosses cuillerées de miel à la verveine et, se carrant dans son fauteuil, entreprit de la déguster en poussant quelques soupirs attendris car elle pensait que le jour était peut-être proche où elle pourrait épouser enfin son glorieux fiancé et, le soir venu, au coin du feu de leur salon, lui apporter des tisanes comme celle-là, en y ajoutant un doigt de schnaps pour les rendre encore plus réconfortantes…
Quatre jours plus tard, Albine était invitée par son beau-père à se rendre auprès de lui pour recevoir, ensemble, la demande officielle du marquis de Varennes qui leur serait présentée par son seul parent mâle encore vivant, le vieux vicomte de Resson. Timothée Desprez-Martel avait consenti au mariage sous une condition formelle : les fiançailles seraient célébrées rapidement mais le mariage n’aurait lieu qu’un an après.
— Un an ? fit Mélanie. Est-ce que ce n’est pas un peu long ? Il me semblait que cinq ou six mois ?…
— Ton grand-père ne veut pas entendre parler d’une date plus rapprochée, expliqua Albine. C’est déjà une chance qu’il ait accepté ! Je m’attendais à un refus pur et simple.
— Pas moi, sourit Mélanie, mais j’espère que je serai bientôt fiancée.
— Dans trois semaines. Au lieu du bal prévu pour ton anniversaire, tu te contenteras de la petite cérémonie habituelle mais, huit jours après, il y aura ta soirée de fiançailles !
La déception fut vite effacée. Ces fiançailles un peu longuettes n’étaient pas vraiment pour déplaire à Mélanie. Elle verrait Francis tous les jours selon la tradition et ce serait une vraie joie de faire, en sa compagnie quoique, bien sûr, en présence de sa mère, ou de son grand-père – ce qui serait fort étonnant ! –, ou encore de l’oncle Hubert, l’apprentissage de cette vie de la haute société où son mariage allait la faire entrer, cette aristocratie de vieille souche dans laquelle sa mère elle-même n’avait pas toujours accès. Non qu’en digne fille de son père elle fût entichée de titres, mais celui de marquise avait un parfum particulier : celui d’un XVIIIe siècle exquis et raffiné, celui des robes Watteau, des grands « paniers » soyeux de la Reine-bergère, de la poudre à la Maréchale. Et comme cette grâce s’attachait au nom de son fiancé, ce serait tout simplement merveilleux !
Ce le fut déjà de raconter son bonheur à son amie Johanna enfin reparue après avoir assisté chez les Kinsky au premier grand bal de la saison viennoise où son carnet de bal avait été trop petit pour contenir les noms de tous ceux qui souhaitaient danser avec elle. Mais si Mélanie avait pensé apprendre la nouvelle à son amie, elle se trompait car Johanna, tout juste débarquée de l’Orient-Express, était déjà au courant :
— Tu ne te rends pas compte, s’écria-t-elle. C’est l’événement du jour : la noblesse acquiert une nouvelle grande fortune et quand on connaît les idées de ton grand-père, on s’étonne avec quelque raison… d’autant que tu épouses l’un des hommes les plus séduisants qui soient !
— Oh, j’imagine très bien ! soupira Mélanie un peu amère. On s’étonne surtout parce que je suis loin d’être aussi belle que lui.
— Ne sois pas stupide ! Tu as changé, tu sais ? Et moi je te trouve tout à fait charmante…
— Je te remercie mais cela n’empêchera pas les mauvaises langues de dire que l’on m’épouse pour ma dot.
— Pas vraiment car on connaît M. Desprez-Martel et sa réputation de redoutable homme d’affaires. On peut lui faire confiance pour que ton contrat soit rédigé de façon qu’il soit impossible à ton époux de te ruiner, en admettant qu’il en ait jamais l’intention, et, de toute façon, le beau Francis en a pour un an à faire la preuve de son amour. S’il a accepté c’est déjà un bon point. Tu te rends compte ? Un an de bouquets quotidiens ! Et pas achetés au marché ! Si tu y ajoutes la bague de fiançailles, les menus cadeaux et la corbeille de mariage, il y a déjà de quoi faire un joli trou dans ses finances !
Mélanie se mit à rire :
— Tu sais que je plains celui qui demandera ta main ? Tu comptes comme un vieil usurier. Ce n’est pas pour recevoir tant de cadeaux que je me marie. C’est parce que j’aime Francis.
— Sans doute, sans doute, mais ce n’est tout de même pas désagréable à recevoir, non ? Pour moi, le temps des fiançailles est ce qu’il y a de plus merveilleux. Alors profites-en bien !
Mélanie ne demandait que cela.
Le mercredi 5 novembre, l’oncle Hubert emmena la future fiancée et sa mère avenue des Champs-Élysées dans le magnifique landau attelé de deux irlandais à la robe lustrée et harnachés à l’anglaise que l’on sortait pour les grandes circonstances. Un dîner intime devait y réunir les futurs époux et leur famille immédiate (ce qui ne faisait pas beaucoup de monde) avant la soirée fatidique où se presserait une bonne partie du Tout-Paris. L’hôtel Desprez-Martel était illuminé depuis les soupiraux du sous-sol jusqu’aux girouettes sur ses toits et une double file de valets de pied en perruque poudrée et habits à la française – velours vert galonné d’argent et culotte de panne blanche – formait une haie d’honneur jusqu’à l’étage des salons. Éberluée, Mélanie n’arrivait pas à reconnaître la pompeuse demeure, un brin sinistre, où elle avait passé tant d’heures ennuyeuses. Une multitude de candélabres éclairaient a giorno l’enfilade des pièces de réception dont les meublés raides avaient été dépouillés de leurs housses grises à cordons blancs. Partout des fleurs blanches et, sur toute la longueur du grand salon, un somptueux buffet s’étirait interminablement, embaumé par les corbeilles de fleurs et ennuagé de tulle. Une multitude de petites chaises dorées, louées chez Catillon, remplaçaient les solennels fauteuils Louis XIV qui tenaient habituellement compagnie à des chaises gothiques, nées sous Napoléon III et bourrées de sinistres coussins de tapisserie, qui meublaient habituellement la pièce maîtresse de l’hôtel. Tout cela accueillerait tout à l’heure les invités du bal mais, en attendant, Soames dirigea « ces dames » vers le jardin d’hiver où le vieux Timothée, en habit, les attendait.
Albine rayonnait littéralement dans la ravissante robe perlée qu’elle avait achetée chez Paquin. Deux crosses de paradis rose la coiffaient superbement. Elle précédait sa fille vêtue de cette fameuse robe blanche que celle-ci n’aimait pas et faisait penser à quelque conquérant traînant sur son char une jeune captive. Elle triomphait même si visiblement que Mélanie en vint à se demander si cette fête était donnée en son honneur ou en celui de sa mère.
Apparemment, Grand-père se posa la même question car lorsque sa belle-fille s’écarta pour laisser la fiancée l’embrasser il fronça les sourcils :
— Ne me dites pas, fit-il sèchement, que cette robe est celle que vous avez, « sur mon ordre », fait faire à ma petite-fille pour le bal de ses seize ans ?
— Mais, Père, c’est une robe ravissante ! Le tout dernier modèle de la maison Paquin et tout à fait ce qu’il convient pour les fiançailles d’une jeune vierge…
— Cela conviendrait peut-être si on l’étendait sur un autel pour lui couper la gorge. Je gage d’ailleurs que cette très jolie chose que vous portez a été achetée le même jour ?
— Père ! bêla Albine devenue ponceau. Je suis une jeune femme et j’ai le droit de m’habiller selon mon âge !
— Vous avez tous les droits, sauf quand c’est moi qui paie. Cette robe s’est trompée d’épaules mais nous allons arranger cela. Viens avec moi, Mélanie !
Traînant la jeune fille après lui, le vieil homme, après avoir ordonné que « Mme Duruy » vienne le rejoindre à la lingerie, gagna à vive allure le troisième étage où ladite Mme Duruy l’attendait déjà.
Sous le simple patronyme d’Ernestine, celle-ci avait été la femme de chambre privée de Chère Bonne-Maman. Elle avait passé presque toute sa vie auprès d’elle mais, depuis sa mort, elle avait monté en grade : Grand-père l’avait débarrassée de ses tabliers de mousseline amidonnée en lui confiant les clefs des armoires et le gouvernement du personnel féminin de la maison. Depuis ce jour, Ernestine était devenue Mme Duruy et elle occupait, efficace et discrète, un rang approximativement égal à celui de Soames. Ce fut devant elle que Grand-père vint planter Mélanie :
— Regardez-moi ça et dites-moi, bien sincèrement, de quoi cette enfant a l’air ?
— Certainement pas de la fiancée dont tout Paris parlera demain. Ou alors pas dans le sens que nous espérons. Ceci est une toilette pour une prise de voile dans quelque couvent… mais je crois que cela peut s’arranger car cette robe est bien coupée. Le malheur c’est qu’on en a trop fait !
— Une demi-heure vous suffirait ?
— Avec un peu d’aide ? je crois !
— Parfait ! Pendant ce temps je vais chercher quelque chose pour rehausser tout cela !
Un instant plus tard, Mélanie, enveloppée d’un peignoir de bain, regardait, depuis le haut tabouret de repasseuse où on l’avait assise, Mme Duruy et une escouade de femmes de chambre mettre sa robe en pièces ou peu s’en fallait. Bientôt, sous les ciseaux agiles, tous les ornements superflus jonchèrent le parquet. Le décolleté carré, modeste cependant, fut débarrassé de la guimpe baleinée qui étirait jusqu’aux oreilles une dentelle épaisse et amidonnée. Après quoi Mélanie fut invitée à passer le produit ainsi obtenu. La robe de soie blanche était méconnaissable. Plus de pompons, plus de petits nœuds, plus de bouillonnés. Seuls les entre-deux de dentelle demeuraient parce qu’on ne pouvait vraiment pas se passer d’eux. Serré à la taille par un large ruban de satin, l’ensemble était d’une simplicité qui convenait à Mélanie mais, cette fois, c’était tout de même un peu trop simple…
Mme Duruy contemplait son œuvre d’un œil critique lorsque Grand-père reparut armé d’un grand écrin de cuir bleu. Derrière lui trottait une soubrette portant dans une corbeille un petit bouquet de roses pâles qu’elle épingla à la taille de la jeune fille.
— Ferme les yeux ! ordonna Grand-père.
Sur son cou, Mélanie sentit glisser des choses douces et un peu froides cependant que des chuchotements s’élevaient autour d’elle et que des mains légères s’activaient dans ses cheveux. Elle entendit Mme Duruy rire doucement :
— Cela change tout, en vérité !
Incapable de se contenir plus longtemps, Mélanie ouvrit les yeux et ne se reconnut pas. Cinq rangs de perles roses d’une nuance exquise piquetées de petits diamants enserraient son long cou mince et semblaient donner naissance aux sautoirs qu’un bouquet des mêmes précieux joyaux retenait à la ceinture en se mêlant aux fleurs. Dans ses cheveux soyeux que l’on avait relevés, un autre fil de perles et de menus diamants jouaient à cache-cache. L’effet était saisissant et les yeux de Mélanie se mirent à briller comme deux étoiles.
— Est-ce que ce sont… les fameuses perles de Grand-mère, celles dont Mère…
— … brûle de se parer depuis longtemps mais elles ne lui appartiendront jamais. C’est à toi que je les donne : elles seront mon cadeau de fiançailles. Tu auras les autres bijoux quand tu te marieras.
Très émue et très heureuse à la pensée que Francis allait peut-être enfin la trouver belle, Mélanie embrassa le vieil homme qui arrondit son bras pour le lui offrir :
— Tu es jolie comme un cœur ! déclara-t-il avec fierté. Allons voir à présent ce que ta mère va en penser, ajouta-t-il avec un petit rire traduisant bien le plaisir qu’il se promettait.
Il fut comblé au-delà de ses espérances. Le rayonnement frivole d’Albine s’éteignit comme une chandelle que l’on souffle, et durant tout le dîner elle ne fit entendre que deux ou trois paroles. Ses yeux ne quittaient son assiette que pour se poser avec une sombre avidité qu’elle ne parvenait pas à déguiser sur la gorge de sa fille, et elle ne prit aucune part à la conversation dont se chargèrent volontiers l’oncle Hubert et, surtout, les cousins du fiancé, le vicomte et la vicomtesse de Resson qui se tenaient tellement au fait de ce qui se passait autour d’eux qu’ils auraient pu, à eux deux, fournir la matière pour un journal. Lui, long visage maigre enrichi d’une moustache blanche à la François-Joseph et d’un monocle dont le mince ruban de soie noire lui barrait une joue, était un ancien diplomate. Passionné, bien sûr, par la politique, il discourut sur les tout récents accords, secrets en principe, qui venaient d’être signés entre la France et l’Italie pour une neutralité réciproque au Maroc et en Tripolitaine. Elle, petite femme mince aux cheveux argentés admirablement bien coiffés, était enrobée de Chantilly noire et offrait, sur une poitrine outrageusement remontée par le corset, une batterie d’émeraudes assez belles pour avoir retenu un instant l’attention d’Albine. Sa spécialité à elle c’étaient les potins mondains, les remous que suscitait la prochaine inauguration de la statue de Balzac – « On dit que Rodin l’a sculpté tout nu ! N’est-ce pas une horreur » –, la dernière brouille conjugale entre Boni de Castellane et son « petit pruneau américain », le grand bal paré chez les Fauchier-Magnan et surtout le duel qui avait opposé la veille même le marquis de Dion, député royaliste, à son collègue socialiste M. Gérault-Richard, qui s’en tirait avec une égratignure au bras droit. Incorrigible bavarde, elle tenta bien de revenir sur l’éclatant divorce qui avait eu lieu au printemps dernier entre le prince Albert de Monaco et sa seconde épouse Alice Heine, d’origine américaine et veuve du duc de Richelieu, mais, Hubert lui ayant fait remarquer en riant que ce n’était peut-être pas une bonne idée de parler divorce à un dîner de fiançailles, elle lui donna raison avec une parfaite bonne humeur et embraya aussitôt sur les dernières excentricités de Mme Sarah Bernhardt.

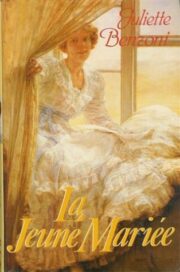
"La jeune mariée" отзывы
Отзывы читателей о книге "La jeune mariée". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La jeune mariée" друзьям в соцсетях.