– La piste ? Mais nous n’en avons aucune puisque la pierre pour laquelle on a tué est fausse !
– C’est peut-être en cherchant la fausse que vous avez le plus de chances de trouver la vraie. Que fait Adalbert en ce moment ?
– Il passe son temps en compagnie d’un petit journaliste miteux qui a eu la chance de voir sortir les assassins. Des Chinois à ce qu’il paraît, ajouta Aldo avec un coup d’œil vers le chauffeur.
– Tous les Asiatiques ne sont pas chinois, mais votre journaliste ne fait sans doute pas la différence : ainsi Wong vient du pays du Matin calme. C’est un Coréen. Cela dit, je pense qu’Adalbert a raison de s’attacher aux moindres informations.
– Et je ferais mieux d’en faire autant, fit Morosini en retrouvant pour la première fois un vague sourire. Mais, après tout, pourquoi croyez-vous qu’en recherchant la fausse pierre on tomberait sur la vraie ? Il n’y a aucune raison pour ça : on a tué Harrison pour s’approprier ce que l’on croyait être le joyau du Téméraire, un point c’est tout.
– À moins que, la campagne de lettres anonymes n’ayant rien donné, celui que nous recherchons n’ait trouvé ce moyen simple et pratique de retirer de la circulation un objet irritant sans se démasquer.
– Auquel cas, il l’aura détruit et nous ne retrouverons rien !
Le Boiteux eut un petit rire doux et indulgent.
– Connaissez-vous si mal vos clients et confrères, les amoureux passionnés des joyaux anciens ? Ce qui a été volé est une copie mais tellement belle, tellement réussie ! Si le propriétaire du vrai diamant est à l’origine du meurtre, il n’aura pas le courage de s’en séparer mais la gardera... à titre de curiosité ! Aussi soigneusement que l’original !
– Je devrais savoir que vous avez réponse à tout, fit Aldo sans parvenir à masquer sa mauvaise humeur. Cependant, rien ne dit que l’objet en question soit encore en Angleterre. Si même son demi-frère s’y trouve. L’emploi d’Asiatiques...
– ... est la chose la plus aisée à Londres pour qui a les moyens de payer. Les bas quartiers de la Tamise sont bourrés de Chinois et de la lie jaune ou noire de l’Empire. De toute façon, le parcours du diamant jusqu’à nos jours indique que l’Angleterre a toujours eu ses préférences...
– Vous le connaissez, ce parcours ? En ce qui me concerne je n’en sais pas grand-chose : il était le motif central d’un joyau de belle taille représentant les armes de la maison d’York et que l’on appelait la Rose blanche, disparue avec d’autres bijoux pillés dans le camp du Téméraire après la bataille de Grandson en 1476. La ville de Bâle en aurait acheté secrètement quelques-uns, en dépit de l’accord passé avec les autres cantons qui souhaitaient réunir le trésor entier. Par la suite, Bâle aurait revendu aux Fugger d’Augsbourg.
– Pas « aux » Fugger ! À Jacob Fugger, l’homme le plus riche d’Europe à cette époque, celui de la branche « au lys » qui se distinguait de ceux de la branche « à l’écureuil » moins argentés, mais déjà le diamant formant la fleur elle-même avait été extrait de l’ensemble. Cependant, la pierre était si belle que Jacob refusa de la vendre et c’est son neveu Mathias qui, après sa mort, la céda à Henry VIII d’Angleterre en même temps qu’un rubis ayant aussi appartenu au duc de Bourgogne.
Le diamant demeura dans les bijoux de la couronne anglaise jusqu’à Charles Ier qui l’offrit à son favori, George Villiers, duc de Buckingham, pour le remercier d’avoir mené à bien les négociations de son mariage avec Henriette de France. La Rose d’York – c’était désormais son nom ! – passa au second duc et c’est chez lui que la trace disparaît. Un bruit de cour prétend qu’il le perdit en jouant aux cartes contre l’actrice Neil Gwyn, alors favorite du roi Charles II et enceinte du fils qu’elle allait lui donner en cette année 1670. L’un des nombreux bâtards de ce souverain trop ami des plaisirs et qui ne réussit jamais à obtenir un héritier de sa femme Catherine de Bragance...
– Pourquoi ne serait-ce pas la vérité ? Cela me paraît tout à fait plausible. Et depuis, on ne sait plus rien ?
– Pas grand-chose en tout cas : la pierre aurait réapparu à deux ou trois reprises dans les mains d’usuriers qui, pour être juifs, n’en ignoraient pas moins la tradition du pectoral, mais une chose est certaine : depuis le XVIIe siècle, elle n’a jamais quitté cette île.
– Vous pourriez avoir raison. Vous savez sans doute comment le vol chez Harrison a été possible ?
– J’avoue que je n’en connais pas les détails. Ce meurtre m’a pris au dépourvu.
– Eh bien, les assassins ont dû apprendre, par je ne sais quelle indiscrétion, qu’une très vieille et très noble dame souhaitait voir le diamant en privé avant qu’il ne soit porté chez Sotheby’s. Ils sont entrés sur ses talons ou peu s’en faut. Elle a eu tout juste le temps de s’enfuir avec l’aide de sa suivante et de rentrer chez elle où elle s’est alitée. Or, ce qui me frappe dans votre récit est que cette dame s’appelait lady Buckingham.
Aronov eut une exclamation.
– Lady Buckingham ? Vous êtes sûr ?
– Il n’y a aucun doute. Harrison n’aurait pas accepté cette visite pour une personne quelconque.
– Vous me surprenez beaucoup, mon ami. Il se trouve que je connais cette dame. Je crois bien me souvenir qu’elle est non seulement fort âgée mais paralysée des jambes.
– D’après ce qu’on m’a dit, on la portait plus qu’elle ne marchait et il arrive que sous le coup d’une forte émotion le corps puisse fournir un effort particulier. Or elle souhaitait pouvoir admirer cette pierre qui avait appartenu à son ancêtre.
– Mmmm... oui ! Gela me paraît tout de même bizarre. Je sais bien que la marquise vit tout à fait retirée depuis qu’elle se considère comme une ruine – elle a été fort belle autrefois ! -, qu’elle ne reçoit jamais personne et que, même, on l’a pour ainsi dire oubliée, mais il me semble que, eu égard à son nom, à son rang et à son état de santé, elle pouvait obtenir facilement de Harrison qu’il se dérange pour exaucer son vœu.
– C’eût peut-être été imprudent ! Surtout si elle habite assez loin. Et puis il aurait fallu une escorte de police et toute cette agitation pouvait attirer la presse devant sa porte. Or, si elle souhaite l’ombre et le silence...
– Vous avez probablement raison, admit le Boiteux, mais il faut tout de même que j’essaie d’en savoir davantage.
– Vous pensez à une imposture ? C’est impossible : elle avait sa voiture, ses serviteurs...
– Sans doute, sans doute... cependant il faut que j’en aie le cœur net. Revenons à vous. Puis-je espérer que vous allez à présent vous consacrer à la recherche de la Rose ?
– Bien entendu, mais si je dois pour cela abandonner lady Ferrals...
– C’est pourtant ce que vous ferez, prince Morosini !
La voix de velours sombre venait de se charger soudainement d’une impérieuse volonté.
– Dans l’île de San Michèle et dans le mausolée de vos pères, je vous ai offert de vous rendre votre parole. Vous avez refusé avec beaucoup de noblesse et je n’en ai pas été surpris. À présent, il n’est plus temps de vous retirer.
– Mais je ne le souhaite pas ! s’écria Aldo mortifié. Il est peut-être possible de mener les deux affaires de front.
– Non. Je viens de vous le dire, il n’est pas bon que vous retombiez dans le champ de vision de Solmanski. Pour l’instant – et même si vous trouvez que c’est de mauvais goût – il a d’autres chats à fouetter que de courir après une pierre au risque de se cogner à la police. Il faut en profiter. Me comprenez-vous ?
– Oh, c’est très clair et, soyez tranquille, je ne faillirai pas ! Cependant, s’il m’est donné de découvrir un fait pouvant lui être utile, vous ne m’empêcherez pas d’en faire usage. Ni vous ni personne ! affirma Morosini têtu.
De nouveau, le masque impassible du Boiteux s’éclaira d’un sourire teinté d’ironie.
– Je ne vous ai jamais demandé de vous arracher le cœur ! Mais comme j’éprouve pour vous estime et amitié, je crains que vous n’y parveniez un peu trop vite et j’essaie de vous défendre contre vous-même. À présent je dois vous quitter. Vous ramènerai-je à votre hôtel ?
La voiture venait de tourner Hyde Park Corner pour s’engager dans Piccadilly.
– Non. Laissez-moi ici ! Je suis presque arrivé et peut-être vaut-il mieux que cette automobile ne s’arrête pas devant les lumières du Ritz. Restez-vous à Londres encore quelque temps ?
– Je ne séjourne jamais à Londres. Soudain, Simon Aronov se mit à rire :
– Votre envie d’être débarrassé de moi est transparente, mon cher prince ! Vous allez avoir toute satisfaction. Jusqu’au revoir ! ...
Les deux hommes se serrèrent la main en silence. Un instant plus tard, ayant déposé son passager, la Daimler effectuait un impeccable demi-tour et s’éloignait sur l’asphalte mouillée dans un bruit de soie déchirée. Debout sur le trottoir sablé qui longeait Green Park, Morosini la regarda se fondre dans la nuit.
Dans le hall de l’hôtel régnait une agitation inhabituelle. La vente chez Sotheby’s venait d’avoir lieu mais, bien que proposant quelques pièces de valeur, elle s’était révélée plutôt décevante en raison de la dramatique disparition du joyau vedette. Aussi nombre d’amateurs étrangers descendus au
Ritz échangeaient-ils leurs impressions tout en se préparant au départ. L’opinion générale était la suivante : puisque nul ne savait quand reparaîtrait le diamant et si même on le retrouverait un jour, le mieux était de ne pas perdre plus de temps, de rentrer chacun chez soi et d’y attendre d’éventuelles nouvelles. Tout le monde parlait à la fois, la vaste salle brillante de lumières et si harmonieusement ornée de plantes vertes et de fleurs ressemblait à un jardin habité par une centaine d’oiseaux babillards.
Au milieu de cette foule, Adalbert Vidal-Pellicorne avait l’air de jouer les chefs d’orchestre. Il s’efforçait d’inciter ces messieurs à faire confiance à l’inégalable Scotland Yard qui ne désespérait pas, selon les derniers bruits, de remettre rapidement la main sur le bijou envolé. Cela, bien sûr, pour ceux qui venaient de loin : outre-Atlantique, Afrique du Sud, voire les Indes.
Debout au milieu d’un groupe de quatre personnes, il discourait avec une assurance qui amusa Aldo mais jugeant que son ami perdait son temps, il le rejoignit et l’entraîna à l’écart, non sans avoir distribué avec nonchalance excuses et saluts.
– Qu’est-ce qui te prend de vouloir à tout prix que ces gens restent là ? Tu défends les intérêts de la maison Sotheby’s à présent ?
– Pas du tout ! Je défends les nôtres : tant qu’il croira qu’une meute importante est prête à se jeter sur la fausse pierre, le propriétaire de la vraie ne sera pas tranquille. Il croira que la presse cache des informations et se laissera peut-être aller à un faux pas... Tu as eu tort de ne pas me laisser continuer...
– Ne dis pas de sottises ! Tous ces gens sont sans intérêt, même s’ils sont très riches !
– Ah, tu crois ça ? ... Regarde un peu celui qui se dirige en ce moment vers les ascenseurs... ce grand type habillé de gris qui ressemblerait assez à un clergyman s’il n’était si élégant. Sais-tu qui il est ?
– Comment veux-tu ? Je ne suis pas devin. Avec un large sourire, Adalbert, la mine gourmande, détailla alors :
– C’est un banquier suisse, mon cher, un Zurichois dont tu connais très bien la femme. Un peu trop bien même.
– Moritz Kledermann ? C’est lui ?
– En personne ! Et habité par ce qu’il considérait comme un devoir sacré : rapporter dans son pays la pierre du Téméraire indûment subtilisée jadis aux cantons par la rapacité de Bâle ! Autant dire qu’il était prêt à payer le prix fort !
Morosini ne répondit pas : il examinait avec attention le personnage qui, à quelques pas de lui, attendait calmement l’ascenseur en pensant qu’il ne l’imaginait pas du tout comme ce quinquagénaire aux traits fins et intelligents sous un grand front dont les cheveux, d’un blond grisonnant, se retiraient en découvrant un crâne puissamment modelé. Sans s’être jamais beaucoup soucié de ce que pouvait être le mari de son ancienne maîtresse, il le croyait plus lourd, plus massif, plus... suisse ! En vérité, Dianora n’avait pas, en l’épousant, fait preuve de mauvais goût ! Cet homme avait autant d’allure sinon plus que la plupart des gentlemen présents.
– Dire qu’il pourrait être mon beau-père ! pensa-t-il amusé en se souvenant de la proposition matrimoniale de son notaire vénitien au jour de son retour à Venise après la guerre. Si sa fille lui ressemble, j’ai peut-être eu tort de ne pas au moins demander à la voir...
– Tu veux que je te le présente ? proposa Vidal-Pellicorne qui jouissait de la surprise de son ami.

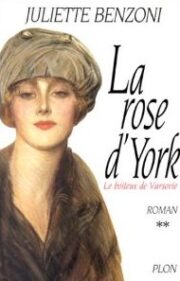
"La Rose d’York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Rose d’York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Rose d’York" друзьям в соцсетях.