D’ailleurs, au même moment, Gilles Vauxbrun, Napoléon sur le retour habillé à Savile Row, fonçait droit sur lui après avoir serré au passage la main d’Albert Blazer. Mais, tandis qu’il approchait, son regard demeurait attaché à Lisa dont le box était séparé de celui d’Aldo par un buisson de plantes fleuries.
– Y aurait-il une Parisienne que je ne connaisse pas encore ? chuchota-t-il la mine gourmande. Elle est ravissante et tu devrais me présenter.
– Un elle est Suissesse et deux tu la connais.
– Moi ? Je m’en souviendrais.
– Je veux dire que tu l’as connue, bougonna Morosini. Quand elle s’appelait Mina Van Zelden et qu’elle était ma secrétaire...
– Quoi ?
– Tu as très bien entendu. C’est ma Mina que tu vois là habillée par Madeleine Vionnet ou Jean Patou et qui est en train de se faire embrasser par cette armoire blonde ! Il faut te dire que, de son vrai nom, elle s’appelle Lisa Kledermann, qu’elle est la fille...
– Du banquier collectionneur ?
– Tu as tout bon ! A présent si tu veux que je te raconte l’histoire, dépêche-toi de m’offrir à boire ! J’en ai le plus grand besoin !
Tandis qu’Aldo faisait à son ami le récit des dernières quarante-huit heures, la salle s’emplissait de monde : hommes politiques saluant le président du conseil, Raymond Poincaré, qui venait de prendre place à une table avec deux secrétaires d’État, certains accompagnés d’une femme en vue, notamment la cantatrice Marthe Chenal et la poétesse Anna de Noailles venue avec une cour d’admirateurs, l’écrivain Henry Bordeaux, le poète Paul Géraldy. D’autres plus anonymes, mais arborant sur le visage cet air épanoui de qui s’apprête à faire un bon déjeuner. Le bruit des conversations isola bientôt Gilles et Aldo, empêchant ce dernier d’entendre ce que se disaient Mina et son cousin.
Ceux-ci ne s’attardèrent pas. Ils partirent les premiers, salués par Albert et suivis des yeux par Aldo qui ne put se défendre d’un petit pincement au cœur quand les vitres tournoyantes de la porte avalèrent la jolie fille en velours vert qu’il ne reverrait peut-être jamais. Posant son couvert sur son assiette encore à demi pleine, il alluma une cigarette, figé dans la contemplation de cette porte où il ne passait plus personne. A son tour, Vauxbrun cessa de disséquer son perdreau aux choux.
– Tu es toujours amoureux de ta Polonaise ? demanda-t-il.
– Je crois... oui, dit-il distraitement.
Du geste, l’antiquaire fit signe au serveur de remplir les verres.
– Après tout c’est ton affaire, conclut-il avant d’entamer un autre sujet de conversation.
Pourtant quand, le soir venu et un peu avant huit heures et demie, Aldo s’embarqua, au quai 7, dans l’Orient-Express qui allait le ramener à Venise, il n’était pas encore parvenu à dégager son esprit de celle qui ne serait plus jamais Mina. Il avait l’impression désagréable qu’on venait de lui voler quelque chose.
Deuxième partie
LE SANG DE LA ROSE
Automne 1922
Chapitre 8 Un appel au secours...
L’odeur suave du café de Cecina emplissait le salon des Laques où Aldo achevait de déjeuner en compagnie de sa cousine Adriana. Comme toujours, le repas avait été une réussite : heureuse de retrouver un maître qu’elle appelait toujours son « petit », la cuisinière des Morosini donnait libre cours à son talent inspiré, et ses plats comme son café venaient d’atteindre au sublime. Pourtant Morosini n’arrivait pas à éprouver l’euphorie que lui procurait habituellement la bonne chère. Tout en remuant dans une minuscule tasse de porcelaine française l’onctueux breuvage, il gardait sur sa cousine un œil chargé d’un orage qui, du gris-bleu, le faisait passer au vert : pour la première fois, Adriana refusait de lui rendre service.
La veille, il s’était rendu à l’Ospedale San Zanipolo dans l’espoir d’en ramener Guy Buteau, opéré maintenant depuis une dizaine de jours, mais le chirurgien avait émis le désir de garder son malade quarante-huit heures de plus pour certaines vérifications : tout irait bien ensuite si l’ancien précepteur acceptait de se montrer raisonnable et de vivre une convalescence de trois bonnes semaines avant de reprendre une activité normale.
Cela ne faisait pas du tout l’affaire de Morosini qui allait devoir fermer sa maison pour se rendre aux deux ventes importantes annoncées à Milan et à Florence à quelques jours d’intervalle. Cependant, il s’était bien gardé de montrer son souci à son ami Guy déjà suffisamment désolé. Le départ de Mina lui avait donné un choc et, sachant d’expérience quel travail attentif exigeait l’un des magasins d’antiquités les plus fameux d’Europe, il s’était inquiété.
– Comment allez-vous vous y prendre, Aldo ? Il y a les deux vacations où je devais me rendre, et puis nous avons aussi le señor Montaldo qui nous arrive de Carthagène pour la parure mongole que nous avons achetée il y a trois mois...
– Ne vous tourmentez pas ! Je vais faire appel à ma cousine Adriana. Ce ne sera pas la première fois qu’elle gardera la boutique et elle saura très bien s’arranger du señor Montaldo. Elle le séduira et arrivera peut-être même à lui vendre d’autres pièces.
Ce bel optimisme ne dura guère : juste le temps de se mettre à table avec Adriana. Dès les premiers mots, celle-ci arrêta son cousin.
– Désolée, Aldo, mais je pars pour Rome après-demain !
– Pour Rome ? Ne me dis pas que tu vas rejoindre la troupe des thuriféraires du signor Mussolini ?
Dans les derniers jours d’octobre 1922, l’Italie vivait une transformation profonde, rendue nécessaire par l’état d’anarchie dans lequel le pays vivait depuis la guerre, un état devant lequel le roi Victor-Emmanuel III se trouvait dépassé. Des anciens combattants réduits à la misère et au chômage, une petite bourgeoisie ruinée par la chute de la monnaie et une agitation ouvrière sans cesse grandissante faisaient lever à l’horizon le spectre du bolchevisme. Un homme, alors, était apparu, un instituteur fils de paysans romagnols et devenu journaliste, un ancien combattant en qui s’était ancrée l’idée qu’une nation armée et mobilisée représenterait le meilleur exemple pour une communauté démocratique. Et, le 23 mars 1919, Benito Mussolini fondait à Milan les premiers « faisceaux » de combat, composés d’anciens soldats pourvus d’aspirations plutôt antinomiques où tentaient de se rejoindre le nationalisme pur et dur et un vague socialisme républicain. L’uniforme de ces « fascistes » était la chemise et le calot noirs, leur arme préférée la violence, et pourtant devant eux les foules se levaient en masse, avides d’un ordre oublié depuis longtemps et animées d’une brûlante envie de voir l’Italie, si affaiblie, se relever pour retrouver l’éclat perdu et la puissance de la Rome antique.
Au congrès de Naples, celui qui se faisait appeler le Duce se sentit assez fort pour réclamer la dissolution de la Chambre et sa propre participation au pouvoir. Ensuite, il organisa la marche sur Rome (27-29 octobre 1922). Le roi, peut-être, aurait pu stopper l’avancée de ces furieux trop populaires, mais il aurait fallu faire donner l’armée, proclamer l’état de siège, et Victor-Emmanuel s’y refusa. Le 30 octobre, il demandait à Mussolini de former le nouveau gouvernement et le Romagnol troqua sa chemise noire pour la jaquette, le pantalon rayé et le chapeau haut de forme.
Naturellement, les intellectuels, de gauche ou moins à gauche, les hommes de pensée libre, l’Église et les classes élevées de la société ne voyaient pas sans une certaine inquiétude le pouvoir tomber aux mains de gens dont il n’était pas difficile d’imaginer qu’ils comptaient instaurer une dictature aussi rude peut-être que celle des Soviets. Pourtant ils étaient assez nombreux, par patriotisme et regrets de la grandeur passée, à accorder le bénéfice du doute à ce Mussolini qui se voulait sorti vivant d’une légende césarienne. Cependant, Mussolini jouait sans faiblir le jeu de la légalité. On put voir ses milices se rendre en cortège au Quirinal pour y rendre hommage au roi puis déposer une couronne au monument du Soldat inconnu, enfin assister en l’église Santa Maria degli Angeli, avec le nouveau gouvernement, à une messe de requiem que présidaient le roi et la reine. Oui, tout cela était beau, noble, pompeux, grandiloquent même, et le prince Morosini n’aimait pas la grandiloquence. Pas plus que le faciès brutal, vulgaire et arrogant, du nouveau maître. Déjà on parlait d’émeutes jugulées dans le sang, d’étudiants emprisonnés, malmenés, de descentes d’une police parallèle qui, trop sûre d’un pouvoir qu’elle voulait total, dressait des listes, établissait des fiches pour mieux surveiller ceux qui feraient mine de respirer sur un autre rythme.
Et puis, Aldo croyait encore entendre, au fond de sa mémoire, la voix grave de Simon Aronov dans les souterrains de Varsovie : « Sachez qu’un ordre noir va bientôt se lever sur l’Europe, une antichevalerie, la négation forcenée des plus nobles valeurs humaines. Il sera, il est déjà l’ennemi juré de mon peuple qui aura tout à craindre de lui... à moins qu’Israël ne puisse renaître à temps pour l’éviter... » Gomment ne pas croire à une similitude, à une étrange prémonition du gardien du pectoral ? Alors, sans même le connaître, il savait qu’il détestait ce Mussolini parce que d’instinct il s’en méfiait.
Le sarcasme contenu dans sa dernière phrase fit ouvrir de grands yeux surpris à la comtesse Orseolo.
– Ne me dis pas qu’à cet instant où il rassemble le pays tu lui es déjà hostile, Aldo ? Que vous n’ayez aucune affinité, je n’en doute guère, mais c’est le but poursuivi qu’il faut voir. Cet homme ne veut que la grandeur de l’Italie. C’est un patriote, comme toi. Il s’est bien battu, comme toi.
– Moi, je me suis battu contre l’ennui dans mon nid d’aigle autrichien où j’étais prisonnier ! Remarque : j’admets volontiers que l’Italie était en train de se dissoudre, de s’écrouler sous les coups de la corruption et des appétits communistes, qu’il était grand temps qu’un homme se lève pour tenter de remettre un peu d’ordre dans notre pagaille. Mais je n’ai pas l’impression que celui-ci soit le bon. Ce que j’apprends de ses méthodes ne m’inspire pas confiance.
– Tu y viendras, crois-moi ! J’ai des amis qui le connaissent et crient au génie. Cependant, si je vais à Rome ce n’est pas pour le voir ou tenter de l’approcher : c’est pour Spiridion.
– Ton valet de chambre ?
– Je dirais plutôt mon majordome. Il possède – je ne sais si je te l’ai dit – une voix admirable mais qui a besoin d’être travaillée, amplifiée, menée à sa perfection. Il a un grand avenir devant lui et je me dois de l’aider à réussir. J’ai obtenu pour lui une audition chez le maestro Scarpini et, naturellement, je l’emmène. Si Scarpini s’intéresse à lui, Spiridion pourra espérer chanter sur les plus grandes scènes lyriques et moi j’aurai le bonheur d’avoir découvert une nouvelle étoile.
L’enthousiasme un peu délirant qu’elle manifestait déplut à Morosini qui ne put résister au malin plaisir de jeter de l’eau sur ce feu trop brûlant à son gré :
– Et les leçons, qui va les payer ? Il ne doit pas les donner, ton Scarpini ?
– Non, bien sûr, c’est moi qui vais m’en charger.
– Tu en as les moyens ?
– Ne t’en soucie pas. Grâce à toi et... à certains placements judicieux, je n’ai plus de problèmes d’argent. Je peux sans me gêner préparer l’avenir de Spiridion. Il me le rendra d’ailleurs au centuple.
– A condition que ça marche ! Les très grandes voix sont rares, même chez nous. Tu risques de faire un sérieux trou dans ton budget et c’est pourquoi tu ferais peut-être bien de reconsidérer ma proposition d’assistante. Ton voyage à Rome ne me paraît pas un obstacle infranchissable : tu emmènes ton Grec, tu le présentes. Si on s’intéresse à lui tu le laisses, et s’il essuie un échec tu le ramènes en attendant une autre occasion et voilà tout ! Je te paierai, tu sais ?
Adriana arrangea la voilette qui enrobait son minuscule chapeau, lissa ses gants, croisa et décroisa ses jambes toujours fort belles, et finalement sourit d’un air un peu gêné.
– Je te connais trop pour en douter et j’aimerais pouvoir t’aider, mais pour l’instant c’est impossible. Je ne peux pas laisser Spiridion seul à Rome : il n’y connaît personne ; il serait perdu...
– Ce n’est pas un gamin et il n’a pas la tête de quelqu’un qui se perd facilement ! grogna Morosini évoquant le profil de médaille, l’air arrogant et la silhouette musclée du Corfiote. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ?
– Non. Outre que tu ne le connais pas, tu as toujours eu, pour lui, un préjugé défavorable. En réalité, quand je m’éloigne de lui il ne fait que des sottises, tout comme un enfant. Et comme je suis certaine du jugement de Scarpini, je compte rester là-bas un mois ou deux.

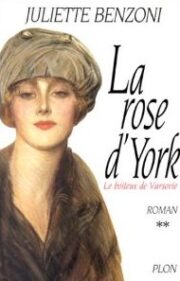
"La Rose d’York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Rose d’York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Rose d’York" друзьям в соцсетях.