– Sur mon honneur et sur la mémoire de ma mère qui fut victime du saphir, je jure ! affirma Morosini d’une voix ferme. Mais…
– Je n’aime pas les conditions.
– Ce n’en est pas une : seulement une prière. Avez-vous le pouvoir de délivrer une âme en peine, vous à qui tout semble obéir ?
– Tu veux parler de la parricide de Séville ?
– Oui. Je lui ai promis de tout faire pour l’aider. Il me semble que son repentir est sincère et…
– … seul un Juif peut la relever de la malédiction d’un autre Juif. Sois sans crainte : quand le rubis aura perdu son pouvoir, la fille de Diego de Susan pourra connaître le repos. À présent, écoute ! Et bois si tu en as envie…
Sans prendre garde au geste de dénégation de Morosini, le vieil homme remplit à nouveau son gobelet puis s’adossa à sa chaise, ses longues mains croisées sur ses genoux. Enfin, sans regarder son visiteur, il commença :
– En cette année 1583, Rodolphe avait trente et un ans. Il occupait le trône impérial depuis sept ans et, bien que fiancé à sa cousine, l’infante Claire-Eugénie, il ne se décidait pas à conclure le mariage. L’indécision fut d’ailleurs son plus grave défaut durant sa vie. Bien qu’il aimât les femmes, le mariage lui faisait peur et il se contentait d’assouvir ses besoins virils avec des filles de peu ou des femmes faciles. Sa cour où affluaient artistes et savants, charlatans aussi, était à cette époque fort joyeuse et brillante. Le peintre Arcimboldo, l’homme des figures étranges qui fut pour lui ce que Leonardo da Vinci fut pour François Ier en France, y ordonnait des fêtes, inventait des danses, des spectacles et surtout des bals travestis dont l’Empereur raffolait. Ce fut à l’une de ces fêtes qu’il remarqua deux jeunes gens d’une extrême beauté. Ils s’appelaient Catherine et Octavio et, à la surprise de Rodolphe qui ne les avait encore jamais vus, ils étaient les enfants d’un de ses « antiquaires », Jacobo da Strada, venu d’Italie comme Arcimboldo, et lui-même si beau que Titien lui avait consacré une toile. Catherine et Octavio se ressemblaient d’une façon extraordinaire et, devant eux, l’Empereur éprouva un trouble profond, plus grand peut-être que celui ressenti devant la majesté du souverain par ces deux enfants. Ils lui parurent tellement exceptionnels qu’il crut voir en eux des êtres surnaturels et souhaita se les attacher.
Le père devint conservateur des collections, Octavio, que le Tintoret devait peindre un jour, fut chargé de la bibliothèque. Enfin Catherine, durant des années, fut la compagne de Rodolphe, si discrète qu’à l’exception des familiers nul ne soupçonna cette liaison. Elle était douce et elle aimait l’Empereur à qui elle donna six enfants.
Le premier, Giulio, naquit en 1585 et tout de suite Rodolphe en raffola, déplorant de ne pouvoir faire de lui son héritier, en dépit des mises en garde de Tycho Brahé, son astronome-astrologue : l’enfant selon l’horoscope de sa naissance serait bizarre, cruel et tyrannique. S’il régnait, il serait une sorte de Caligula et, de toute façon, le peuple ne l’accepterait jamais. Désolé mais résigné, l’Empereur le fit cependant élever auprès de lui d’une façon princière. Malheureusement, l’horoscope ne se révéla que trop exact : l’enfant réunissait toutes les tares des Habsbourg, exactement comme son cousin par le sang don Carlos, fils de Philippe II. À neuf ans, il fut pris du haut mal et il fallut le surveiller de près, ce qui ne l’empêcha pas de faire des fugues avec une astuce qui déroutait ses gens. À seize ans, des bruits commencèrent à courir : le prince attaquait ses servantes, enlevait des petites filles pour les faire fouetter, maltraitait les animaux. Un jour il déchaîna un scandale affreux en se promenant nu dans les rues de Prague et en jouant les satyres avec les femmes rencontrées. Le peuple gronda et l’Empereur, navré, décida de l’éloigner. Et puisque Giulio était passionné de chasse, il lui donna pour résidence le château de Krumau, dans le sud du pays… qu’y a-t-il ?
– Pardonnez-moi de vous interrompre, fit Morosini qui avait tressailli à ce nom, mais ce n’est pas la première fois que j’entends prononcer ce nom…
– Qui t’en a parlé ?
– Le baron Louis. Simon Aronov posséderait une propriété aux environs…
– Tu en es certain ?
– Mais oui.
– C’est étrange parce que, justement, le rubis est à Krumau. C’est, disons… une coïncidence, mais je reprends mon récit. Dans son nouveau domaine, Giulio était maître et seigneur mais les ordres étaient formels : en aucun cas il ne devait revenir à Prague. Seule, sa mère pouvait lui rendre visite. Bientôt la terreur régna dans la région. Chasseur forcené, le « prince » entretenait une meute de molosses qui épouvantaient jusqu’aux garçons chargés de les soigner. En outre, comme Krumau était un grand centre de tannerie, il en avait installé une au château, ainsi qu’un atelier de taxidermiste : il écorchait des bêtes et les empaillait ou tannait leurs peaux suivant son caprice. Les nuits étaient consacrées à des orgies. On se procurait des filles en les payant, parfois en les enlevant, et certaines ne revinrent jamais. La peur grandissait…
« D’abord muette, car personne n’osait avertir l’Empereur. Celui-ci adorait son fils aîné et, sachant qu’il avait, comme lui-même, l’amour des bijoux, surtout des rubis, c’est à lui qu’il offrit, pour ses dix-huit ans, la pierre magnifique rapportée d’Espagne par Khevenhuller. Giulio en montra une joie presque délirante, la fit monter au bout d’une chaîne et ne la quitta plus.
« Un soir, rentrant de la chasse, il remarqua sur sa route une très jeune fille, presque une enfant, mais si belle qu’il s’en éprit sur-le-champ et la ramena au château. Le soir même il la viola. La petite, épouvantée, s’enfuit pendant la nuit mais, affaiblie par ce qu’elle venait de vivre, elle s’évanouit au bord de l’étang où les gardes la trouvèrent à l’aube, le corps zébré d’estafilades. Naturellement on prévint le maître qui la rapporta lui-même au château où, cette fois, il la séquestra dans sa chambre en interdisant les abords aux valets comme aux chambrières. Chaque nuit on l’entendait crier, sangloter, demander grâce. Son père, barbier dans la ville, osa monter au château pour la réclamer. Cela déchaîna la fureur de Giulio qui le chassa à coups de plat d’épée.
« Cependant au bout d’un mois, la pauvre enfant réussit à s’enfuir et se réfugia chez ses parents. Giulio vint l’y réclamer. On lui dit qu’on ne l’avait pas vue, alors, fou de rage, il s’empara du père et dit à la mère en larmes que si sa fille ne venait pas le rejoindre le soir il tuerait son mari… Et le soir, la jeune fille revint. Giulio se montra charmant : il renvoya le père avec des présents, des paroles amicales : il aimait sa « petite colombe » et comptait l’épouser. La nuit qui venait serait celle de leurs noces. L’homme s’en alla, un peu rassuré.
Jehuda Liwa se tut un instant et prit une profonde respiration comme s’il se préparait à une épreuve :
– Le lendemain, les valets ne pouvant ouvrir la porte de la chambre et n’entendant aucun bruit se résolurent à l’enfoncer le vantail. Leur maître les avait habitués à ses cruautés, pourtant ils reculèrent d’horreur devant le spectacle qu’ils découvraient. La chambre était saccagée, les matelas du lit éventrés, des taches de sang où trempaient des lambeaux de chair jonchaient les tapis. Au milieu de tout cela, Giulio, nu à l’exception de la chaîne où pendait son rubis, étreignait en pleurant le corps… ou ce qu’il restait du corps de la jeune fille : elle était déchiquetée, ses dents étaient cassées, ses yeux crevés, ses oreilles coupées, ses ongles arrachés.
« Les gardes réussirent à emmener Giulio, hagard et à demi inconscient. On rassembla les restes de la morte dans un drap afin de les enterrer chrétiennement puis on envoya prévenir l’Empereur. C’était le 22 février 1608.
« Rodolphe vint. Il avait le cœur brisé mais il donna les ordres qui convenaient : il fallait avant tout étouffer le scandale de ce crime abominable. Les parents de la jeune fille reçurent une fortune et une terre qui les éloignait. Quant à Giulio, devenu fou, on le cloîtra dans son appartement dont on mura les issues, cependant que les fenêtres recevaient d’épais barreaux. À l’exception de deux serviteurs fidèles, personne ne le revit plus, mais on l’entendait hurler toutes les nuits. Il ne supportait aucun vêtement et vivait nu comme une bête. Quatre mois plus tard, on le retrouva mort… et l’Empereur qui avait ordonné cette fin ne se consola jamais. On enterra le jeune homme dans la chapelle du château…
Quand la voix du grand rabbin s’éteignit, Morosini tira son mouchoir, essuya son front en sueur et se versa une rasade qu’il avala d’un trait. Cette plongée dans un passé abominable lui était pénible, mais en face de ces yeux sombres et attentifs qui l’observaient il s’efforça de dissimuler son émotion.
– C’est là, dit-il enfin, ce que l’Empereur vous a révélé ?
– Non. Il n’a pas parlé si longtemps. Je connaissais cette affreuse histoire… mais j’ignorais tout du rubis. Maintenant je sais où il est mais je ne crois pas que tu seras heureux de l’entendre. Tes épreuves ne sont pas finies, prince Morosini.
– Où est-il ?
– Toujours à Krumau… et toujours au cou de Giulio. Son père a exigé qu’on le lui laisse…
De nouveau, Aldo s’épongea le front. Il sentait une sueur glacée couler le long de son échine :
– Vous ne voulez pas dire que je vais devoir…
– Violer une sépulture ? Si. Et moi qui ai des morts un si grand respect, je t’y engage. U faut le faire, ne serait-ce que pour la paix de l’âme de ce malheureux fou et pour le rachat de celle de la Sévillane. Et puis, surtout, le pectoral doit être reconstitué. Il y va de l’avenir d’Israël.
– C’est effrayant ! murmura Morosini. J’ai juré à Simon Aronov de ne reculer devant rien mais cette fois…
– Tu as peur à ce point ? gronda le rabbin. De quoi ? Les archéologues modernes n’hésitent pas, eux, à s’introduire au nom de la science dans les tombes de personnages morts, il y a des centaines et des centaines d’années.
– Je sais. L’un de mes amis exerce cette profession. Sans états d’âme d’ailleurs.
– Et pourtant, ce qu’ils font est infiniment plus grave. Ils arrachent les corps des défunts pour les exposer à la curiosité publique dans toute leur misère. Toi, tu devras seulement reprendre la pierre sans troubler autrement le sommeil de Giulio, et ce sommeil ensuite n’en sera que plus paisible. Mais tu ne pourras pas faire cela tout seul. Je ne sais ce que tu vas trouver là-bas : une dalle de pierre, un sarcophage… Est-ce que quelqu’un peut t’aider ?
– Je comptais sur cet ami égyptologue, mais il n’a pas l’air de se manifester.
– Attends encore un peu ! S’il ne vient pas, je te donnerai un billet pour le rabbin de Krumau. Il te trouvera quelqu’un…
– Au fait, où est-ce, Krumau ?
– À plus de quarante lieues au sud de Prague, sur la haute vallée de la Moldau. Le château qui appartient au prince Schwarzenberg, a été longtemps une forteresse à laquelle on a ajouté des constructions plus aimables. La chapelle est dans la partie ancienne. Je ne peux rien te dire de plus. À présent, je vais te reconduire jusqu’à l’entrée des jardins mais… ne pars pas sans m’avoir revu ! Je vais essayer de t’aider de mon mieux.
Lorsqu’il eut rejoint sa voiture, Aldo resta un long moment assis au volant, sans bouger. Il se sentait étourdi, assommé par ces heures vécues hors du temps. Il avait besoin d’immobilité, de silence surtout et, à cette heure de la nuit, il était absolu, profond, hors du temps lui aussi…
Ensuite, il alluma une cigarette et la savoura avec autant de volupté que s’il n’avait pas fumé depuis des jours. Il s’en trouva apaisé et pensa qu’il était peut-être temps de rentrer. L’automobile glissa le long des pentes du Hradschin et ramena son maître vers le monde plus prosaïque des vivants.
Il était plus de trois heures du matin quand il regagna l’Europa plongé dans une demi-obscurité Le bar était fermé, ce qui lui fit grand plaisir : il craignait un peu de voir surgir sa hantise américaine affublée d’un sourire stéréotypé et un verre de bière à la main. Tout était calme, paisible. Le portier de nuit le salua, lui remit sa clé et, en même temps, lui tendit un billet plié en deux qu’il venait de prendre dans le casier :
– Il y a un message pour Votre Excellence…
Morosini déplia le papier et faillit crier de joie : « Je suis au 204, ton voisin immédiat, mais pour l’amour de Dieu laisse-moi dormir ! Tu me raconteras tes fredaines demain », écrivait Vidal-Pellicorne.
Pour un peu Morosini serait tombé à genoux pour remercier le Seigneur. C’était un tel soulagement de savoir qu’Adalbert serait avec lui pour affronter l’épreuve qui l’attendait ! Il se dirigea vers l’ascenseur d’un pas allègre. La vie lui semblait tout à coup beaucoup plus belle…

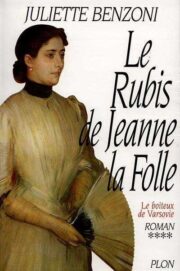
"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.