Tout de même, le temps passant, Blanche commence à se lasser de la Russie, de ses neiges, de son froid et de la vie fastueuse mais épuisante qu’elle y mène. On se lasse de tout même lorsque l’on vous couvre de diamants et qu’à la fin de joyeuses orgies, on se fait arroser de champagne sur un lit de pétales de roses. Seulement, il y a un inconvénient : le prince Mesentsov n’a aucune envie de se séparer d’une maîtresse dont il est fier, que tous lui envient et dont il est, de surcroît, de plus en plus amoureux. Néanmoins, Blanche d’Antigny – elle s’est ajouté depuis un moment une décorative particule – n’est pas femme à se laisser tenir sous le joug : elle a décidé de quitter l’empire des tsars et elle entend y parvenir envers et contre tout ! Pour cela, une seule solution : il faut obliger son amant à la laisser partir. Blanche, après en avoir mûrement réfléchi, en vient à prendre un parti assez machiavélique mais qui ne manque pas tout de même d’un certain courage, l’issue étant bien incertaine.
Elle est invitée, un soir, à un gala de l’Opéra de Saint-Pétersbourg auquel doit assister l’impératrice. Blanche, alors, soudoie à prix d’or les couturières de la souveraine pour se faire confectionner une toilette exactement semblable à celle que Maria Alexandrovna portera ce soir-là. Et, ainsi habillée, elle se rend au théâtre.
Inutile de dire qu’elle n’y restera pas longtemps. À peine s’est-on rendu compte de la similitude de toilettes qu’un chambellan rouge d’indignation vient prier la jeune femme de vouloir bien considérer qu’un malaise subit l’oblige à rentrer chez elle dans les plus brefs délais. Et, dès le lendemain, un ordre d’expulsion parvient chez le malheureux chef de la police désespéré : Blanche, sa Blanche a quarante-huit heures pour repartir vers son pays de révolutionnaires. Mais c’est d’un pas léger, avec quelques larmes de crocodile que la jeune femme, emportant tous ses bijoux et les regrets éternels de Mesentsov, reprend le chemin qui, à travers la Prusse, va la ramener dans son cher Paris, ce Paris où elle vient d’effectuer, sur les Champs-Élysées, une rentrée tellement remarquée.
Tout de suite son succès va être complet : on se l’arrache. Sur la recommandation d’un de ses nombreux amants – et Dieu sait si elle en a, et tous plus riches les uns que les autres, elle débute le 6 juillet 1868 aux Bouffes-Parisiens dans la reprise d’une œuvrette de Jacques Offenbach intitulée Le Château à Toto. De là, elle passe au théâtre du Palais-Royal où elle joue Mimi Bamboche, une autre œuvre d’une grande élévation morale mais dont le surnom lui restera. Enfin, le 25 octobre de la même année, elle débute aux Folies-Dramatiques dans Chilpéric rôle de Frédégonde, une Frédégonde court vêtue et fort décolletée mais portant pour deux cent mille francs de bijoux.
C’est presque la gloire. Au point d’inquiéter un instant la reine de l’opérette, l’inégalable Hortense Schneider. Sans suite d’ailleurs. Blanche était trop bonne fille et n’aimait pas se faire des ennemis parmi ses camarades ou le personnel des théâtres. Il lui suffisait de ruiner proprement tous ceux qu’attirait sa chair opulente et sa merveilleuse blondeur.
Le 21 janvier 1869 marque, dans la vie de Blanche d’Antigny une date qui n’a rien à voir avec l’anniversaire de la mort de Louis XVI : ce soir-là, elle inaugure le magnifique hôtel particulier qu’elle s’est fait offrir rue Lord-Byron, au coin de l’avenue Friedland, un hôtel dont on se répète à l’envi les merveilles. Par exemple, la seule chambre à coucher renferme pour cinquante-cinq mille francs (or !) de dentelles et de tapis entre ses murs tendus de satin bleu turquoise.
La pendaison de crémaillère est une débauche de luxe : des laquais en habits à la française forment une double haie dans le vestibule décoré de précieuses tapisseries. Un treillage doré tout garni de lilas blanc recouvre les murs des salons, de la salle à manger et de l’escalier. Quant à la table du festin, elle étincelle d’or, d’argent et de cristaux disposés autour d’un énorme samovar d’or massif hérissé de fleurs. Les convives sont composés des hommes les plus en vue et des plus célèbres courtisanes.
Pourtant, au milieu de ce luxe effréné et de tous ces hommes qui se ruinent pour elle, Blanche garde au fond de son cœur une petite fleur bleue, une romance discrète, mélancolique et même pitoyable : l’amour qu’elle porte à l’un de ses camarades de théâtre, le jeune Pierre Luce qui lui voue une adoration sans borne.
C’est un garçon doux, timide… et très malade car il est miné par la tuberculose. Mais il est le seul au milieu de tous ces hommes plus beaux et plus riches que lui à avoir su éveiller une tendresse dans le cœur de la chanteuse, un sentiment pur, dépouillé, fait d’un amour un peu maternel et de tout ce que sa vie insensée n’a jamais permis à Blanche d’exprimer.
Quand Luce meurt, dans les débuts de la guerre de 1870, Blanche, en larmes, s’en va trouver le caissier de son théâtre pour lui demander de lui avancer 150 francs sur ses cachets.
L’homme s’étonne, s’indigne même, hausse les épaules puis désignant les boucles d’oreilles en diamants qu’elle porte :
— Besoin d’argent, vous ? Et d’une si petite somme ? Mais avec un seul de vos diamants vous aurez dix mille francs tout de suite.
— Je sais… mais c’est pour Pierre. Je ne veux payer les fleurs de sa tombe qu’avec de l’argent honnêtement gagné.
Elle eut ses cent cinquante francs et Pierre Luce les lilas blancs qu’il aimait.
Cependant, cet unique amour va laisser des traces redoutables, ineffaçables à cette époque. Au contact du jeune malade, Blanche à son tour contracte la tuberculose qui va la détruire peu à peu.
La guerre terminée, elle fait quelques tournées, une saison à Londres en 1872 mais qui lui est funeste et dont elle essaie de corriger les effets par un voyage en Égypte. Elle compte sur le soleil pour lui rendre sa belle santé d’autrefois. Si belle, si fraîche, si rose, si ronde, si blonde, elle maigrit et voit avec horreur se creuser ses joues, se plomber son joli teint. Le séjour d’Alexandrie n’arrange rien. En outre, elle doit y faire face à une cabale orchestrée par un riche Égyptien qu’elle a repoussé.
Dégoûtée des voyages, épuisée aussi, elle regagne Paris qu’elle aime toujours plus que tout autre endroit au monde et s’installe à l’hôtel du Louvre. C’est là que la mort va interrompre la course folle d’une destinée vouée tout entière à la gaieté et au plaisir.
Le 27 juin 1874 meurt Blanche d’Antigny… munie des sacrements de l’Église, à trente-quatre ans et c’est au cimetière du Père-Lachaise qu’est enterrée cette femme dont la vie tumultueuse va inspirer à Émile Zola sa scandaleuse et redoutable Nana. Une Nana pas tout à fait fidèle à son modèle car, même si elle le cachait bien, Blanche d’Antigny, elle, possédait un cœur.
« DU BARRY »
Un mariage à la sauvette…
Être la fille naturelle d’une couturière en chambre et d’un moine plus ou moins en rupture de couvent n’a jamais été une bonne carte de visite pour faire carrière dans la société. C’est cependant le lot de la jeune Jeanne Bécu lorsqu’elle naît à Vaucouleurs le 10 août 1743. En religion son père porte le nom séraphique de Frère Ange, ce qui donne à penser, mais ce père essentiellement épisodique se nommait fort honorablement Jean-Baptiste Gomard de Vaubernier.
Néanmoins, le ciel compatissant eut la bonne idée de doter Jeanne d’une beauté qui éclata aux yeux de tous dès ses premières années, une beauté qui allait grandir avec elle et la doter finalement de cet éclat rayonnant auquel bien peu d’hommes purent résister.
Si peu séraphique qu’il ait pu être, Frère Ange a néanmoins rempli ses devoirs envers sa fille en lui faisant donner, chez les dames de Sainte-Anne, une éducation susceptible de lui permettre de paraître en compagnie. Au point qu’à sa sortie, la jeune Jeanne est engagée comme demoiselle « pour accompagner » chez une veuve suffisamment noble pour avoir souhaité que son nom ne soit pas mentionné dans la suite éclatante d’une carrière galante qu’elle ne pouvait approuver.
Pas plus qu’elle n’acceptait d’ailleurs les nettes tendances de sa protégée pour l’amour libre. Un beau matin, Jeanne se retrouve sur le pavé ce qui lui permet d’entrer comme « demoiselle de magasin » chez Labille, rue Neuve-des-Petits-Champs. Une maison de mode pleine de dentelles, de soieries et de rubans dont la jeune fille fut bientôt le plus joli des ornements. Et quels ornements : dire qu’elle était blonde c’est faire tort à l’éclat d’une foisonnante chevelure dorée. Sa peau était de nacre rose, ses yeux immenses et d’un bleu foncé dont la nuance changeait suivant les circonstances. Quant à son corps, le plus exigeant des statuaires grecs n’aurait pu en trouver de plus parfait, de plus tendre et de plus soyeux.
Un corps dont elle n’est pas avare. L’un de ses amants la conduit dans une maison de jeux où elle va rencontrer celui que l’on pourrait appeler l’homme de sa vie car c’est son astuce qui va propulser cette petite vie modeste et encore cachée jusqu’au firmament de Versailles : il se nomme Jean, comte Du Barry mais on le connaît mieux, dans les endroits où l’on s’amuse sous le sobriquet du « Roué ». Car, roué, il l’est comme personne… Mis en présence de Jeanne, il a tôt fait de sentir qu’elle peut aller très loin. Alors il commence par mettre, sur elle, ce que l’on pourrait appeler une option sous forme de la lettre suivante : « Ma belle demoiselle, venez demeurer avec moi. Vous serez d’abord la maîtresse de mon cœur ; en cette qualité la souveraine de mon hôtel où vous commanderez à tous mes gens qui seront désormais les vôtres. Vous paraîtrez sur un ton imposant. Vous ne manquerez ni de robes ni de diamants. Je tiens chez moi, une fois par semaine, une assemblée brillante. Vous en ferez l’honneur ; vous recevrez les vœux et les adorations de ceux qui vous approcheront. Je vous instruirai de la manière dont il faudra vous conduire pour bien mener votre barque… »
Sous le nom de Mlle Lange – agréable retour au nom religieux de son père, Jeanne fera dignement les honneurs de cette maison où tous les hommes se la disputent. En vain d’ailleurs car Jean Du Barry vise beaucoup plus haut qu’une poignée de libertins : il pense au Roi.
En cette année, Louis XV est entré dans sa soixantième année. La mort de la marquise de Pompadour l’a laissé désemparé et, à la Cour, la compétition est ouverte à qui lui procurera une nouvelle maîtresse. De tout cela, Jean Du Barry n’ignore rien et moins encore que l’homme le mieux à même d’ouvrir devant Jeanne les portes de l’alcôve royale c’est Lebel, valet de chambre et confident du Roi. Celui-ci, invité à souper et mis en présence de Jeanne, est tout de suite ébloui. Au récit qu’il en fait, Louis XV est plus qu’intéressé : il désire voir cette ravissante créature le plus vite possible. Il s’enflamme même tellement que le vieux maréchal de Richelieu, l’homme aux mille maîtresses, lui demande si un nouvel astre va se lever bientôt sur Versailles :
— Attendez qu’il se couche ! chuchote Jean Du Barry qui a entendu.
Ce qui se produit très vite à la satisfaction absolue du Roi et aussi de Jeanne car il faut bien dire que même à l’âge qu’il avait atteint Louis XV demeurait un fort bel homme et gardait beaucoup de charme. L’aventure rapide avec « la comtesse du Barry » – car Jeanne avait été présentée comme l’épouse du Roué – se mit à tourner à l’histoire d’amour et le Roi de déclarer qu’il entend présenter « la comtesse » à la Cour. D’où embarras des conspirateurs. On ne plaisante pas avec Louis XV et il faut bien en venir à lui avouer la vérité : Jeanne n’est pas mariée du tout.
— Tant pis, dit le Roi, mais qu’on la marie promptement.
Avec qui ? Du Barry, lui, est déjà marié sinon il se serait fait un plaisir mais quand on est le Roué on a plus d’un tour dans son sac et, en particulier, il a un frère, Guillaume, qui lui est toujours célibataire. Et voilà notre homme chevauchant éperdument sur les routes de France pour gagner Lévignac, près de Toulouse où vivent les siens – plutôt chichement – dans une manière de château. Il leur tombe dessus comme la foudre : il faut qu’avant un mois Guillaume ait fait une vraie comtesse Du Barry de la ravissante Jeanne Bécu. Pour arranger un peu les choses il a ajouté à ce nom sans éclat celui de Vaubernier, nom du Frère Ange – qui, au moins, a une particule.
Les cris d’horreur de la mère, des sœurs et de l’intéressé s’apaisent assez vite quand Jean fait miroiter la montagne d’or qui ne saurait manquer de s’écrouler sur la famille. Bien sûr – et il le précise sévèrement – il ne peut s’agir que d’un mariage blanc.

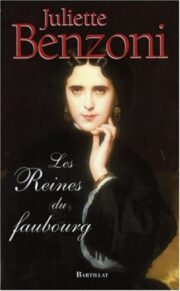
"Les reines du faubourg" отзывы
Отзывы читателей о книге "Les reines du faubourg". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Les reines du faubourg" друзьям в соцсетях.