Dès lors Cora Pearl est vraiment lancée. Installée dans un magnifique appartement de la rue de Ponthieu, elle possède tout ce qu’un homme riche peut offrir à une femme. Attelages et chevaux de selle emplissent ses écuries et chaque matin on peut la voir, sanglée dans une sévère amazone, galoper sous les ombrages du bois de Boulogne. De même que, l’après-midi, elle participe dans sa calèche bleue à la rituelle promenade où se rencontrent la Cour et le Tout-Paris.
L’amour que lui voue Masséna toucherait un cœur moins fermé que le sien. Il ne sait que faire pour lui plaire demandant seulement en échange qu’elle ne soit qu’à lui mais Cora n’entend pas se consacrer à un seul homme et, un soir, c’est le drame. Au cours d’un souper dans le fameux cabinet n° 16 du Café anglais où quelques joyeux fêtards sont réunis avec leurs belles amies, le duc de Gramont-Caderousse l’un des rois de la fête qui, se sachant condamné, brûle sa vie avec une joyeuse désinvolture propose une idée bizarre : ces dames vont se livrer au concours de la plus belle poitrine.
Sa maîtresse en titre, la chanteuse Hortense Schneider refuse farouchement de se mêler à des femmes qu’elle méprise et, ce soir, c’est la belle Adèle Courtois qui accompagne le jeune duc. Sans hésiter, celle-ci fait tomber le haut de sa robe et Cora se dispose à l’imiter quand Masséna s’interpose : elle ne va pas faire ça ? Et devant lui ? La réponse de la jeune femme est un défi : oserait-il le lui interdire ? Il n’hésite pas :
— Oui. Je vous le défends mais aussi je vous en prie. Cela… me déplairait.
Pour toute réponse, Cora dégage ses seins et gagne le concours haut la main mais Masséna ne verra pas la triomphatrice baigner l’une de ses victorieuses rondeurs dans une coupe de champagne car il est parti dès la chute de la robe. Le lendemain, après une scène pénible, c’est la rupture et Cora Pearl choisit comme nouvel amant le prince Murât, banquier plus jeune et plus riche encore que son prédécesseur, ce qui ne l’empêchera nullement d’accueillir d’autres amants de passage : son appétit d’or est intarissable et elle s’entend comme personne à mener les hommes à la cravache.
Ses algarades avec le prince Demidov défraient Paris. On se raconte la façon dont elle lui a cassé sa canne à pommeau d’or sur la tête, alors qu’il prétendait demeurer couvert devant elle. Une autre fois, alors que le Russe met en doute l’authenticité des perles de son collier, Cora jette le bijou à terre et en écrase quelques-unes sous son talon pour prouver leur authenticité. Après quoi, ramassant l’une des rescapées, elle la jette à la figure du prince en lui recommandant de s’en faire une épingle de cravate.
Ses éclats, son maquillage, sa réputation de grande prêtresse de l’amour et ses tarifs exorbitants en font une sorte de curiosité. Au point qu’un groupe d’étudiants se cotise pour réunir cinquante louis puis tire au sort qui sera l’heureux élu. Cora accepte de recevoir le gagnant et accomplit sa part du contrat. Mais le jeune homme est charmant, un peu timide et il éveille en elle quelque chose qui est peut-être un souvenir d’enfance. Alors au moment où il va la quitter, la courtisane prend l’un des cinquante louis et le lui tend en disant :
— Je garde toutes les pièces sauf celle-ci qui est peut-être la vôtre car, à vous, je veux m’être simplement donnée…
On aimerait savoir qui était le jeune étudiant. Mais Cora est appelée à de plus hautes destinées. Après le prince Murât, vient le duc de Morny qu’elle rencontre, un matin, en patinant au Palais de Glace :
— Cora sur la glace ? s’écrie en riant le demi-frère de l’Empereur. C’est un paradoxe…
— Eh bien, Monseigneur, puisque la glace est rompue, offrez-moi donc un cordial !
— Volontiers… à condition que ce soit chez moi.
Ainsi débute une nouvelle liaison, plus amicale que passionnée de la part du duc. Cora l’amuse et, surtout, il partage cette passion du cheval qu’elle place au-dessus de tout. Il gagnera même un tout petit coin de ce cœur qui ne veut plus battre en offrant à Cora, au lieu de bijoux dont elle regorge, un superbe pur-sang arabe.
C’est alors que Napoléon III lui-même fait savoir qu’il recevra volontiers la jeune femme. Mais elle reçoit très mal Mocquart, l’émissaire impérial : elle n’est pas un fiacre qu’on siffle dans la rue. « Je ne veux pas, dit-elle, qu’on me fasse psst, psst ! »
Elle se laissera néanmoins convaincre mais sa visite aux Tuileries n’aura pas de suite. L’Empereur déclarera à Morny que « cette Anglaise a vraiment trop d’accent » et que, d’ailleurs « il se doit aux Françaises… »
À la mort de Morny, Cora décide de s’essayer au théâtre. Elle ne récoltera pas le succès au contraire, mais encore un nouvel admirateur, qui sera la plus célèbre victime de l’impitoyable Anglaise : le prince Jérôme Bonaparte, fils du roi de Westphalie et frère de la princesse Mathilde, un joyeux luron que les Parisiens ont surnommé Plon-Plon. Il n’est plus très jeune et loin d’être beau mais Cora recevra de lui un palais rue de Chaillot, un autre rue des Bassins, les plus beaux chevaux de Paris et de rarissimes perles noires. Le pauvre homme est fou de son Anglaise et, même les remontrances de l’Empereur ne pourront rien contre un sentiment profond et sans doute douloureux quand Cora s’affichera avec le Turc Khalil-Bey.
La guerre de 1870 ne change rien. Lorsque Cora revient en Angleterre, Jérôme la suit mais le couple fait scandale et il faudra bien que le prince en vienne à rompre par respect pour les siens et le malheur de l’Empire. Cora rentre à Paris mais la fête est finie et fini le temps des princes. C’est maintenant celui des riches bourgeois. Le suicide du jeune Duval, des restaurants du même nom, va faire chasser l’Anglaise de France. On pourra la voir alors à Monaco puis à Milan où elle essaiera vainement de revoir Jérôme. Plus tard, elle pourra revenir à Paris où plus maquillée que jamais, elle tente de gagner encore quelque argent de la seule façon qu’elle connaisse mais elle n’intéresse pas les jeunes générations qui l’appellent « le vieux clown ».
Pour échapper à la misère, elle écrit ses Mémoires et remporte un succès qui la sauve mais quatre mois après la parution, le 8 juillet 1886, elle meurt d’un cancer de l’intestin…
L’inoubliable
HORTENSE SCHNEIDER
Un certain Monsieur Offenbach…
Un matin de l’été 1855, deux jeunes gens grimpaient courageusement le raide escalier d’une triste maison sise passage Saunier menant au non moins triste appartement d’un homme qui était peut-être le plus gai des habitants de Paris. C’était un musicien allemand « agité, mince comme une clarinette, vif comme un triolet » qui venait de s’implanter aux Champs-Élysées, dans un petit théâtre en bois abandonné par un prestidigitateur qui l’avait baptisé théâtre des Bouffes-Parisiens et venait d’y monter une sorte d’opérette allègre intitulée Les Deux Aveugles. Le plus étonnant était que le public commençait à s’y presser.
Quant aux deux visiteurs, l’un était le chanteur Berthelier qui faisait partie de la troupe et sa plus récente maîtresse : une jolie Bordelaise de vingt-deux ans, blonde, grassouillette, mais avec les plus belles épaules, les plus belles jambes du monde, de jolis yeux bleus et le plus charmant minois. Son nom : Hortense Schneider.
Ce que Berthelier vient demander à son patron, c’est d’auditionner sa conquête et, comme il est amoureux, il est tenace. Alors sachant bien qu’il ne s’en débarrassera pas autrement, Offenbach soupire en se mettant au piano :
— Chande-moi guelgue chose !
Il ne se débarrassera jamais, en effet, de son accent tudesque mais c’est au fond un charme de plus comme sa moustache blonde et le regard myope mais vif qui brille derrière ses lorgnons. Si elle meurt de trac, la jeune Hortense n’en montre rien. Elle attaque hardiment le boléro du Domino noir mais à peine a-t-elle chanté quelques mesures que le musicien se lève et referme le piano.
— Où as-du abbris ?
— À Bordeaux avec M. Schaffner…
— Bedide miséraple, si tu as le malheur de brentre engore tes leçons, je te viche mon pied quelque part et je tégire ton encachement. Car je t’encache, tu entends ? À teux cents francs bar mois…
Et de signer un contrat qui allait marquer toute une époque. L’association d’Offenbach avec Hortense Schneider que l’Histoire ne séparera plus va démontrer au monde entier que « leur » Paris est la ville la plus brillante, la plus gaie et la plus vivante du monde : une fantastique affiche pour le second Empire…
Mais qui était, au juste, cette Hortense tombée si à propos dans la vie du compositeur ? Bordelaise, elle l’a dit mais parce que ses parents le sont devenus. Son père, un pauvre tailleur nommé Schneider était, selon Lenôtre, un des rescapés des contingents rhénans de Napoléon. C’est dire que la famille n’était pas riche. Toute gamine Hortense sera petite-main chez une couturière ou coursière chez une fleuriste mais ce qu’elle a dans le sang c’est la musique, le chant, la danse et la comédie. Elle se joint à une troupe d’amateurs et un vieil artiste, Schaffner, lui apprend à poser sa voix – qui est fort jolie – et à respirer quand il faut.
Ainsi armée, elle signe un engagement, à cinquante francs par mois, pour le théâtre d’Agen où elle va jouer tout, mais vraiment tout ce que l’on y joue et pas toujours dans les premiers rôles. Elle sera même un nègre dans La Case de l’oncle Tom et un mousse dans Haydée mais il lui arrive de chanter parfois l’opéra même si c’est dans les chœurs. En même temps, elle fait des ravages dans la société masculine de la cité des pruneaux. Sa blondeur, son entrain et ses rondeurs y font merveille au point qu’une grande dame de la société viendra s’en plaindre à son directeur.
Au bout de deux ans de ce métier, elle fait ses bagages, débarque à Paris, essuie bon nombre de refus dans les « salles » en vogue et finalement rencontre Berthelier qui la réconforte, lui promet de s’occuper d’elle, en fait sa maîtresse parce qu’elle l’a ensorcelé et finalement tient parole en la présentant à son patron.
Dès son apparition sur la scène des Bouffes-Parisiens – qui d’ailleurs ne vont pas tarder à déménager pour s’agrandir et se rapprocher des Boulevards – c’est le succès, un succès qui vaut à la belle Hortense nombre d’admirateurs avec qui elle a le bon goût de ne pas se montrer cruelle dès l’instant qu’ils lui plaisent mais, quand elle rencontre le jeune duc Ludovic de Gramont-Caderousse, elle lui accorde aussitôt l’exclusivité… et il faudra bien que Berthelier, non sans soupirer, quitte à jamais la chambre de son amie.
Gramont-Caderousse, c’est en quelque sorte le roi de Paris : grand, maigre – trop ! il est miné par la phtisie – d’une folle élégance, le cheveu roux et le visage pâle marqué de rouge aux pommettes il règne sur le Jockey club et sur tous les endroits où l’on s’amuse depuis le Café anglais et le Café de Paris jusqu’aux petites boîtes de quartiers moins huppés. Tout le monde le connaît, tout le monde l’adore et Hortense, en ce cas, fait comme tout le monde. De cette liaison, elle aura un petit garçon dont elle ne se souciera guère et surtout tirera un vernis d’élégance et d’éducation non négligeable.
Quelques mois après la naissance, le jeune duc dont la santé se délabre de plus en plus commet l’erreur fatale commune, hélas, à tous les malades des poumons de l’époque : il va se soigner en Égypte en pensant que le soleil est seul capable de le guérir. En fait, le soleil le tuera plus rapidement et, quand il reviendra à Paris en 1865, c’est pour y mourir. À trente-deux ans.
Or, pendant ce séjour en Égypte, Hortense qui, avec toute la troupe et Offenbach, se produit au Palais-Royal, entre en fureur contre son directeur qui lui a refusé une augmentation. Qu’on lui résiste est une chose qu’elle ne supporte pas : d’abord parce qu’elle a une juste conscience de sa valeur mais également parce qu’elle n’est pas aussi intelligente que sa frimousse pétillante le laisse supposer. Aussi prend-elle une décision ahurissante : elle va retourner à Bordeaux, chez sa mère et, dans ce but, elle fait ses malles.
Grâce à Dieu, faire ses malles pour une femme en cette année 1864 n’est pas une mince affaire, surtout pour une jolie femme : il faut emplir une monstrueuse quantité de bagages et de cartons pour y enfouir les crinolines, les immenses robes qui les couvrent, les dessous aussi abondants que les fanfreluches, les châles, les chapeaux, les bottines, les ombrelles. Cela donne à Offenbach flanqué de son librettiste Ludovic Halévy, le temps de tomber chez sa vedette pour tenter de la ramener à la raison.

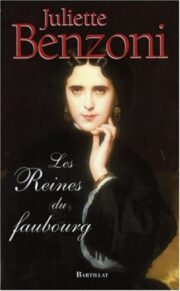
"Les reines du faubourg" отзывы
Отзывы читателей о книге "Les reines du faubourg". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Les reines du faubourg" друзьям в соцсетях.