— Vous avez beaucoup à me raconter, Marie ? observa celle-ci en se regardant au miroir.
— Beaucoup, madame ! Mais… je préférerais que nous soyons seules.
— Nous allons avoir largement notre temps ! Je ne veux plus que vous me quittiez et je vais donner ordre que l’on prépare votre ancien appartement…
— Sous les combles ? émit Marie qui se souvenait sans plaisir du réduit misérable où, après la mort de Luynes, Louis XIII l’avait assignée et où elle avait mis sa dernière fille au monde.
— Non. Celui d’autrefois juste au-dessus de cette chambre… et l’on va rouvrir le petit escalier !
— Il est donc fermé ?
La jeune Reine eut pour sa Surintendante retrouvée l’un de ces sourires rayonnants – rares chez elle ! – qui lui ouvraient les cœurs les plus fermés :
— C’était le chemin de l’amitié, Marie. Je ne pouvais supporter qu’une autre dame l’emprunte.
Touchée, celle-ci, abandonna le flacon d’huile parfumée dont elle s’apprêtait à laisser tomber quelques gouttes sur son œuvre capillaire, plia le genou pour prendre la main de la Reine et la baiser avec une émotion qu’elle ne s’attendait pas à éprouver. Jusqu’à présent, l’Espagnole était pour elle une jolie dinde fraîche et ronde encore engoncée dans de raides contraintes d’infante, plus ou moins terrifiée par son mari et essentiellement égoïste. Cette preuve d’attachement changeait ses plans d’avenir : elle espérait jusque-là se servir d’Anne pour tirer vengeance du Roi qui l’avait déçue. A présent, elle se promit d’essayer sinon de la rendre heureuse, au moins de lui procurer un peu de bonheur.
— Merci, madame, murmura-t-elle. J’espère qu’il me sera donné de prouver à Votre Majesté que si j’ai de nombreux défauts, l’ingratitude et la sécheresse du cœur ne sont pas du nombre…
Le soir même, en compagnie d’Elen, elle reprenait possession avec un extraordinaire sentiment de triomphe de l’élégant logis qui, avant elle, avait abrité les fantasmes et les rêves démesurés de Leonora Galigaï !…
Les semaines qui suivirent furent des plus agréables. Le joyeux cercle des amies se reconstituait autour de la Reine : Antoinette du Vernet, miraculeusement guérie de ses vapeurs opportunes, accourut reprendre son poste ainsi que la jeune Angélique de Verneuil, l’autre responsable de l’accident de la Grande Salle, dont on préparait pour la fin de l’année le mariage avec le fils du duc d’Epernon. Et surtout Louise de Conti, la nouvelle belle-sœur, la plus âgée de la petite coterie – elle avait vingt ans de plus que les autres ! – mais non la moins séduisante. Marie apprit d’elle, d’ailleurs, que la Reine ne l’avait jamais abandonnée, quoi qu’elle ait pu en penser, et qu’elle n’avait cessé d’intercéder auprès du Roi pour qu’on lui rende sa Surintendante.
Ce qu’on savait de la guerre était satisfaisant. Le vieux maréchal de Lesdiguières – quatre-vingts ans ! – avait reçu l’épée de connétable que la mort avait enlevée à Luynes et la portait avec infiniment plus d’éclat. Bassompierre, colonel des suisses, était à présent maréchal de France et Chevreuse Grand Fauconnier. Le duc de Rohan, chef des protestants rebelles, venait de faire sa soumission et le traité de paix mettant fin à la guerre contre les huguenots allait être signé à Montpellier. Quant à la Reine-mère, lasse de courir après son fils sans parvenir à le rejoindre, elle était partie prendre les eaux de Pougues.
Enfin vint le message qu’Anne d’Autriche espérait secrètement : Louis XIII appelait auprès de lui sa femme et sa cour et leur donnait rendez-vous à Lyon où aurait lieu le mariage de Mlle de Verneuil. Au passage de Pougues, le cortège des dames récupérerait Marie de Médicis…
On prépara le départ dans la fièvre. C’était déjà novembre et l’hiver approchait, mais le temps se maintenait beau. Habituée au climat madrilène et aux vents glacés de la Sierra Nevada, la Reine ne craignait pas un long chemin dans une saison difficile. D’autant plus qu’une partie du trajet s’effectuerait par voie d’eau. Marie, elle, se promettait mille plaisirs pour les jours à venir. D’abord elle reverrait son époux dont les ardeurs commençaient à lui manquer. En outre, et ce n’était pas le moindre sujet d’impatience, elle allait se retrouver, enfin, en face du Roi, de celui qui l’aimait naguère et en était venu à la traiter si mal…
La nouvelle qui vint la veille même du départ était, à cet égard, peu réconfortante. Ainsi qu’elle l’avait annoncé, la « vieille » Montmorency avait porté sa plainte devant le souverain et son Conseil. L’un comme l’autre venaient de trancher : Mme de Montmorency perdait sa charge de dame d’honneur et Mme de Chevreuse sa Surintendance qui était à présent supprimée. Un jugement style Salomon qui ne satisfit personne. Surtout pas la Reine qui au fond ne détestait pas la mère du beau Montmorency et que n’enchantait pas de vivre en contact permanent avec la nouvelle dame d’honneur, l’austère et revêche Mme de Lannoy. Elle se hâta cependant de porter quelques consolations à Marie :
— De toute façon votre place auprès de moi reste la même, Marie. Vous êtes et resterez mon amie. Le Roi d’ailleurs a tenu, pour effacer votre chagrin, à nommer votre époux Premier Gentilhomme de la Chambre…
— Qu’il en soit remercié mais qui consolera le charmant duc de Montmorency si fort attaché à Votre Majesté ?
Anne d’Autriche rougit jusqu’à la racine de ses blonds cheveux :
— Quelle sottise, ma chère ! Le jeune duc…
— … est follement épris de vous, madame, et s’en cache à peine.
— Une reine de France ne doit pas entendre de telles choses, madame, coupa Mme de Lannoy. Tous ses sujets l’aiment d’un cœur égal, cela seul compte…
— A qui le voulez-vous faire croire ? s’écria Marie en riant. De plus il n’y a aucune raison pour cacher une vérité à Sa Majesté… surtout quand il s’agit d’un gentilhomme aussi accompli que M. de Montmorency. Il a vingt-huit ans, il est beau et nombre de femmes en raffolent mais il n’en regarde jamais qu’une seule !
Voyant des nuages d’orage s’amonceler, Anne d’Autriche pria ces dames d’en rester là mais, dans les jours qui suivirent, Mme de Chevreuse put observer que la Reine soignait davantage sa toilette et que son regard vert s’éclairait quand la fière silhouette du jeune duc venait s’incliner devant elle… De là à imaginer une intrigue, il n’y avait qu’un pas, vite franchi par le pied léger de la jeune femme. Ce serait tellement amusant si l’épouse de Louis XIII prenait suffisamment de goût pour un gentilhomme au point d’en faire son amant ? Et quelle plus délectable vengeance pourrait-elle tirer de celui-ci qu’en protégeant de si romanesques amours ?
Le 5 décembre on fut à Lyon où le Roi n’était pas arrivé. La Reine et sa suite prirent logis à l’Archevêché. On eut la surprise – désagréable ! – d’y trouver la Reine-mère installée. Espérant pouvoir s’entretenir en tête à tête avec son fils, la grosse Florentine s’était hâtée de quitter Pougues avant l’arrivée de sa belle-fille.
En effet, bien qu’elle eût été l’artisane du mariage de Louis avec l’Infante – et en même temps de celui de sa fille Elisabeth avec le prince des Asturies, futur roi d’Espagne –, Marie de Médicis détestait sournoisement sa belle-fille dont elle jalousait la jeunesse et la beauté.
Touchant alors la cinquantaine, c’était une imposante et forte femme alourdie de graisse avec une chair très blanche, un visage massif pourvu d’un double menton – elle l’avait déjà quand à vingt-sept ans elle avait épousé Henri IV –, des yeux bleus globuleux à fleur de tête, des cheveux grisonnants, frisés et coiffés en hauteur à la mode florentine au-dessus d’un front étroit, têtu comme le menton grassouillet. Toujours ruisselante de perles, diamants et autres joyaux dont elle avait la passion, sa silhouette épaisse ne manquait pas de majesté et déplaçait beaucoup d’air.
D’une piété étriquée qui l’inféodait au Pape et aux Jésuites, se souciant comme d’une guigne des intérêts profonds du royaume, de cœur sec et d’esprit rusé, Marie de Médicis restait avide de pouvoir au point d’avoir, après la chute de son favori Concini, déclaré la guerre à un fils qui avait osé la chasser du Louvre et l’assigner à résidence au château de Blois… dont elle avait réussi à s’enfuir une belle nuit à l’aide d’une échelle de corde. Auparavant, elle avait franchi une fenêtre non sans difficultés à cause de son tour de taille et des cassettes à bijoux dont elle était bardée. Evasion rocambolesque et passablement ridicule, orchestrée par son vieux complice le duc d’Epernon et dont à Paris on avait ri sans retenue, jusqu’à ce qu’elle prétendît arracher la couronne à son fils les armes à la main. Il est vrai qu’à cette époque son conseiller le plus sage et le plus intelligent, un certain évêque de Luçon nommé Richelieu, avait été exilé dans son diocèse d’abord puis en Avignon.
Des six enfants qu’elle avait eus, la Reine-mère n’aimait qu’un seul : son second fils Gaston, duc d’Anjou, beau jeune homme écervelé mais fourbe, lâche mais aimable. Louis XIII, livré dès l’enfance à une sorte de martyre aux mains d’un gouverneur stupide et cruel, n’avait jamais reçu d’elle la moindre marque d’affection. Et cependant, comme nombre d’enfants maltraités, il avait aimé sa mère. C’est à cause de cela, peut-être, qu’il avait accepté un premier traité de paix dont le jeune Richelieu avait été l’artisan… succès qui n’avait pas duré, la mère abusive souhaitant toujours accaparer le pouvoir. D’où une seconde guerre, brève et sans gloire aucune pour elle qui après une escarmouche en Anjou s’était soldée par une seconde réconciliation pour laquelle Hercule de Montbazon avait prêté son château de Couzières.
Depuis les choses semblaient aller pour le mieux entre une mère et un fils qui lui avait rendu sa place au Conseil. Même si ce n’était pas la première ! Mais ce que Marie voulait à présent, c’était y faire entrer son cher évêque de Luçon que Louis XIII avait pris en grippe parce qu’il le croyait responsable des folies de sa génitrice…
Naturellement, la Florentine s’estimant un Machiavel en jupon, haïssait les Luynes, cause de ses malheurs et de ceux des Concini. Le mariage de Marie, sa filleule, avec l’aîné, l’avait mise hors d’elle mais elle n’en avait pas tenu rigueur à la jeune femme, sachant pertinemment qu’on ne lui avait pas demandé son avis. La place que Marie avait prise auprès d’Anne d’Autriche lui convenait parfaitement : la soupçonnant d’être portée au dévergondage, elle n’espérait rien d’autre que la voir entraîner sa belle-fille sur des chemins assez cahoteux pour, sinon la faire répudier, au moins lui faire perdre tout crédit auprès du Roi qui ne pourrait que lui rendre la première place à elle, sa mère !
C’était au fond plutôt infâme mais on est une belle-mère ou on ne l’est pas !
Anne d’Autriche n’ayant aucune illusion sur cette grosse femme vieillissante qu’elle n’aimait pas mais respectant les lois de la civilité puérile et honnête, les retrouvailles à l’Archevêché de Lyon furent ce qu’elles devaient être : un chef-d’œuvre de maternalisme hypocrite d’un côté, et de résignation fataliste teintée de morgue espagnole de l’autre. Entre elles, cependant, un lien invisible mais solide formé par Mme de Chevreuse et la princesse de Conti qui l’une comme l’autre avaient un pied dans chaque camp : Marie en tant qu’amie de la Reine et filleule de sa belle-mère, Louise de Conti, amie de longue date de la Reine-mère et un des éléments les plus appréciés du cercle d’Anne d’Autriche. Unies par l’affection ainsi que par une communauté d’intérêts, toutes deux s’efforçaient de maintenir à un niveau supportable les relations entre une jeune reine orgueilleuse – souvent exaspérée d’ailleurs ! – et une vieille harpie jalouse acharnée à lui arracher son droit d’occuper le premier rang. Aussi ce petit monde attendait-il avec fièvre le moment où le Roi se retrouverait en face d’elles. Laquelle aurait de lui le meilleur accueil ?
Le 6 décembre, les Reines prenaient place dans un bateau magnifiquement décoré pour s’en aller au-devant de Louis XIII qui arrivait du Midi et, quand vint l’heure de la rencontre, on sut vite à quoi s’en tenir : le Roi embrassa sa mère avec chaleur, lui fit compliment sur sa bonne mine en se déclarant heureux qu’elle eût si bien profité des eaux de Fougues, et ce fut presque à regret qu’il s’en détacha pour se tourner vers sa femme ; celle-ci, les larmes aux yeux mais raidie dans son orgueil, s’efforçait de faire bonne contenance. Il l’embrassa, sans l’étreindre et du bout des lèvres.
— Je vous trouve en assez bon point, madame, et j’espère que vous vous y maintiendrez…
Toujours courtois, cependant, il salua les dames parmi lesquelles était Marie, plongée dans sa révérence :

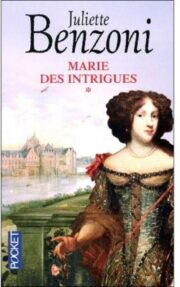
"Marie des intrigues" отзывы
Отзывы читателей о книге "Marie des intrigues". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Marie des intrigues" друзьям в соцсетях.