— Tu me crois devenue folle ?
— Oh non ! Qu’il vous soit arrivé une mauvaise nouvelle, oui !
— On peut appeler cela ainsi : le Roi m’a fait l’honneur de m’écrire pour me signifier ma disgrâce. Il m’est défendu de reparaître au Louvre. Mlle de Verneuil est logée à la même enseigne que moi !
— Sa propre sœur ? Oh !
— Sa demi-sœur[1]. La Reine a tant plaidé notre cause que je croyais cette affaire enterrée. Apparemment il n’en est rien. Nous n’avons pas fini de payer ce malencontreux accident.
Un mois plus tôt, le lundi 14 mars, Anne d’Autriche et ses dames préférées – donc Mme de Luynes et sa belle-sœur – s’étaient rendues après souper chez la princesse de Condé qui « tenait le lit » – autrement dit recevait dans sa chambre, ce qui était fort à la mode ! – dans son appartement du Louvre… La soirée avait été brillante : nombre de dames et de gentilshommes faisaient cercle autour de leur hôtesse. On avait écouté de la musique, dégusté une collation et surtout beaucoup ri. Bref on s’était bien amusé jusqu’à ce que la Reine s’aperçût qu’il était minuit et décide de rentrer chez elle par le chemin habituel, c’est-à-dire en traversant la grande salle du Louvre, celle où l’on mettait le trône aux jours de cérémonies. A cette heure de la nuit, elle était déserte et mal éclairée offrant devant les trois jeunes femmes un peu éméchées et qui ne cessaient de rire aux éclats le sombre miroir de ses dalles de marbre soigneusement cirées. L’idée de traverser ce désert brillant en courant et en faisant des glissades naît alors dans l’esprit de Marie. Aussitôt approuvée par les deux autres. Plus mollement peut-être par la petite Reine mais Marie a réponse à tout :
— Nous allons vous tenir par le bras ! Ce sera très amusant.
Elle prend Anne sous l’aisselle tandis qu’Angélique de Verneuil en fait autant et les voilà parties, riant comme des folles avec l’impression de patiner sur la glace. Seulement au fond de la salle il y a l’estrade où l’on place le trône. Elles vont si vite qu’elles vont droit dedans, sans dommages pour les deux soutiens mais la Reine tombe et se plaint aussitôt d’une vive douleur. Or elle est enceinte de six semaines… et le mercredi 16, les espérances du royaume s’envolaient au milieu d’une cour consternée. Ce n’était pas la première fausse couche d’Anne, mais les autres avaient été plus précoces et le Roi fondait de grands espoirs sur cet enfant à venir. On lui cacha d’abord la raison du « malaise » éprouvé par sa femme au moment de son départ pour le Midi de la France, mais il fallut bien en venir à lui dire la vérité. Il entra alors dans une violente colère où se mêlaient chagrin et désillusion. Sa femme reçut de lui une lettre furieuse où il lui ordonnait de chasser Mme de Luynes et Mlle de Verneuil. Offensée car elle n’avait pas conscience d’avoir commis une faute si grave, pas plus que ses compagnes, Anne envoya plusieurs émissaires plaider une cause qui était aussi la sienne et l’on put, un moment, croire que tout était oublié. Apparemment il n’en était rien. Le couperet venait de tomber sur Marie qui semblait avoir peine à s’en remettre en dépit de son caractère optimiste. Elen avança prudemment :
— La colère du Roi ne durera pas. La Reine vous aime. Et aussi la Reine-mère dont vous êtes la filleule…
— C’est vrai. Je suis même leur seul sujet d’accord et il est réconfortant de savoir que deux égoïsmes se rencontrent sur ma tête.
— En outre, notre sire ne pourra faire autrement que pardonner à Mlle de Verneuil qui doit épouser dans les mois à venir le fils du duc d’Epernon. Il faudra bien que son pardon s’étende aussi à vous sous peine de se montrer par trop injuste et ne se veut-il pas Louis le Juste ?
— Ça, ma chère, c’est de la littérature ! Je ne suis pas très sûre de la solidité de ses sentiments fraternels envers la jeune Angélique de Verneuil. Il ne faut pas oublier qu’il appelait sa mère la « putain » ! Quoi qu’il en soit, le sang du Béarnais peut inciter Louis à la clémence, mais moi je n’ai pas une goutte de ce sang vénéré et je me retrouve veuve avec trois enfants dont l’un hérite le titre ducal, me laissant celui de douairière… à vingt et un ans. Ma Surintendance va tomber dans les griffes de la vieille Montmorency qui la guette comme un chat une souris dodue, et je ne sais trop ce que va devenir ma fortune puisque c’est mon fils qui hérite.
— N’exagérons rien ! Vous n’êtes pas encore dans la misère. Les frères de feu le Connétable semblent vous être attachés.
— Oui. Nous formons une famille unie mais jusques à quand ? L’air de la disgrâce est le plus difficile à respirer qui soit. Cela dit, je ne suis pas venue jusqu’ici pour me plaindre mais pour réfléchir et prendre conseil.
— De maître Basilio ? J’aurais dû m’en douter…
— Aurait-on besoin de moi ?
A la manière de quelque génie évoqué au prononcé de son nom, un bizarre personnage venait de franchir la porte sans se soucier d’y frapper. C’était, emballé dans une longue robe noire agrémentée d’une fraise un peu fatiguée nouée par un joyeux ruban rouge, un petit homme grisonnant dont la barbe poivre et sel, longue et pointue, projetait lorsqu’il s’agitait une ombre cocasse sur le mur. D’énormes sourcils broussailleux abritaient des yeux vert mousse, vifs et pétillants au-dessus d’un nez retroussé de jouvencelle. Les cheveux gris et raides dépassaient d’une espèce de pot de fleurs renversé en feutre noir surmonté d’un pompon rouge. L’étrange apparition abritait du creux de sa main la flamme d’une bougie que le courant d’air agitait. Elen se précipita pour fermer la porte.
— C’est ce qui s’appelle arriver à point nommé, sourit-elle. Développeriez-vous, par hasard, une tendance à écouter aux portes, maître Basilio ?
Il renifla et lui adressa un regard sévère avant de répondre avec un furieux accent florentin :
— Si… mais seulement pour l’utilité ! L’arrivée du carrosse a fait assez de bruit, sans compter ceux de la cuisine où le maître queux brait comme un âne. Alors voilà Basilio ! Tu ne souhaiterais pas faire appel à ses lumières, Madame la Duchesse ? Parce que tu as des ennuis.
Le langage des cours lui ayant toujours été hermétique, Basilio, arrivé en France dans les bagages de Leonora Galigaï, employait la troisième personne pour lui-même et, universellement, le tutoiement égalitaire des rues de Florence, mais sans jamais oublier le titre qui convenait. Posant sa chandelle sur un coffre, il tira un fauteuil à côté de celui de Marie et s’installa bien au fond, ce qui ne permit plus à ses pieds de toucher le sol.
— Dis-moi, fit-il d’un ton engageant, on t’a mise à la porte ?
— Comment le sais-tu ? bougonna Mme de Luynes.
— Basilio sait toujours tout ! fit-il en tournant vers le plafond un doigt doctoral. C’est même grâce à ça qu’il peut continuer à respirer l’air pur du Seigneur et jouir des succulences autant que des douces odeurs de sa divine Création !
Lui-même sentait l’ail à quinze pas, en dépit du vague effluve de jasmin qu’il répandait avec générosité sur lui quand il se montrait en compagnie. Les parfums étaient cependant sa spécialité initiale. Versé depuis l’enfance dans les herbes, arbres, fleurs et autres plantes, il avait appris d’un vieil apothicaire florentin l’art d’en tirer eaux de senteur, cosmétiques et par la même occasion de confectionner baumes, onguents, potions et autres lotions… Cela lui avait valu la faveur de Leonora Galigaï et accessoirement celle de l’épouse d’Henri IV. Très accessoirement même, car la Concini avait choisi de le tenir en son château de Lésigny à l’écart de la Cour, ce qui avait permis à Basilio de laisser s’épanouir en toute discrétion des connaissances en astrologie ainsi que des dons divinatoires toujours appréciés de sa maîtresse.
L’éloignement où on le tenait l’avait sauvé au moment de la tempête qui s’était abattue sur le maréchal d’Ancre et les siens.
Découvrant le bonhomme – qui n’avait pas jugé utile de fuir ! – à l’étage supérieur d’une des tours, le futur connétable avait été « subjugué » par l’avenir mirobolant que Basilio fit briller devant lui d’entrée de jeu. Quant à Marie, ayant quitté depuis peu sa campagne tourangelle pour entrer aux filles d’honneur de la Reine-mère, sa marraine, elle connaissait naturellement les Concini et si elle détestait d’instinct le mari, elle trouvait la femme très amusante, intéressante même car Leonora savait une foule de choses, s’entendait comme personne à distraire la maussade Marie de Médicis et possédait un goût très sûr pour les agencements intérieurs d’une maison, les toilettes et les bijoux dont sa passion avait fait d’elle une sorte d’expert. Basilio ayant été amené par elle au Louvre à deux reprises, Marie se soucia de lui après le drame qui abattit les Concini, fit emprisonner à Nantes le jeune comte de la Penna, leur enfant de quatorze ans, et envoya la Reine-mère contempler la Loire au château de Blois où elle aurait dû normalement l’accompagner. Mais elle était la fille du duc de Montbazon, vieux et fidèle compagnon d’Henri IV assassiné presque dans ses bras, et il ne pouvait être question de l’inclure dans l’ostracisme dont était frappée sa veuve. La jeune Marie resta donc à Paris dans l’hôtel paternel de la rue de Bethisy. Mais elle réclama Basilio et comme on en était aux préparatifs du mariage avec Charles de Luynes, le parfumeur astrologue fut le premier terrain sur lequel les fiancés se rencontrèrent. Et c’est ainsi que celui-ci put couler des jours paisibles et des nuits étoilées dans le joli château neuf qu’avait bâti Leonora.
Depuis la mort de son époux, Marie n’était pas revenue à Lésigny. Etant donné les mauvaises dispositions affichées par Louis XIII à la suite du décès du Connétable, elle s’était bien gardée de s’éloigner de la Reine. Fière et courageuse de nature, elle n’était pas femme à tourner le dos à l’adversité. Mais maintenant l’adversité la rattrapait.
— C’est vrai, soupira-t-elle. Je ne dois plus paraître au Louvre. Pourquoi ne m’avoir pas prévenue ?
— Parce que tu ne m’as rien demandé, Madame la Duchesse ! Et Basilio a pour habitude de laisser les gens agir à leur guise tant qu’ils ne font pas appel à lui. Tu aurais dû venir après la mort de ton seigneur !
— Le temps était affreux et j’étais sur le point d’accoucher. A présent me voilà… et je ne sais plus que faire !
Elle s’interrompit : un valet venait l’avertir que le souper était servi dans la grande salle. Cela lui rappela qu’elle avait faim, les pires soucis ne lui ayant jamais coupé l’appétit. Rabattant ses jupes, elle sauta sur ses pieds :
— Veux-tu souper avec nous ?
— Basilio a déjà pris sa nourriture… et il a autre chose à faire. Va te réconforter ! On se reverra tout à l’heure !
Sans répondre, Marie suivie d’Elen descendit dans la longue pièce tendue d’une série de tapisseries flamandes où le feu flambait dans la cheminée. Elle se lava les mains sous l’eau fraîche d’une aiguière d’argent assortie d’une cuvette que lui offrait un petit valet, s’essuya à la serviette de toile des Flandres que lui tendait un autre et s’installa avec sa suivante à l’interminable table de chêne ciré où le couvert pour deux personnes donnait une impression d’abandon en dépit du luxe des chandeliers allumés. La Duchesse et sa suivante goûtèrent deux potages, une fricassée de tripes, un chapon rôti, une sorte de tourte aux pois, un pâté aux pommes, des craquelins et des prunes confites, le tout arrosé de vin clairet[2]. C’était assez modeste pour une grande maison mais l’arrivée tardive de la maîtresse n’avait pas permis un plus grand déploiement culinaire. Pas une parole ne fut échangée tandis que l’on se restaurait, chacune des deux femmes s’absorbant dans ses propres pensées.
Une heure plus tard, on était de retour dans la chambre dont le lit avait été préparé. Une servante était en train d’y installer un « moine » tandis qu’une autre ranimait le feu de la cheminée. Marie, pour sa part, décida de se déshabiller et de se coucher. Elle était lasse et attendrait aussi bien dans son lit les conclusions de son « mage » comme elle se plaisait parfois à l’appeler.
Avec l’aide d’une chambrière, Elen la débarrassa, devant le feu, de sa fraise, de sa robe de velours noir brodé de jais et des nombreux jupons qu’elle avait entrepris de mettre à la mode en remplacement du vertugadin qu’elle jugeait raide, incommode et disgracieux. Quand elle fut en chemise, une autre servante lui présenta une cuvette pour s’y laver les mains et le bout du nez, après quoi le court linge de jour fut changé pour un long vêtement de nuit en fine soie plissée couvert d’un peignoir en même tissu, et elle alla s’asseoir devant la table à coiffer surmontée d’un miroir de Venise afin de livrer sa tête aux mains expertes d’Elen. Normalement c’était Anna, sa camériste – une véritable artiste ! – qui prenait soin de sa chevelure mais, étant partie en catastrophe, Marie n’avait emmené que l’indispensable : sa demoiselle favorite et son cocher. Anna en avait montré de l’humeur mais le cas était exceptionnel et de toute façon la volonté de la Duchesse faisait loi. Elen d’ailleurs en était enchantée parce qu’elle adorait manier la somptueuse chevelure de Marie. Après avoir enlevé épingles et peignes de l’édifice compliqué permettant au chapeau de cohabiter avec la délirante fraise « en meule de moulin », la jeune fille commença son ouvrage en enfouissant ses deux mains dans l’épaisse toison pour masser doucement le crâne de la Duchesse qui ferma les yeux avec un soupir d’aise et s’abandonna à cette sensation qui apaisait son esprit :

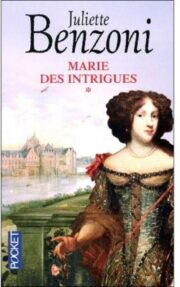
"Marie des intrigues" отзывы
Отзывы читателей о книге "Marie des intrigues". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Marie des intrigues" друзьям в соцсетях.