À quelques exceptions près – certains grands seigneurs possédaient leur propre nef –, ces navires venaient de Marseille et de Gênes. Le Roi, depuis deux ans, les avait retenus et faits équiper de façon qu’ils pussent transporter son armée et ses chevaux le plus commodément possible. Car il n’avait rien laissé au hasard : des montagnes de vivres de toutes sortes l’attendaient déjà dans l’île de Chypre choisie comme point de ralliement. Chypre, dernier royaume latin dont la couronne appartenait aux Lusignan, n’était qu’à vingt-cinq lieues (terrestres) de la côte syrienne.
D’un geste sec, Renaud aplatit un moustique égaré sur son cou. Ces bestioles étaient la plaie de ce port surgi d’une lagune agrandie et environné de marais et de salines, assez vaste pour contenir sans peine l’armada royale. Ces damnés insectes représentaient le dernier inconvénient avant la grande envolée vers le large et cette mer de saphir qui mènerait la croisade vers sa terre promise… Puisque enfin on allait partir après avoir tellement désespéré d’y arriver jamais !
Pourtant que de chemins parcourus depuis trois ans à la queue du cheval de Robert d’Artois toujours derrière le Roi ainsi qu’il l’avait annoncé. Ce qui ne voulait pas dire dans les entours de la Reine, bien au contraire ! Ainsi, le Pape ayant réussi à réunir à Lyon son concile vengeur contre Frédéric II, avait réclamé hautement la présence, et l’aval, du souverain français. Ce à quoi Louis s’était refusé longtemps, tenant à conserver des relations convenables avec l’irascible empereur allemand tout en ménageant le Pontife romain et en gardant des possibilités d’arbitrage d’un quelconque accommodement entre eux. Ce qui relevait de l’exploit, l’excommunication ayant été dûment fulminée par Innocent et approuvée par les cardinaux contre celui que l’on appelait le « Sultan baptisé ».
Dans le but d’amadouer la fureur du Saint-Père sans se jeter dans le chaudron lyonnais, Louis, en bon diplomate, avait invité celui-ci à le rejoindre en terrain neutre : la grande abbaye de Cluny, point trop éloignée de Lyon, l’un des phares spirituels de l’Europe et sans doute la plus importante car elle était l’origine d’environ mille deux cents moines frères répandus dans l’Occident chrétien. Il s’y rendit donc, en grand arroi et avec la magnificence digne d’un roi de France en compagnie de sa mère, de sa sœur Isabelle plus tournée vers Dieu que jamais, de l’inévitable Robert et du jeune Charles d’Anjou. À la grande indignation de Renaud, la reine Marguerite 26, qu’aucune grossesse ne retenait à Paris, dut rester au logis avec sa royale marmaille…
Cependant Renaud devait garder de Cluny un beau souvenir du moins à la richesse de l’abbaye, à sa gigantesque église Saint-Hugues, la mieux ornée, la plus longue et la plus haute du monde que par la surprise qui l’y attendait : Baudouin de Constantinople et sa suite – y compris le cornemuseux ! – accompagnaient Innocent. Et ce fut avec une joie profonde qu’après la bénédiction particulière que lui accorda le Pape il mit genou en terre devant celui qui l’avait arraché à un sort fatal. Baudouin l’avait embrassé avec sa chaleur habituelle en le félicitant d’avoir enfin réalisé son rêve, après quoi Renaud était tombé dans les bras de son ami Guillain d’Aulnay. Tous deux avaient tant de choses à se raconter que les importants palabres qui se discutaient au niveau suprême leur passèrent un peu au-dessus de la tête. Une seule chose comptait vraiment : ils allaient revenir ensemble à Paris, Louis ayant décidé d’apporter une aide sérieuse à son malheureux cousin puisque la croisade annoncée dont Innocent IV s’enchantait prendrait le chemin de la mer et non celui de son empire.
Un instant, on craignit d’être à nouveau séparés. En effet le comte de Provence, père de Marguerite, venait de mourir laissant une dernière fille, Béatrix, la plus jeune, déjà convoitée par plusieurs prétendants. Or son oncle, l’archevêque de Lyon Philippe de Savoie qui se trouvait à Cluny avec le Pape, souhaitait qu’elle fût mariée au jeune Charles d’Anjou et laissa entendre qu’il fallait forcer quelque peu la main de la comtesse veuve, sa sœur. Aussi Charles fut-il envoyé sur-le-champ à Forcalquier à la tête d’une petite armée détachée de l’énorme escorte royale. Toujours disposé à prendre la route dès qu’il s’agissait de distribuer des horions, Robert d’Artois se proposa pour une fois à l’accompagner mais le Roi ne le permit pas :
— S’il convient de montrer notre force, il ne s’agit pas d’aller pourfendre les prétendants qui gravitent autour de la comtesse de Provence ! Monseigneur de Lyon sera une escorte bien plus paisible et plus crédible que mon cher et bouillant frère !
Charles d’Anjou était donc parti seul épouser la jeune Béatrix qu’il ramena triomphalement trois mois plus tard au palais de la Cité et où des fêtes brillantes furent données, à la grande joie de Marguerite, infiniment heureuse de retrouver sa petite sœur…
Dans les mois qui suivirent, Robert d’Artois autorisa Renaud à rester auprès de son ancien maître jusqu’à son départ définitif pour Constantinople. Avec lui, il fit un voyage en Angleterre pour y recueillir l’aide qu’offrait tout à coup le roi Henry. Il y vit les deux sœurs de Marguerite, les trouva beaucoup moins belles – encore qu’avec un brin de mauvaise foi car aucune des Provençales n’était laide ! –, puis on se rendit à Namur, dans la parentèle Courtenay nordique afin d’y négocier la passation des droits de Baudouin sur le marquisat. Enfin, Renaud revit avec émotion le pays de son enfance quand l’Empereur se rendit en son château du Gâtinais qu’il avait offert en douaire à l’impératrice Marie, sa femme, en vue d’y régler divers litiges et autres questions relevant de son pouvoir féodal. Renaud revit ainsi la tour oubliée près de laquelle il avait, de ses mains, enterré celui qui lui avait tout donné : le grand Thibaut de Courtenay que l’on croyait être son père.
Il s’y rendit en la seule compagnie de Gilles Pernon, son ombre fidèle et inlassable qui ne le lâchait d’une longueur d’épée, mêlant à ses devoirs d’écuyer un curieux sentiment quasi paternel qui le poussait à veiller sur lui sans désemparer. Donc, pas question de s’enfoncer seul dans les méandres d’une forêt épaisse et mal connue !
Un peu agacé d’abord, Renaud finit, ce jour-là, par en remercier le ciel. Pernon possédait un sens étonnant de l’orientation et l’art de retrouver son chemin, en quelque circonstance que ce fût, dans un endroit où il n’avait jamais mis les pieds. Grâce à lui et à quelques renseignements qu’il put glaner, on parvint à la tour sans erreur de parcours.
En apercevant entre les arbres l’infime monticule surmonté d’une croix grossière sous lequel reposait le vieux chevalier, Renaud se sentit étreint d’une profonde émotion et, pour s’en approcher avec plus de respect encore, il allait descendre de sa monture quand Pernon le retint :
— Nous ne sommes pas seuls, messire ! chuchota-t-il.
Un cheval, la bride sur le cou, broutait librement l’herbe tendre et les jeunes pousses dans la petite clairière. Un cheval qu’à son harnachement les deux hommes identifièrent sans peine :
— Un Templier ! marmonna Renaud sourcils froncés. Que fait-il là ? Et d’abord, où est-il ?
Les deux hommes mirent pied à terre sans faire de bruit, tirèrent l’épée d’un même mouvement et se dirigèrent vers la tour sans que le cheval occupé d’une touffe particulièrement savoureuse songeât seulement à les signaler. Un homme était là en effet, un Templier qui devait être de haute taille bien qu’il disparût à moitié dans le vieux coffre où Thibaut jadis gardait le peu de ce qu’il avait de précieux, comme le manteau blanc à croix rouge dont Renaud l’avait revêtu pour l’ensevelir.
Du seuil, celui-ci demanda sèchement :
— Peut-on savoir ce que vous cherchez céans ?
Avec une étonnante rapidité, l’intrus se redressa, se retourna, montrant dans l’encadrement d’acier du camail un visage aux traits sculptés, profonds, une bouche mince et dure annonçant un caractère impitoyable et des yeux gris d’une dureté minérale.
— Je ne crois pas que cela vous concerne, articula-t-il d’une voix lente, un œil sur l’épée de Renaud mais sans traduire le moindre sentiment. Commencez par dire qui vous êtes.
— Je pourrais vous retourner la question si j’étais aussi discourtois que vous. Ce qui est étrange pour un chevalier du Temple. Sachez seulement que je suis le fils de celui qui repose sous la croix de la clairière et que j’ai nom Renaud de Courtenay, répondit-il sans se déprendre de son arme. À vous à présent.
L’homme parut se détendre, esquissant même un sourire :
— En ce cas rengainez donc votre estoc car j’ai autant droit que vous d’être ici. Je suis frère Roncelin, de la commanderie de Joigny… Votre père appartenant toujours au Temple en dépit de l’isolement où il avait choisi de vivre, nous nous sommes avisés que son ermitage gardait peut-être des… objets ou des… écrits relevant de notre règle et qui…
— Roncelin de quoi ? émit Renaud qui ne cédait pas. On ne perd pas son nom quand on entre dans l’Ordre.
— De Fos ! Ne cherchez pas, ajouta-t-il avec dédain, ce n’est pas un nom de cette contrée. À présent, laissez-moi achever ma mission !
— Inutile ! Frère Thibaut vivait dans la sainte pauvreté. Il n’avait dans cette tour que les herbes sèches et les quelques remèdes qu’il en composait pour secourir les bêtes blessées et les petites gens de la forêt. Plus le manteau de l’Ordre dont je l’ai enveloppé avant de le confier à la terre car c’est moi qui l’ai enseveli… et qui ai fermé cette porte avant d’en remettre la clef à frère Adam Pellicorne dont votre commanderie se souvient peut-être encore !
— Certes, certes ! Nous révérons sa mémoire.
— D’où vient alors que vous ayez enfoncé l’huis ? On aurait dû, là-bas, vous remettre la clef !
— Nul ne sait ce qu’elle est devenue. Il le fallait bien !
— Soit ! soupira Renaud en se décidant finalement à remettre son glaive au fourreau. À présent, me ferez-vous la grâce de me laisser prier en paix ?
— C’est trop naturel. Vous appartenez sans doute à l’entourage de l’empereur Baudouin, qui réside ces jours en son château de Courtenay ? ajouta Roncelin de Fos soudain fort radouci.
— Non. J’appartiens à monseigneur Robert d’Artois mais, ayant servi l’Empereur il n’y a pas si longtemps, je lui ai été prêté jusqu’à son retour à Constantinople…
— À merveille ! Eh bien, je vous laisse à votre oraison. Je suis désolé pour la porte !
Et il s’en fut. Renaud et Pernon le regardèrent reprendre son cheval et disparaître dans la forêt, mais le vieil écuyer n’était visiblement pas content :
— Pourquoi, diable, lui avez-vous dit tout cela ? bougonna-t-il. Votre vie ne le regarde pas. Et je n’aime pas cet homme.
— Moi non plus, mais je n’ai rien révélé d’extraordinaire. N’importe qui au château aurait pu lui en dire autant en admettant qu’il souhaite se renseigner. Ma vie est désormais sans secrets, conclut-il.
— Espérons-le !
Tandis que Renaud s’agenouillait sur la tombe, Gilles Pernon s’efforçait de remettre la porte en place tant bien que mal, non sans souhaiter tous les maux de la terre aux Templiers trop curieux. Renaud, lui, pria longtemps, essayant d’appeler à lui l’esprit de celui qui reposait là parce qu’il ne pouvait se débarrasser de l’impression désagréable laissée par sa confrontation avec Roncelin de Fos. Une inquiétude le prenait au sujet de ce que cherchait au juste cet homme et jusqu’où il eût été capable d’aller si l’on n’était pas arrivé. Une pensée horrible lui venait qu’il tentait de rejeter mais qui s’accrochait, têtue, insistante. Le Templier aurait-il osé fouiller la tombe ?
Cette impression fut si forte que, de retour à Courtenay, il alla trouver l’Empereur pour lui raconter ce qui venait de se passer :
— Je ne suis pas tranquille, dit-il en conclusion. Évidemment je ne sais ce qu’il cherchait, mais il semblait fort acharné et je voudrais pouvoir surveiller la tombe pendant quelque temps… Et si l’Empereur voulait bien m’accorder un congé…
— Non. Nous repartons pour Paris dans deux jours. Mais j’ai peut-être mieux à vous offrir. Demain vous y retournerez avec le chapelain, une garde d’honneur, un chariot, un cercueil et des fossoyeurs.
— Vous voulez l’exhumer ? Mais pour le mettre où ?
— Là où devrait être depuis longtemps ce preux qui fut le frère d’armes et le plus fidèle compagnon du Roi lépreux : dans la chapelle de ce château…
Les larmes aux yeux, Renaud ne sut que s’incliner pour baiser, en remerciement, la main de cet homme généreux qui lui accordait la paix de l’âme. Et le lendemain, il retournait dans la forêt avec le petit cortège prévu par Baudouin. Sire Henri Verjus le commandait mais, quand on arriva, il fut évident, pour ces hommes habitués à lire dans la nature les traces du gibier ou de l’homme, que l’on avait touché à la sépulture même si l’on avait essayé de remettre au mieux les touffes d’herbe :

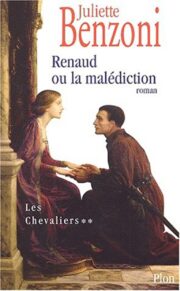
"Renaud ou la malédiction" отзывы
Отзывы читателей о книге "Renaud ou la malédiction". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Renaud ou la malédiction" друзьям в соцсетях.