Mais il y avait deux ou trois échoppes qu’elles affectionnaient particulièrement parce qu’elles n’en connaissaient pas de semblables et c’étaient celles de marchands de « candis », les confiseries à base de sucre de canne qui étaient l’une des grandes prospérités de l’île. C’était un plaisir pour les deux princesses d’acheter elles-mêmes des cornets de fruits confits, de pétales de roses raidis de sucre, d’amandes craquantes sous une mince pellicule et de tant d’autres choses exquises dont le seul défaut était de faire parfois mal aux dents… Elles s’en amusaient comme des enfants. La reine Stéphanie les accompagnait de temps à autre et ces boutiques furent bientôt le lieu de rendez-vous élégant de la ville.
Renaud n’avait pas été le dernier à s’en apercevoir et, presque chaque jour, il allait flâner dans le bienheureux quartier pour le simple bonheur d’apercevoir sa reine et aussi de la saluer. Elle le connaissait bien à présent et, en récompense, il recevait toujours un sourire, quelques mots. Elle le présenta même à la comtesse Béatrix qui, douée d’un franc-parler bien provençal, n’hésita pas à le déclarer « charmant ». Ce dont il rougit fort parce que Marguerite avait approuvé. Seul point noir de ces rencontres : la présence constante d’Elvira de Fos. Bien qu’ils n’eussent jamais échangé le moindre propos, l’antipathie entre eux était quasi palpable. La poétesse avait une manière de le fixer de ses yeux sans reflets qui lui donnait l’impression d’être cloué au pilori. Et quand elle détournait enfin son regard, sa longue bouche sinueuse esquissait un sourire tout aussi indéchiffrable. Dans ces occasions, Renaud avait l’impression glaçante de se trouver en face d’un serpent. Elle ressemblait trop à son frère et, lorsqu’il voyait Marguerite s’éloigner en s’appuyant sur cette femme, il avait envie de lui crier un avertissement, de se jeter entre elles afin d’éloigner de sa bien-aimée cette créature dont il aurait juré qu’elle était néfaste.
Il réussit à rencontrer dame Hersende et ne lui cacha pas son sentiment, heureux de constater qu’elle partageait ses préventions.
— J’essaie de m’en défendre, soupira-t-elle, car demoiselle Elvira n’a jamais rien dit ni fait qui puisse donner prise à la moindre critique. Elle est dévouée, serviable, toujours d’humeur égale et, quand elle chante, elle est sublime. Non je n’ai rien à lui reprocher, mais c’est plus fort que moi : il y a en elle un je-ne-sais-quoi qui m’inquiète. Or Madame Marguerite lui montre chaque jour plus d’attachement… et moi je regrette de plus en plus que demoiselle Sancie de Signes nous ait quittés.
— Ce qui est étrange, c’est qu’elle ne soit jamais revenue. Elle adorait la Reine et voulait la suivre toujours et partout…
— Mais il lui fallait obéir à son père et, à présent, elle est mariée.
— Mariée ? Qui a-t-elle bien pu épouser ? Elle est si laide, la pauvre ! Il est vrai qu’elle est de noble et riche famille…
— Si laide, si laide ! C’est vite dit, et voilà bien les hommes. Leur regard est superficiel ! N’importe, il y en a quand même un qui a pris du goût pour elle puisqu’il l’a épousée.
— Dans le but d’avoir des marmots ? Grand bien lui fasse ! Enfin, en ce qui concerne ce dont nous parlions à l’instant, vous êtes là fort heureusement et fort capable de veiller…
— Je ne suis pas en permanence auprès de la Reine. Je soigne aussi le Roi, toute la famille et l’entourage, sans compter les serviteurs. La vieille Adèle est présente, elle aussi, mais elle ne va pas bien ces derniers temps et les deux dames de parage sont des bécasses. Il nous faudrait vraiment quelqu’un d’autre. En attendant, je ferai de mon mieux. Enfin peut-être laissons-nous vagabonder un peu trop notre imagination, vous et moi ?
— Je ne crois pas…
Une rencontre, quelques jours plus tard, vint distraire un moment Renaud de ses soucis.
Il rentrait de la cathédrale où il avait pris l’habitude d’aller voir Eudes de Montreuil afin d’admirer son ouvrage et causer avec lui. Une manière simple de prolonger l’amitié avec un père auquel il ressemblait beaucoup : même regard, même sourire et même intransigeance dans le travail. Même souci de la perfection. Entre eux l’entente s’était nouée presque sans paroles. L’imagier était sensible à l’émerveillement non déguisé du chevalier et celui-ci au contentement qu’il pouvait lire sur le visage paisible, mais déjà marqué de plis, où s’incrustait la poussière de pierre, du jeune maître d’œuvre… Le temps passait vite quand ils étaient ensemble ; aussi Renaud, ce soir-là, se hâtait-il de regagner le palais d’Ibelin où l’on attendait à souper les deux rois, les reines et leurs proches, quand il vit venir vers lui un petit groupe plutôt bizarre.
En tête chevauchait un seigneur qu’il connaissait de vue et qui d’ailleurs passait difficilement inaperçu à cause des vêtements d’un joyeux vert pomme dont il aimait à se parer : c’était le jeune sénéchal de Champagne, messire Jean de Joinville, un garçon de vingt-trois ou vingt-quatre ans qui s’était récemment taillé une réputation parmi les chefs de l’armée en venant tout benoîtement expliquer au Roi qu’il n’avait plus d’argent et que les dix chevaliers emmenés par lui menaçaient de le quitter et de rentrer au pays par crainte de mourir de faim. Non seulement Louis l’avait écouté avec bienveillance, mais il lui avait fait compter par son trésorier une jolie somme en ajoutant qu’il se chargerait désormais de ses Champenois faméliques. Aussi le sourire était-il revenu sur sa bonne figure ronde, aimable façade d’une grosse tête à cheveux bruns que même le port du heaume n’arrivait à discipliner. Pour l’instant il menait en bride une mule transportant une jeune dame mal vêtue qui semblait sur le point de tomber à chaque pas de sa monture tant elle paraissait lasse. On ne pouvait dire qu’elle eût vraiment bonne mine ! Une autre femme qui avait assez l’air d’une servante la suivait, montée sur un âne. Quant à l’écuyer du sire de Joinville, il allait à pied, son cheval étant occupé par un personnage qui, soudain, se mit à agiter les bras avec des cris de joie :
— Renaud de Courtenay ! Mon ami Renaud ! Quel plaisir de vous revoir !
Le jeune homme l’avait reconnu et courait vers lui sans se soucier des autres :
— Guillain d’Aulnay ! Loué soit Dieu ! Par quel miracle ?
Mais déjà l’habituel compagnon de Baudouin II avait sauté à terre et accourait les bras ouverts. Les deux hommes s’accolèrent en se tapant dans le dos avec un enthousiasme qui fit lever un sourcil réprobateur au sire de Joinville, puis l’autre quand il constata que la séance de retrouvailles risquait de durer :
— Hum !… N’oubliez-vous pas un peu messire d’Aulnay, qui attend, avec une bien charitable patience, que vous en ayez fini de vos embrassades ? émit-il d’un ton courroucé qui rompit le charme.
Les deux hommes se séparèrent et Aulnay, confus, mena son ami auprès de la dame si dolente devant laquelle il s’inclina profondément :
— Que notre grande souveraine veuille bien me pardonner un moment d’émotion et me permette de lui présenter le chevalier Renaud de Courtenay, qui bien servait son noble époux en tant qu’écuyer quand nous fûmes à Rome et en tirèrent Sa Sainteté le pape Innocent !
Complètement abasourdi, Renaud se retrouva en train de saluer cette jeune femme sans apparence, blonde et un peu terne, habillée n’importe comment de surcroît et qui, sauf erreur, n’était autre que l’épouse de Baudouin II, cette Marie de Brienne dont il avait entendu vanter à maintes reprises le courage, la dignité et le maintien vraiment royal. Elle devait avoir subi une bien rude épreuve pour être en cet état et une horrible pensée lui traversa l’esprit : serait-elle veuve et le cher Baudouin aurait-il disparu à la fleur de l’âge ? Évidemment elle n’était pas en deuil, mais ses habits misérables ne signifiaient rien.
Elle fondit en larmes quand elle entendit la présentation de Renaud :
— Un ancien serviteur de mon cher époux ne peut m’être qu’agréable, gémit-elle. Il a tant de besoin de soutien !
Et elle se tourna pour demander un mouchoir à sa suivante tandis que le sénéchal de Champagne, coupant la parole à Aulnay, expliquait que la nef amenant l’impératrice à Chypre avait été emportée par un coup de vent au moment où elle débarquait dans le port de Paphos, non loin du camp de Limassol où il se trouvait alors avec son cousin Érard de Brienne qui était aussi celui de la naufragée. Car c’en était une et qui avait grand besoin d’aide féminine. En se retrouvant sur le sable, elle avait eu l’idée d’envoyer son écuyer, le sire de Jauny, au camp des croisés dans l’espoir d’y trouver justement le sire de Brienne et lui-même. Ils s’étaient précipités, et tandis que Joinville trouvait des montures pour emmener au plus tôt la pauvre femme à Nicosie, Brienne restait à Paphos pour voir si d’aventure un autre coup de vent ne ramènerait pas le navire impérial…
— Espérons seulement qu’il n’est pas allé se fracasser sur quelque rocher ! Les gens de Paphos l’ont vu entraîné au large en direction de la côte syrienne comme par la main de Dieu. Quant à la barque amenant à terre l’impératrice, elle a été retournée par une grosse vague qui – grâces en soient rendues à Dieu ! – l’a portée sur la grève avec sa suivante. Les sires d’Aulnay et de Jauny ont dû nager pour la rejoindre. À présent souffrez que nous nous quittions ! Il nous faut voir très vite le Roi et surtout la Reine ! Savez-vous où ils sont ?
— Ils doivent souper ce soir en l’hôtel d’Ibelin où loge monseigneur d’Artois. Je ne sais s’ils y sont déjà, étant moi-même en retard. Le mieux est que vous me suiviez ! S’ils ne sont pas encore arrivés, la dame d’Ibelin saura prendre soin de l’impératrice…
Mais les souverains étaient là, et l’entrée en scène de la pauvre Marie prit toute sa dimension dramatique. Elle fut entourée, réconfortée, emmenée par les princesses dans l’appartement des dames pour y être baignée, vêtue comme il convenait à son rang et finalement conduite à table où elle fut vraiment la reine de la soirée, Marguerite et Stéphanie s’effaçant volontairement pour lui laisser la première place. Elle en fut heureuse au début mais dans cette atmosphère élégante, fastueuse et pleine de gaieté – à Chypre le goût de la fête faisait partie de l’essence même de la vie –, elle parut s’éteindre peu à peu comme une lampe où l’huile vient à manquer et, pour finir, éclata en sanglots :
— Oh, Dieu, moi je suis là, dans le luxe et l’abondance tandis que mon pauvre seigneur…
Ce fut Guillain qui renseigna Renaud sur la situation guère reluisante de l’Empereur. Le retour de Baudouin avec ce qu’il avait pu obtenir de troupes et d’or y avait apporté un peu de soulagement, mais un peu seulement. Les trêves avec Vatatzès, l’empereur de Nicée, avaient récemment expiré et ce dernier n’avait pas perdu de temps pour se mettre en marche. Il reprit plusieurs cités et eût attaqué Constantinople si, justement, Baudouin n’était arrivé. Il força Vatatzès d’ailleurs malade à rentrer chez lui, mais comprit vite que ce n’était, au fond, que reculer pour mieux sauter et qu’à l’exception de Constantinople, dégagée pour un moment, sans doute la situation n’était-elle pas beaucoup meilleure qu’à son départ pour l’Occident. Les troupes qui l’avaient aidé à rentrer se dispersaient soit pour rejoindre la croisade, soit pour regagner leur pays d’origine. De toute façon, on n’aurait pas pu les payer encore longtemps, l’or que l’on avait rapporté ayant fondu comme neige au soleil avec les nécessaires réparations des murailles et l’apurement de certains comptes :
— L’Empereur en est réduit aux expédients pour se procurer de l’argent, soupira Aulnay. Il est allé jusqu’à vendre le plomb qui couvre les palais impériaux et même… jusqu’à engager son fils Philippe aux Vénitiens… Une sorte d’otage pour l’avenir !
— Comment est-ce possible ?
— Pour les Vénitiens le commerce passe avant tout et la mainmise sur un futur empereur, soumis à leur politique, peut être une bonne chose. Oh, mon ami, nous vivons des jours difficiles et je suis heureux pour vous que votre destin ait pris un chemin différent…
— Vous me le faites presque regretter, je dois beaucoup à l’Empereur et je l’aime bien. Mais ne vous tourmentez pas. Le roi Louis est trop généreux pour ne pas assister des parents dans le malheur. Je suis certain qu’en repartant à Constantinople…
— Nous ne repartirons pas. Notre sire Baudouin attend de l’aide, mais ne veut pas que son épouse revienne. Sa mission accomplie ici, elle doit – nous devons ! – se rendre en France afin de prendre elle-même en main le gouvernement de Courtenay et des terres qui lui restent. Elle ne reviendra que lorsque les choses seront rentrées dans l’ordre… si elles y rentrent un jour.

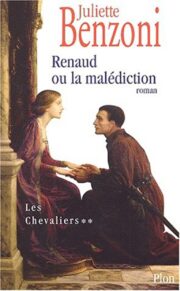
"Renaud ou la malédiction" отзывы
Отзывы читателей о книге "Renaud ou la malédiction". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Renaud ou la malédiction" друзьям в соцсетях.