– Fichez le camp, Arnold. Vous avez votre argent, nous sommes quittes.
– J'ai promis à votre grand-père de veiller sur vous. Nous serons quittes le jour où je ne serai plus. Au revoir, Suzie.
Et Arnold Knopf s'en alla.
*
Le matin suivant, Andrew arriva pile à l'heure en conférence de rédaction. Il y prit même quelques notes, ce qui n'échappa pas à sa rédactrice en chef.
Au sortir de la réunion, elle s'arrangea pour emprunter l'ascenseur avec lui.
– Vous êtes sur un coup, Stilman ?
– Je vous demande pardon ?
– Ce matin en réunion, j'ai croisé le regard de quelqu'un que je n'avais plus vu depuis longtemps.
– J'en suis ravi pour vous, de qui s'agit-il ?
– Sur quoi travaillez-vous ? Et ne me reparlez pas de l'Afrique du Sud, je n'y crois pas une seconde.
– Je vous le dirai en temps voulu, répondit Andrew.
Les portes de la cabine s'ouvrirent. Andrew se dirigea vers son bureau, attendit qu'Olivia Stern s'éloigne et fit demi-tour pour redescendre au sous-sol par l'escalier de secours.
Il passa la matinée à la salle d'archives. Il trouva trace d'une Suzie Baker, notaire à Dexter, d'une Suzie Baker professeur de psychologie à l'université James Madison en Virginie, d'une Suzie Baker artiste peintre, d'une Suzie Baker professeur de yoga, d'une Suzie Baker administratrice à l'université de Warwick, et de vingt autres Suzie Baker. Mais après avoir consulté tous les moteurs de recherche imaginables, il fut incapable de glaner la moindre information sur la Suzie Baker qu'il avait rencontrée à la bibliothèque. Et ceci l'intrigua bien plus que s'il avait découvert quoi que ce soit à son sujet. À l'heure des réseaux sociaux, il était impossible qu'une personne n'eût laissé aucune trace de sa vie sur Internet.
Andrew songea à passer un coup de fil à l'un de ses contacts dans la police, mais il se rappela que sa voisine de bibliothèque sous-louait son appartement. Il n'y avait aucune raison que l'électricité ou le gaz fussent à son nom. Sans pièce administrative, impossible d'en apprendre plus. La Suzie Baker à qui il avait confié les clés de son appartement restait dans un anonymat complet ; quelque chose clochait là-dedans et Andrew savait que lorsque ses sens étaient en alerte, il se trompait rarement.
L'un de ses copains de collège travaillait au service des impôts municipaux. Il décrocha son téléphone et apprit par lui que l'appartement 6B au 65 Morton Street était la propriété d'une société norvégienne. Drôle d'identité pour une prétendue amie partie quelques mois en Europe. Andrew se leva pour se dégourdir les jambes et réfléchir.
– Qui êtes-vous, Suzie Baker ? grommela-t-il en reprenant place devant son écran d'ordinateur.
Il pianota « Accident mont Blanc » sur le clavier et trouva une liste de drames survenus en montagne.
Un entrefilet sur le site d'un quotidien français relatait l'intervention d'une équipe de secours qui avait récupéré en janvier dernier une alpiniste qui avait passé deux nuits bloquée par une tempête à 4 600 mètres. La victime, qui souffrait d'engelures et d'hypothermie, avait été évacuée vers le centre hospitalier de Chamonix. Andrew jeta un coup d'œil à la pendule murale. Il était 11 heures du matin à New York, 17 heures en France. Il attendit de longues minutes au téléphone avant de réussir à joindre la rédaction du Dauphiné, mais il ne comprit pas un mot de ce que son correspondant lui disait, bien que ce dernier eût fait l'effort de s'adresser à lui dans sa langue. Il passa un autre appel, au centre hospitalier de Chamonix et souhaita parler au directeur, se présentant pour ce qu'il était, c'est-à-dire un journaliste du New York Times. On le fit patienter, la personne au bout du fil nota le numéro auquel on pouvait le rappeler et elle raccrocha. Andrew était persuadé que sa demande resterait lettre morte et qu'il lui faudrait harceler l'hôpital avant qu'on veuille bien le renseigner. Mais son téléphone sonna trente minutes plus tard. Edgar Hardouin, directeur du CHU, voulait savoir en quoi il pouvait lui être utile.
Andrew lui parla de Suzie Baker, déclarant qu'il écrivait un papier sur les soins prodigués aux touristes américains voyageant en Europe. Le directeur ne se souvenait pas de ce cas. À sa décharge, expliqua-t-il, son hôpital accueillait un nombre important de blessés en montagne, mais il promit de consulter les dossiers et de le joindre le lendemain.
Après avoir raccroché, Andrew se rendit à la bibliothèque.
*
En arrivant en salle de lecture, Suzie trouva la place de son voisin inoccupée. Elle posa son ouvrage et se rendit à la cafétéria. Andrew buvait un café en lisant son journal, à une table près de la fenêtre.
– Les boissons sont interdites là-bas, et j'ai besoin de caféine ce matin.
– Mal dormi ?
– Sur un lit... J'en avais perdu l'habitude. Et vous ?
– Le vôtre est très confortable.
– Qu'est-ce qu'elle a, cette main droite pour que vous la cachiez toujours dans votre poche ?
– Je suis gauchère, je m'en sers peu.
Suzie hésita un instant.
– C'est plutôt ce qu'elle n'a plus, dit-elle en présentant sa main.
L'index et le majeur étaient sectionnés au niveau de la deuxième phalange.
– Dette de jeu ? demanda Andrew.
– Non, dit Suzie en riant, engelures. Le plus étrange, c'est qu'on continue de les sentir, comme si l'amputation n'avait jamais eu lieu. Parfois la douleur se réveille. Il paraît que ça passe au bout de quelques années.
– Quand est-ce arrivé ?
– L'hiver dernier, nous escaladions le mont Blanc, nous sommes tombés dans une crevasse.
– C'est au cours de cette expédition que votre ami s'est donné la mort ?
– Il ne s'est pas donné la mort, je l'ai tué.
Andrew fut stupéfié par cet aveu.
– Mon imprudence et mon entêtement lui ont coûté la vie, ajouta Suzie.
– Il était votre guide, c'était à lui que revenait d'apprécier le danger.
– Il m'en avait avertie, je n'ai pas voulu l'entendre, j'ai continué à grimper, il m'a suivie.
– Je peux comprendre ce que vous ressentez. Moi aussi, je suis responsable de la mort d'un homme.
– Qui ?
– Le garde du corps d'un type que je traquais. On avait jeté de la ferraille sur une route pour crever les pneus de leur voiture et les forcer à s'arrêter. Ça a mal tourné, la bagnole a fait un tonneau et le passager avant a été tué.
– Vous n'y allez pas par quatre chemins dans vos enquêtes ! siffla Suzie.
– C'est drôle, je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à mon meilleur ami.
– Alors, pourquoi me l'avoir dit ?
– Pour témoigner que les choses se passent rarement comme prévu, que les accidents existent. Qu'est-ce que vous fichiez sur le mont Blanc en plein hiver ? Je n'y connais rien en alpinisme, mais j'imagine que ce n'est pas la meilleure saison pour aller faire de la grimpette en montagne.
– C'était une date anniversaire.
– Vous fêtiez quoi ?
– Le crash d'un avion qui s'est abîmé sur les rochers de la Tournette.
– C'est sympathique de faire la fête avec vous.
– Moi aussi, je viens de vous faire une confidence. Je crois même vous en avoir dit plus que je ne le voulais.
– Si c'était de la provocation, c'est réussi.
– Aucunement, répondit Suzie. Restez ce gentleman qui a confié les clés de son appartement à une inconnue et changeons de sujet.
– Vous avez raison, après tout, cela ne me regarde pas.
– Je m'excuse, je ne voulais pas être brutale.
– Pourquoi alliez-vous célébrer l'anniversaire d'un accident d'avion à 4 600 mètres d'altitude ? Un de vos proches se trouvait à bord ? Vous vouliez lui rendre un dernier hommage ?
– Quelque chose comme ça, répliqua Suzie.
– Je peux comprendre aussi. C'est difficile de faire le deuil de quelqu'un sans pouvoir se recueillir sur une tombe. Mais entreprendre ce genre de pèlerinage et perdre votre compagnon, c'est d'une cruauté sans nom.
– La montagne est cruelle, la vie aussi, non ?
– Que savez-vous de moi exactement, mademoiselle Baker ?
– Que vous êtes reporter au New York Times, vous me l'avez dit hier.
– Et c'est tout ?
– Vous êtes divorcé, et vous avez une addiction à l'alcool, mais est-ce que les deux sont liés, vous ne me l'avez pas dit.
– Non, je ne vous l'ai pas dit.
– Ma mère buvait, je sais reconnaître quelqu'un qui picole à cent mètres.
– Si loin que ça ?
– Oui, comme tous les enfants d'alcoolique, et j'en garde de très mauvais souvenirs.
– J'ai arrêté, longtemps, repris, et...
– ... vous arrêterez à nouveau et replongerez à chaque coup dur.
– Vous savez choisir vos mots.
– On me l'a souvent reproché.
– On a eu tort. J'aime les gens qui n'ont pas peur d'être directs, dit Andrew.
– C'est votre cas ?
– Je crois, oui. Mais j'ai du travail et vous aussi. Nous nous verrons peut-être demain.
– Certainement, je vous rendrai vos clés. J'ai écouté vos conseils et cassé ma tirelire. Je me suis commandé une nouvelle literie.
– Et une serrure ?
– À quoi bon, si quelqu'un voulait encore la forcer, vieille ou neuve, ça ne changerait pas grand-chose. À demain, monsieur Stilman, je retourne en salle de lecture.
Suzie se leva et emporta son plateau. Andrew la suivit du regard, décidé à en apprendre plus sur cette femme au comportement déroutant.
Il quitta la cafétéria et se fit déposer en taxi devant le 65 Morton Street.
*
Il sonna à chaque interphone et attendit que quelqu'un finisse par lui ouvrir. Il croisa une femme sur le palier du second étage et lui annonça très naturellement qu'il venait livrer un pli à Mlle Baker. En arrivant devant la porte du 6B, il lui suffit d'un petit coup d'épaule pour l'ouvrir. Une fois à l'intérieur de l'appartement, il regarda autour de lui, s'approcha du bureau, et fouilla les tiroirs.
Ils ne contenaient que quelques stylos et un bloc-notes. La première page comportait une série de chiffres incompréhensible. Sur la deuxième on pouvait distinguer l'empreinte d'un message rédigé sur une feuille qui avait dû être arrachée. Les marques étaient suffisamment formées pour rester lisibles.
« Je ne plaisantais pas en vous mettant en garde, Suzie. Faites attention, ce jeu est dangereux. Vous savez comment me joindre, n'hésitez pas en cas de besoin. »
Le reste du carnet était vierge. Andrew photographia les deux premiers feuillets avec son téléphone portable. Il alla inspecter la chambre à coucher et la salle de bains. De retour dans le salon, alors qu'il examinait attentivement les photographies au mur et redressait un cadre, il entendit la voix de sa conscience lui demander à quoi il jouait, qu'imaginerait-il comme excuse si quelqu'un entrait ? Et la même petite voix l'incita à quitter les lieux sur-le-champ.
*
Quand Simon rentra chez lui, il trouva Andrew assis au petit bureau de sa chambre, le nez collé sur son ordinateur portable, un verre de Fernet-Coca à moitié vide en main.
– Je peux savoir ce que tu fais ?
– Je bosse.
– Tu en as bu combien ?
– Deux, peut-être trois.
– Trois ou quatre ? s'enquit Simon en lui confisquant le verre.
– Tu m'emmerdes, Simon.
– Tant que tu dors sous mon toit, accepte la seule chose que je te demande en contrepartie. Le Coca sans Fernet, c'est si difficile que ça ?
– Plus que tu ne le penses. Ça m'aide à réfléchir.
– Parle-moi de ce qui te tracasse, on ne sait jamais, un vieil ami pourrait rivaliser avec une boisson amère.
– Quelque chose ne tourne pas rond chez cette fille.
– Celle de la bibliothèque ?
Simon s'allongea sur le lit, bras derrière la nuque.
– Je t'écoute.
– Elle m'a menti.
– À quel sujet ?
– Elle prétend avoir emménagé il y a peu dans cet appartement de Morton Street, mais c'est faux.
– Tu en es certain ?
– L'air de New York est pollué, mais pas au point que des cadres photo laissent des marques aux murs en quelques semaines. Maintenant, la question est pourquoi ce bobard ?
– Pour que, justement, tu n'ailles pas fouiner dans sa vie. Tu as dîné ? questionna Simon.
– Oui, répliqua Andrew en montrant le verre que Simon lui avait confisqué.
– Mets ta veste !
La nuit approchait, les rues du West Village étaient de nouveau fréquentées. Andrew s'arrêta sur le trottoir en face de son immeuble et leva les yeux vers les fenêtres du troisième étage qui venaient de s'éteindre.

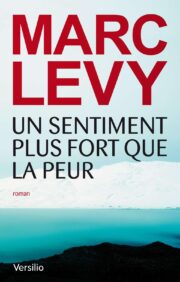
"Un sentiment plus fort que la peur" отзывы
Отзывы читателей о книге "Un sentiment plus fort que la peur". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Un sentiment plus fort que la peur" друзьям в соцсетях.