Andrew gardait le souvenir de cet homme au caractère bien trempé, un vieux brisquard de la profession qu'il avait croisé jadis dans les couloirs du journal lorsque lui-même faisait ses armes au service de nécrologie. À l'époque, Andrew n'appartenait pas encore à la caste des reporters et il n'avait jamais pu lui adresser la parole.
Andrew appela le préposé au courrier et lui demanda l'adresse où il réexpédiait celui de Ben Morton. Figera lui apprit qu'il ne le faisait plus depuis longtemps, seuls des prospectus publicitaires arrivaient encore pour lui au journal et Ben Morton lui avait ordonné de les jeter. Devant l'insistance d'Andrew, Figera finit par lui confier que le journaliste s'était retiré du monde dans un petit hameau, à Turnbridge dans le Vermont, il n'avait pas d'adresse plus précise, juste un numéro de poste restante.
Andrew étudia la carte, il n'y avait d'autre moyen de transport que la voiture pour se rendre à Turnbridge. Il ne s'était plus servi de sa Datsun depuis le jour où un lecteur mécontent l'avait endommagée à coups de batte de baseball dans un parking souterrain. Mauvais souvenir. La Datsun avait été remise en état dans les ateliers de Simon et s'y trouvait encore. Andrew ne doutait pas un instant qu'elle démarrerait au quart de tour, il fallait bien que la maniaquerie de son meilleur ami ait, en de rares occasions, quelques avantages.
Il emporta son dossier, des vêtements chauds, se prépara un thermos de café et se rendit à pied au garage.
*
– Bien sûr qu'elle est en état de marche, soupira Simon, où va-t-on ?
– Je vais me promener seul, cette fois.
– Ça ne me dit pas où tu te rends, répondit Simon, en faisant mauvaise figure.
– Dans le Vermont. Je peux avoir mes clés ?
– Tu vas rencontrer de la neige et, avec ta Datsun, tu te ficheras dans le décor au premier virage, encore plus si tu roules de nuit, dit Simon en ouvrant le tiroir de son bureau. Je vais te confier une Chevy station wagon 1954, cent dix chevaux sous le capot développés par son six cylindres. Je te conseille de me la rendre en parfait état, elle a été entièrement restaurée par nos soins et uniquement avec des pièces d'origine.
– Je n'aurais pas imaginé le contraire.
– C'était ironique ?
– Simon, il faut que j'y aille.
– Tu rentres quand ?
– Par moments, je me demande si tu n'es pas la réincarnation de ma mère.
– Ton humour ne me fait pas rire du tout. Appelle-moi pour me dire que tu es bien arrivé.
Andrew promit et s'installa à bord. Les sièges sentaient la vieille moleskine, mais le volant et le tableau de bord en bakélite avaient belle allure.
– J'en prendrai soin comme si c'était la mienne, jura Andrew.
– Prends-en plutôt soin comme si c'était la mienne, rétorqua Simon.
Andrew quitta New York par le nord. La banlieue s'effaça rapidement, avec son anarchie de tours d'habitation, de zones industrielles, d'entrepôts et de dépôts de carburant. Lui succédèrent de petites villes qui devinrent des villages à la tombée du jour.
Le rythme de l'humanité se calmait peu à peu. Les maisons firent place à des champs, et seules les lumières aux fenêtres de quelques fermes rappelaient qu'ici vivaient des hommes.
Turnbridge n'était rien d'autre qu'une portion de route éclairée par cinq réverbères flanqués à dix mètres les uns des autres. Cinq lampadaires occis par la rouille qui éclairaient piteusement une épicerie, une quincaillerie et une station-service, seule encore ouverte. Andrew se rangea le long de l'unique pompe à essence ; les roues de la Chevy, en passant sur un câble, firent tinter une sonnerie. Un homme presque aussi vieux que son garage en sortit. Andrew descendit de la voiture.
– Vous pouvez me faire le plein ? demanda-t-il au garagiste.
– Des comme celle-là, je n'en ai pas vu depuis longtemps, répondit celui-ci en sifflant entre les rares chicots plantés dans ses mâchoires. Le carburateur est modifié ? On a plus que du sans-plomb ici.
– Je suppose, répliqua Andrew. C'est grave sinon ?
– Grave, non, mais si vous voulez poursuivre votre route, il vaudrait mieux le savoir. Ouvrez-moi le capot, je vais déjà vérifier vos niveaux.
– Ne vous donnez pas cette peine, elle sort de révision.
– Elle a fait combien de miles depuis ?
– Environ trois cents.
– Alors ouvrez-moi ce capot, ces vieilles dames sont gourmandes d'huile, et puis, ce n'est pas comme si j'étais débordé. La dernière personne que j'ai servie est passée hier matin.
– Pourquoi rester ouvert si tard ? questionna Andrew en se frictionnant les épaules pendant que le garagiste remplissait le réservoir de la Chevy.
– La chaise là-bas, derrière la vitre, ça fait cinquante ans que je m'y assieds, c'est le seul endroit où j'aime poser mes fesses. Cette station-service, je la tiens depuis que mon père y est mort, en 1960. C'est lui qui l'avait construite. Quand j'étais gosse, on servait de la Gulf, mais la marque a disparu avant nous. Ma chambre est à l'étage. Je suis insomniaque, alors je reste ouvert jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Que voulez-vous que je fasse d'autre ? Et puis, on ne sait jamais, si un type comme vous venait s'égarer par ici, ce serait dommage de rater un client. Vous allez jusqu'où ?
– Je suis arrivé à destination. Vous connaissez un certain Ben Morton ?
– J'aurais préféré vous dire le contraire, mais oui, je le connais.
– Vous savez où il vit ?
– Vous avez passé une bonne journée ?
– Oui, pourquoi ?
– Eh bien, faites demi-tour, sinon vous allez vous la foutre en l'air.
– J'ai roulé depuis New York pour le rencontrer.
– Vous arriveriez de Miami que je vous dirais pareil. Morton est un vieux con qu'il vaut mieux éviter.
– J'en ai fréquenté beaucoup, je suis rodé.
– Pas des comme lui ! s'exclama le garagiste en remettant le pistolet de la pompe dans son logement. Voilà, ça fait quatre-vingts dollars, tout rond, les centimes sont pour la maison.
Andrew donna cinq coupures de vingt dollars au vieil homme. Le garagiste recompta les billets et sourit.
– Le pourboire d'usage, c'est deux dollars. Dix-huit de plus pour obtenir l'adresse de ce vieux schnock, ce serait de l'escroquerie ; j'ai assez de cambouis sur les mains, pas la peine de me graisser la patte. Je vais vous chercher votre monnaie. Vous n'avez qu'à me suivre, j'ai du café au chaud à l'intérieur.
Andrew entra dans la station-service.
– Qu'est-ce que vous lui voulez, à cet abruti ? demanda le garagiste en tendant une tasse à Andrew.
– Qu'est-ce qu'il vous a fait, pour que vous l'appréciiez autant ?
– Citez-moi le nom d'une personne qui s'entende avec cet ours et je vous offre votre plein d'essence.
– À ce point-là ?
– Il vit en ermite dans son cabanon. Monsieur se fait livrer son ravitaillement à l'entrée de son chemin, interdit d'aller jusqu'à sa bicoque. Même ma station essence est trop loin pour Sa Seigneurie.
Le café du garagiste avait la couleur et l'amertume du réglisse, mais Andrew avait froid et il le but sans rechigner.
– Vous comptez aller le déranger cette nuit ? Ça me ferait bien marrer qu'il vous ouvre sa porte.
– À combien de miles se trouve le plus proche motel ?
– À plus de cinquante et il est fermé en cette saison. Je vous aurais bien offert un toit pour la nuit, mais la remise n'est pas chauffée. Le cabanon de Morton est au sud, vous l'avez dépassé. Retournez sur vos pas ; après Russel Road, vous verrez une piste en terre sur votre droite, il habite au bout, vous ne pouvez pas le louper.
Andrew remercia le garagiste et s'avança vers la porte.
– Pour votre moteur, allez-y doucement. S'il chauffe un peu trop avec le carburant que je vous ai mis, vous risquez d'endommager les soupapes.
Le Chevy reprit la route, pleins phares dans la nuit noire avant de s'engager sur un chemin rocailleux.
Les deux fenêtres qui encadraient la porte du cabanon en rondins de bois étaient encore éclairées. Andrew coupa son moteur et alla frapper.
Andrew eut du mal à reconnaître le reporter qu'il avait admiré dans les traits du vieil homme qui venait de lui ouvrir et qui le regardait calmement.
– Fichez-moi le camp, dit celui-ci à travers sa barbe épaisse.
– Monsieur Morton, j'ai parcouru une longue route pour venir vous rencontrer.
– Eh bien reprenez-la en sens inverse, elle vous paraîtra moins longue maintenant que vous la connaissez.
– J'ai besoin de vous parler.
– Pas moi, déguerpissez, je n'ai besoin de rien.
– Votre article sur l'affaire Walker.
– Quelle affaire Walker ?
– 1966, la femme d'un sénateur accusée de trahison.
– Vous aimez les nouvelles fraîches, vous. Qu'est-ce qu'il a mon article ?
– Je suis journaliste au New York Times, comme vous. Nous nous sommes croisés plusieurs fois, il y a longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vous parler.
– J'ai pris ma retraite depuis longtemps, on ne vous l'a pas dit ? Vous êtes du genre à faire des recherches approfondies à ce que je vois.
– Je vous ai trouvé, n'est-ce pas ? Vous ne figurez pas vraiment dans l'annuaire.
Ben Morton observa Andrew un long moment avant de lui faire signe d'entrer.
– Approchez-vous de la cheminée, vous avez les lèvres bleues. On est loin de la ville, ici.
Andrew se frictionna les mains devant l'âtre. Morton ouvrit une bouteille de merlot et en servit deux verres.
– Tenez, dit-il à Andrew, c'est plus efficace qu'un feu de bois. Montrez-moi votre carte de presse.
– La confiance règne, dit Andrew en ouvrant son portefeuille.
– Il n'y a que les couillons qui sont confiants. Et dans votre métier, si vous l'êtes, c'est que vous êtes mauvais. Vous vous réchauffez cinq minutes et vous repartez, c'est clair ?
– Je viens de lire une bonne centaine d'articles sur l'affaire Walker, vous êtes le seul à avoir émis une réserve sur la culpabilité de Liliane Walker. Esquissée sous la forme d'une question, mais c'était tout de même une réserve.
– Et alors ? C'est du passé tout ça.
– La presse s'est totalement désintéressée du sujet à compter du 20 janvier, sauf vous, qui avez publié votre papier le 21.
– J'étais jeune et effronté, sourit Morton en buvant son verre de vin d'un trait.
– Donc, vous vous en souvenez.
– Je suis vieux, pas sénile ! En quoi cette vieille histoire vous intéresse-t-elle ?
– Je me suis toujours méfié du cor qui sonne la curée.
– Moi aussi, répondit Morton, c'est pour cette raison que j'ai écrit cet article. Enfin, écrit est un grand mot. Nous avions reçu l'ordre de ne plus publier une ligne sur le sénateur Walker et sa femme. Il faut vous mettre dans le contexte de l'époque. La liberté de la presse s'arrêtait là où le pouvoir politique traçait une ligne à ne pas franchir. Je me suis arrangé pour l'outrepasser.
– Comment ?
– Une vieille astuce que nous connaissions tous. On faisait valider notre papier en comité de rédaction, et pour qu'il soit publié tel qu'on le voulait, il suffisait de rester tard au journal. À l'heure où les types de la compo montaient le journal, on allait les voir avec les lignes à corriger d'urgence. À cette heure-là, il n'y avait plus personne pour fliquer notre travail. La plupart du temps, ça passait inaperçu, parfois pas. Mais les gens qui ont le pouvoir sont incapables d'admettre que vous les avez bernés. Ça chatouille leur ego. Je me suis fait piquer sur ce coup-là, mais le lendemain, personne n'a pipé mot au journal. Le comité de direction m'a fait payer mon insubordination dans les mois qui suivirent.
– Vous ne croyiez pas à la culpabilité de la femme de Walker ?
– Ce que je croyais ou pas n'avait aucune importance. Ce que je savais, c'est que ni moi ni aucun de mes collègues n'avions eu accès aux preuves accablantes dont on nous parlait. Et ce qui me dérangeait, c'est que personne ne s'en souciait. Le temps du maccarthysme était révolu depuis douze ans, et cette affaire en avait pourtant des relents. Vos cinq minutes sont passées, je n'ai pas besoin de vous montrer la porte ?
– Je ne suis pas en état de reprendre la route, vous n'auriez pas une chambre d'ami ?
– Je n'ai pas d'ami. Il y a un motel au nord du village.
– Le garagiste m'a dit que le plus proche se trouvait à cinquante miles d'ici et qu'il était fermé en hiver.
– Il ment comme un arracheur de dents, c'est lui qui vous a indiqué le chemin de ma maison ?

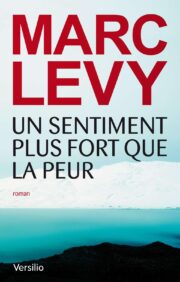
"Un sentiment plus fort que la peur" отзывы
Отзывы читателей о книге "Un sentiment plus fort que la peur". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Un sentiment plus fort que la peur" друзьям в соцсетях.