Mina marmotta quelque chose sur les goûts de la dame pour les esclaves noirs, ce qui eut le don d’amuser Aldo :
– Voilà que vous donnez dans les cancans, Mina ? J’aimerais avoir le temps de discuter avec vous des préférences de notre amie mais mon train est dans trois heures et j’ai encore pas mal à faire...
Ayant dit, il s’en alla rejoindre Zaccaria déjà occupé à préparer sa valise en se demandant quel temps il pouvait bien faire à Varsovie en avril. Il était persuadé, sans trop savoir pourquoi, qu’il se trouvait à l’orée d’une aventure passionnante.
Il redescendait pour préparer les émaux du comte Bathory et mettre ordre à quelques papiers quand la voix de Mina alternant avec une autre parvint jusqu’à lui. De toute évidence, sa secrétaire était en train de jouer l’un de ses rôles préférés : celui de chien de garde.
– Il est impossible, milady, que le prince vous reçoive à cette heure. Il s’apprête à partir en voyage et n’a que peu de temps mais si je peux vous être de quelque utilité...
– Non. C’est lui que je veux voir et c’est extrêmement important. Dites-lui, je vous prie, que j’en ai seulement pour quelques minutes !...
Doué d’une oreille sensible, Aldo reconnut aussitôt ce timbre doux et chantant : la belle lady Saint Albans qu’il avait trouvée dans le sillage de la Casati ! Intrigué, car il se demandait ce qu’elle pouvait bien lui vouloir, il commença par consulter sa montre, décida qu’il pouvait distraire un petit quart d’heure et alla rejoindre les deux femmes...
– Merci, Mina, de votre dévouement, mais je vais pouvoir accorder une entrevue à madame. Oh, très brève !... Voulez-vous me suivre dans mon cabinet, lady Saint Albans ?
Elle acquiesça d’une inclinaison de la tête et Morosini pensa qu’elle possédait décidément beaucoup de grâce.
– Eh bien ? fit-il après lui avoir offert un siège, quelle est cette affaire qui ne souffre aucun retard ? Ne pouvions-nous en parler tout à l’heure ?
– En aucun cas ! fit-elle catégorique. Je n’ai pas coutume de discuter sur une place publique de ce qui me tient à cœur...
– Je le conçois volontiers. Alors confiez-moi ce qui vous tient à cœur.
– Le bracelet de Mumtaz Mahal ! Je suis certaine que mon oncle vous l’a apporté tout à l’heure et je suis venue vous prier de me le vendre.
Bien qu’il fût surpris, Morosini ne broncha pas.
– Puis-je demander d’abord qui est votre oncle ? C’est un peu court comme signalement.
– Lord Killrenan, voyons ! Je suis surprise qu’il faille vous le préciser. Il est bien venu vous voir, ce matin, et le but de sa visite ne pouvait être que la vente du bracelet.
Le visage soudain sévère, Aldo se leva pour indiquer qu’il n’entendait pas poursuivre le dialogue.
– Sir Andrew était un grand ami de ma mère, lady Mary. Il veut bien me continuer cette amitié et jamais il n’a fait escale à Venise sans venir passer un moment chez nous. Comment sa nièce peut-elle ignorer ce détail ?
– Je ne suis sa parente que par alliance et je ne suis mariée que depuis un an. Je dois ajouter qu’il ne m’aime guère mais comme il n’aime personne, je n’ai pas à m’en offusquer...
– Sait-il votre présence à Venise ?
– Je me serais bien gardée de la lui révéler mais, ayant appris qu’il ferait escale ici avant de reprendre la route des Indes, je l’ai suivi, ajouta-t-elle avec un demi-sourire en levant ses beaux yeux gris sur son interlocuteur. Quant au bracelet...
– Je n’ai aucun bracelet, coupa Morosini, choisissant de s’en tenir aux ordres de son vieil ami : le joyau ne devait être vendu, à aucun prix, à l’un de ses compatriotes et Mary Saint Albans était anglaise. Sir Andrew est venu me dire adieu avant le grand voyage qu’il entreprend et dont il ignore quand il prendra fin.
– C’est impossible ! s’écria la jeune femme en se levant à son tour. J’ai la certitude qu’il emportait le bracelet avec lui et je jurerais qu’il vous l’a confié ! Oh, prince, je vous en prie : je donnerais tout ce que je possède pour ce bijou...
Elle était de plus en plus jolie et même assez touchante mais Aldo refusa de se laisser attendrir...
– Je vous l’ai dit, je sais seulement, de cet objet, que lors de sa dernière visite, il y a plus de quatre ans, sir Andrew avait voulu l’offrir à ma mère dont il était épris depuis de longues années mais elle l’a refusé. Ce qu’il a pu en faire depuis...
– Il l’a toujours, j’en suis certaine, et maintenant il est parti !...
Elle semblait vraiment désespérée, tordant ses mains dans un geste convulsif tandis que les larmes montaient à ses prunelles transparentes. Aldo ne savait que faire d’elle quand, soudain, elle vint vers lui presque à le toucher. Il put sentir son parfum, voir de tout près ses beaux yeux implorants :
– Dites-moi la vérité, je vous en conjure ! Vous êtes bien certain... qu’il ne vous l’a pas remis ?
Il faillit se fâcher, choisit de se mettre à rire :
– Mais quelle obstination ! Ce bijou doit être exceptionnel pour que vous souhaitiez vous l’approprier !
– Il l’est ! C’est une pure merveille.... mais il vous l’a au moins montré ?
– Mon Dieu, non ! fit Morosini avec désinvolture. Il se doutait bien que j’aurais le même désir que vous de l’acquérir. Savez-vous ce que je pense ?
– Vous avez une idée ?
– Oui... et qui lui ressemblerait assez : n’ayant pu offrir le joyau à celle qu’il aimait, il va le rapporter aux Indes. Voilà qui expliquerait bien ce nouveau voyage. Il va le rendre à Mumtaz Mahal... Autrement dit, le vendre à quelqu’un de là-bas.
– C’est vrai, soupira-t-elle. Ce serait assez dans sa manière. Dans ce cas, il me faut prendre d’autres dispositions...
– Songeriez-vous à lui courir après ?
– Pourquoi pas ? Pour se rendre aux Indes, il faut passer le canal de Suez et tous les navires font escale à Port-Saïd.
« Ma parole, elle est capable de se précipiter sur le premier bateau en partance, pensa Morosini. Il est temps de calmer le jeu ! »
– Soyez un peu raisonnable, lady Mary. Même si vous rejoignez sir Andrew en Egypte, vous n’aurez guère plus de chance d’obtenir de lui ce que vous voulez. À moins que vous ne lui ayez pas dit que vous souhaitiez posséder ce bijou ?
– Oh si, je lui ai dit ! Il m’a répondu qu’il n’était ni à vendre ni à donner et qu’il entendait le garder pour lui !
– Vous voyez bien !... Croyez-vous qu’il se montrera plus compréhensif à l’ombre d’un palmier qu’au bord de la Tamise ? Il faut vous résigner en songeant qu’il est bien d’autres joyaux au monde qu’une jeune femme riche peut s’offrir. À la limite, pourquoi ne pas le faire copier, à l’aide d’un dessin, par un joaillier ?
– Une copie n’aurait aucun intérêt ! C’est le vrai que je désire... parce qu’il était un présent d’amour...
Aldo commençait à trouver que l’entretien s’éternisait quand Mina, qui devait en penser tout autant, frappa discrètement et apparut :
– Veuillez me pardonner, prince, mais je vous rappelle que vous avez un train à prendre et que...
– Seigneur, Mina, j’allais l’oublier ! Merci de me le rappeler. Lady Saint Albans, ajouta-t-il en se tournant vers la jeune femme, je suis obligé de prendre congé de vous, mais s’il m’arrivait d’avoir des nouvelles, je ne manquerais pas de vous les communiquer si vous voulez bien me donner une adresse...
– Ce serait aimable à vous !...
Elle semblait rassérénée, tira de son sac une petite carte qu’elle lui remit et, après quelques formules de politesse banales, quitta enfin le cabinet d’Aldo escortée par Mina.
Sa visiteuse partie, le prince réfléchit un instant. Quel dommage que cette vieille mule de Killrenan n’ait pas accepté de faire plaisir à sa jolie nièce ! Au fond, la destination normale d’un beau bijou se trouve sur la personne d’une femme ravissante beaucoup plus que dans le coffre-fort d’un collectionneur. Et comme il avait bon cœur, il rédigea un court message destiné à sir Andrew, lui demandant à mots couverts s’il ne révisait pas sa façon de penser en faveur de sa nièce. Mina s’arrangerait pour le faire parvenir à bord du Robert-Bruce lorsqu’il ferait escale à Port-Saïd. De toute façon, Aldo n’était nullement pressé de vendre ce petit trésor qu’il s’accorda le loisir d’aller contempler une dernière fois avant de monter se mettre en tenue de voyage et de rejoindre Zian dans le canot que le jeune homme maniait aussi bien que la gondole.
Un moment plus tard, il roulait vers la France.
CHAPITRE 2 LE RENDEZ-VOUS
Le temps était affreux. Une pluie fine et glacée faite de neige fondue se déversait d’un ciel bouché quand Aldo Morosini sortit de la gare de Varsovie. Un fiacre grêle le conduisit par la bruyante Marzalskowska zébrée de réclames lumineuses jusqu’à l’hôtel de l’Europe, l’un des trois ou quatre palaces locaux. Sa chambre y était retenue et on lui octroya, avec tous les signes de la plus exquise politesse, une immense pièce à l’ameublement pompeux flanquée d’une salle de bains tout aussi majestueuse mais dont le chauffage, plus discret que le décor, lui fit regretter l’étroit sleeping habillé d’acajou et de moquette qu’il avait occupé dans le Nord-Express. Varsovie n’avait pas encore retrouvé l’élégance raffinée et le confort qui lui étaient propres avant la guerre.
Bien qu’il mourût de faim, Morosini ne descendit pas à la salle à manger. La Pologne étant un pays où l’on déjeunait entre deux et quatre heures et où le repas du soir n’était jamais servi avant neuf heures, il pensa qu’il avait juste le temps de se rendre auprès d’Aronov et se contenta de se faire monter de la « woudka » accompagnée de quelques zakouskis au poisson fumé.
Réchauffé et réconforté par ce petit repas, il endossa une pelisse, se coiffa de la toque fourrée qu’il devait à la prévoyance de Zaccaria et quitta l’hôtel de l’Europe après s’être fait indiquer le chemin à suivre qui n’était pas très long. La pluie avait cessé et Morosini n’aimait rien tant que marcher dans une ville inconnue. C’était, selon lui, la meilleure façon de prendre contact.
Par la Krakowkie Przedmiescie, il gagna la place Zamkowy dont le tracé peu harmonieux était écrasé par la masse imposante du Zamek, le château royal aux tourelles verdies. Il se contenta de lui jeter un coup d’œil intéressé en se promettant de revenir le visiter puis s’engagea dans une rue muette et mal éclairée qui le mena droit au Rynek, la grande place où, de tout temps, battait le cœur de Varsovie. C’était là qu’avant 1764 les rois de Pologne, en costume de couronnement, recevaient les clefs d’or de la ville et nommaient ensuite les chevaliers de leur Milice Dorée.
La place où se tenait toujours le marché était noble et belle. Ses hautes maisons Renaissance, aux volets bardés de fer, conservaient avec beaucoup de grâce, sous les longs toits obliques, un peu de leurs passés successifs. Certaines de ces demeures patriciennes étaient jadis peintes et en gardaient des traces.
La taverne Fukier, lieu du rendez-vous, occupait l’une des plus intéressantes de ces maisons, mais l’entrée, dépourvue d’enseigne, étant obscure, Morosini dut se renseigner avant de s’apercevoir qu’elle se situait au n° 27. Cette bâtisse était non seulement vénérable mais célèbre. Les Fugger, puissants banquiers d’Augsbourg rivaux des Médicis, qui avaient empli l’Europe de leur richesse et prêté de l’argent à nombre de souverains en commençant par l’Empereur, s’y étaient installés au XVIc siècle pour y faire le commerce des vins, et leurs descendants, après avoir polonisé leur nom en Fukier, y exerçaient toujours le même négoce. Leurs profondes caves, réparties sur trois étages, étaient peut-être les meilleures du pays mais aussi un lieu historique : en 1830 et 1863, elles servaient aux réunions secrètes des insurgés.
Tout cela, Aldo le savait depuis peu et ce fut avec un certain respect qu’il pénétra dans le vestibule à la voûte duquel pendait un modèle de frégate. Sur l’un des murs, une tête de cerf louchait un peu vers un ange noir qui portait une croix, assis sur une colonne. Au-delà, il se trouva dans la salle réservée aux dégustateurs. Elle était meublée de ce chêne massif qui, avec le temps, prend une si belle couleur sombre et brillante. Des gravures anciennes ornaient les boiseries.
Si l’on ne tenait pas compte de son décor, la taverne était semblable à bien d’autres salles de café. Des hommes attablés buvaient des vins de provenances diverses tout en causant et en fumant. Après l’avoir parcourue du regard, Morosini alla s’asseoir à une table et commanda une bouteille de tokay. On la lui apporta toute poudreuse avec son étiquette mentionnant l’ancienne formule remontant aux Fugger : Hungariœ natum, Poloniœ educatum[vi].

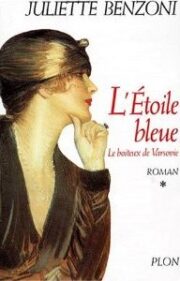
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.