– Je vous sais un gré infini d’avoir bien voulu venir jusqu’ici, prince Morosini, et j’espère que vous me pardonnerez les désagréments qu’ont pu vous causer le voyage par ce mauvais temps et aussi les multiples précautions que je me vois obligé de prendre. Puis-je vous offrir quelque chose pour vous réconforter ?
– Merci.
– Un peu de café peut-être ? J’en bois à longueur de journée.
Comme si le mot lui-même l’avait suscité, le serviteur reparut, portant un plateau chargé d’une cafetière et de deux tasses. Il posa le tout auprès de son maître et disparut sur un signe de sa main. Le boiteux emplit une tasse et la divine odeur alla chatouiller de façon encourageante les narines d’Aldo qui venait de prendre place dans une rare chaire gothique tendue de cuir.
– Quelques gouttes peut-être, accepta-t-il, mais le ton prudent de sa voix n’échappa pas à son hôte qui se mit à rire.
– Bien que vous soyez italien donc difficile en cette matière, je crois que vous pouvez goûter ce moka sans risquer de tomber en syncope.
Il avait raison : son café était bon. Ils le burent en silence mais Aronov reposa sa tasse le premier.
– Je suppose, prince, que vous avez hâte d’apprendre la raison de mon télégramme et de votre présence ici ?
– Vous rencontrer représente déjà une suffisante satisfaction. J’avoue qu’il m’est arrivé de me demander si vous n’étiez pas un mythe, si vous existiez vraiment. Je ne suis pas seul dans ce cas, d’ailleurs. Nombreux sont ceux de mes confrères qui donneraient cher pour vous voir de près.
– Cette satisfaction ne leur sera pas donnée de sitôt ! Ne croyez cependant pas qu’en agissant ainsi je me laisse aller à un goût déplacé pour le mystère à bon marché ou la publicité de mauvais aloi. Il s’agit pour moi d’une simple question de survie. Je suis un homme qui doit rester caché s’il veut avoir une chance de mener à bien la tâche qui lui incombe.
– Pourquoi, alors, lever pour moi le secret ?
– Parce que j’ai besoin de vous.... et de personne d’autre !
Aronov se leva et, de son pas inégal, alla jusqu’à la muraille où se creusait l’enfeu. C’était l’un des lieux seuls endroits de la vaste salle où les livres laissaient une place libre : l’autre était occupé par le portrait, ravissant, d’une petite fille aux yeux graves, en collerette de dentelle, peint, jadis, par Cornelis de Vos dont Aldo identifia aussitôt la facture. Mais pour l’instant, son attention s’attachait aux mains du boiteux qui enfonçaient une pierre. Il y eut un déclic et le couvercle de l’énorme coffre se souleva. Aronov y prit un grand écrin de cuir antique décoloré à force d’usure, qu’il tendit à son visiteur : – Ouvrez ! dit-il.
Morosini s’exécuta et resta médusé devant ce qu’il découvrait sur un lit de velours noir verdi par le temps : une grande plaque d’or massif, un rectangle long d’une trentaine de centimètres sur lequel douze rosaces d’or étaient disposées sur quatre rangs, enchâssant de gros cabochons de pierres précieuses toutes différentes pour celles qui existaient encore : quatre rosaces, en effet, étaient vides. Il y avait là une sardoine, une topaze, une escarboucle, une agate, une améthyste, un béryl, une malachite et une turquoise : huit pierres parfaitement appareillées d’une grosseur égale et d’un poli admirable. La seule différence tenait à ce que certaines étaient plus précieuses que les autres. Enfin, une épaisse chaîne d’or attachée à deux coins de ce bijou barbare devait permettre de le passer au cou.
L’étrange ornement était sûrement très ancien et le temps ne l’avait pas épargné : l’or se bosselait par endroits. En le soupesant, Morosini se sentait habité par une foule de points d’interrogation : il était certain de n’avoir jamais vu cet objet et pourtant il lui semblait familier. La voix basse de son hôte vint mettre fin à ses efforts de mémoire :
– Savez-vous ce que c’est ?
– Non. On dirait... une sorte de pectoral... Le mot apporta la lumière. À l’instant où il le prononçait, son esprit évoqua un tableau de Titien, une grande toile qui se trouvait à l’Accademia de Venise où le peintre avait retracé la Présentation de la Vierge au Temple. Avec netteté, il revit le grand vieillard vêtu de vert et d’or, un croissant d’or à son bonnet, qui accueillait l’enfant prédestinée. Il revit les mains bénisseuses, la barbe de neige dont les deux pointes caressaient un joyau exactement semblable.
– Le pectoral du Grand Prêtre ? souffla-t-il suffoqué. Il existait donc ? Je croyais à une imagination du peintre ?
– Il a toujours existé, même après avoir échappé par miracle à la destruction du temple de Jérusalem. Les soldats de Titus n’ont pas réussi à se l’approprier... Cependant, je ne vous cacherai pas que vous me surprenez. Pour avoir identifié si vite notre relique, il faut que vous possédiez une vaste culture.
– Non. Je suis un Vénitien qui aime sa ville et en connaît à peu près tous les trésors, et parmi eux ceux de l’Accademia. Ce qui me confond, c’est que Tiziano ait représenté le pectoral avec cette fidélité. L’aurait-il vu ?
– J’en suis certain : le joyau devait se trouver alors dans le ghetto de Venise où le maître prenait volontiers ses modèles. Il se pourrait même que le Grand Prêtre de sa toile ne soit autre que Juda Leon Abrabanel, ce Léon l’Hébreu qui a compté parmi les sommités intellectuelles de son temps et qui fut peut-être l’un des gardiens. Cependant, le pinceau magique n’a pu qu’imaginer les pierres absentes : les plus précieuses bien, entendu.
– Quand ont-elles disparu ?
– Pendant le pillage du Temple. Un lévite a réussi à sauver le pectoral, malheureusement il a été tué par un compagnon, celui qui l’avait aidé. L’homme a emporté le joyau mais, craignant peut-être de subir la malédiction qui s’attache toujours au sacrilège, il n’a pas osé le garder. Cela ne l’a pas empêché de dessertir les pierres les plus rares : le saphir, le diamant, l’opale et le rubis avec lesquels il a réussi à s’embarquer pour Rome où sa trace s’est perdue. Le pectoral, enfoui sous des détritus, a été sauvé par une femme qui est parvenue à gagner l’Egypte.
Fasciné par l’étonnante plaque d’or où ses longs doigts erraient d’un cabochon à l’autre, Morosini, bercé par la voix d’Aronov, subissait à la fois la fascination des gemmes et celle d’une histoire comme il les aimait.
– D’où viennent-t-elles ? demanda-t-il. La terre de Palestine ne produit guère de pierreries. Les réunir a dû être difficile.
– Les caravanes de la reine de Saba les ont apportées de très loin pour le roi Salomon. Mais voulez-vous que nous revenions à la raison de votre voyage ?
– Je vous en prie.
– C’est assez simple ; j’aimerais, si nous tombons d’accord, que vous retrouviez pour moi les pierres manquantes.
– Que je... Vous plaisantez ?
– Pas le moins du monde.
– Des cailloux disparus depuis la nuit des temps ? Ce n’est pas sérieux !
– On ne peut plus sérieux au contraire et les pierres n’ont pas disparu tout à fait. Elles ont laissé des traces, sanglantes malheureusement, mais le sang s’efface difficilement. J’ajoute que leur possession ne porte pas bonheur comme il arrive pour les objets sacrés volés. Et pourtant il me les faut.
– Avez-vous à ce point le goût du malheur ?
– Peu d’hommes le connaissent aussi bien que moi. Savez-vous ce qu’est un pogrom, prince ? Moi je le sais pour avoir vécu celui de Nijni-Novgorod en 1882. On y a enfoncé des clous dans la tête de mon père, crevé les yeux de ma mère et jeté mon jeune frère et moi par une fenêtre. Lui a été tué sur le coup. Pas moi, et j’ai pu m’enfuir, mais cette jambe et cette canne m’en gardent le souvenir bien vivant, ajouta-t-il en tapotant l’une du bout de l’autre. Vous voyez, je sais ce qu’est le malheur et c’est pourquoi je voudrais tenter de l’écarter enfin de mon peuple. C’est pourquoi aussi il me faut rendre au pectoral son intégrité...
– Comment ce joyau pourrait-il vaincre une malédiction vieille de dix-neuf siècles ?
Le mot était maladroit et Morosini s’en aperçut en voyant un pli de dédain marquer les lèvres de son hôte mais il n’essaya pas de le corriger, estimant que ce n’était pas à lui de refaire l’histoire. Aronov d’ailleurs ne le releva pas et continua :
– Une tradition assure qu’Israël retrouvera sa souveraineté et sa terre ancestrale quand le pectoral du Grand Prêtre où s’enchâssent les pierres symboliques des Douze Tribus regagnera Jérusalem. Ne souriez pas ! J’ai dit tradition. Pas légende !
– Je ne souris pas sinon à la beauté de l’histoire. Je vois mal cependant comment ce rêve pourrait se réaliser.
– En rentrant chez nous en masse afin d’obliger le monde à reconnaître un jour un État juif.
– Et vous croyez cela possible ?
– Pourquoi pas ? Nous avons déjà commencé. En 1862, un groupe de Juifs roumains s’est installé en Galilée, à Roscha Pina et en Samarie. L’année suivante ce sont des Polonais qui ont créé à Yesod Hamale, près du lac Huleh, une colonie agricole, un « kibboutz ». Enfin des Russes se sont établis aux environs de Jaffa et d’ici, en ce moment, partent quelques jeunes hommes qui vont là-bas pour se faire pionniers. C’est bien peu, je l’admets, et, en outre, la terre est rude, inculte depuis trop longtemps. Il faut creuser des puits, amener de l’eau et la plupart de ces émigrants sont des intellectuels. Enfin, il y a les bédouins qui obligent au combat...
– Et vous pensez qu’il en irait autrement si cet objet rentrait chez lui ?
– Oui, à condition qu’il soit au complet. Voyez-vous, il symbolise les Douze Tribus, l’unité d’Israël, et l’utilité des symboles vient de ce qu’ils soulèvent l’enthousiasme et confortent la foi. Or quatre pierres manquent, donc quatre tribus et non des moindres.
– En ce cas, pourquoi ne pas essayer de les remplacer ? J’admets que leur importance rend peut-être la chose difficile mais...
– Non. On ne triche pas avec les traditions et les croyances d’un peuple ! Il faut retrouver les pierres d’origine. À tout prix !
– Et c’est sur moi que vous comptez pour cette mission impossible ? Je ne vous comprends pas, puisque je n’ai rien de commun avec Israël. Je suis italien, chrétien...
– Pourtant c’est vous et vous seul que je veux. Pour deux raisons : la première est que vous possédez l’une des pierres, peut-être la plus sacrée de toutes. La seconde parce qu’il a été prédit, voici longtemps déjà, que seul le dernier maître du saphir aurait le pouvoir de retrouver les autres égarées. Si l’on y ajoute que votre profession est, pour moi, un sûr garant de succès...
Avec un soupir Morosini se leva. Il aimait les belles histoires mais pas les contes de fées et commençait à se sentir las :
– J’ai beaucoup de sympathie pour vous, monsieur Aronov, et pour votre cause, mais je dois refuser : je ne suis pas celui qu’il vous faut. Ou plutôt je ne le suis plus en admettant que je l’aie jamais été. Si vous voulez bien me faire reconduire...
– Pas encore ! Vos parents vous ont bien légué un superbe saphir astérié qui est, depuis plusieurs siècles, la propriété des ducs de Montlaure ?
– Qui était, et c’est là où vous faites erreur. De toute façon, il ne pouvait s’agir du vôtre : celui-là était une pierre wisigothe provenant du trésor du roi Receswinthe...
– ... lequel trésor provenait de celui d’Alaric, autre Wisigoth qui, au Ve siècle eut le privilège de piller Rome durant six jours. C’est là qu’il a pris le saphir... entre autres objets ! Attendez, je vais vous montrer quelque chose !
De ce pas inégal qui lui conférait une sorte de majesté tragique, Aronov retourna au coffre. Quand il en revint, un joyau somptueux étincelait sur sa main : un grand saphir d’un bleu profond étoilé de lumière, soutenu par trois diamants en forme de fleur de lys qui formaient la bélière du pendentif. À peine y eut-il jeté les yeux que Morosini explosait :
– Mais... c’est le bijou de ma mère ? Comment est-il ici ?
– Réfléchissez ! Si c’était lui je ne vous demanderais pas de me le vendre. C’est seulement une copie... mais fidèle au moindre détail. Voyez plutôt !
D’une main, il retournait le saphir et, de l’autre, tendait une forte loupe. Puis, désignant au dos de la pierre un minuscule dessin imperceptible à l’œil :
– Voici l’étoile de Salomon, et chacune des gemmes du pectoral est marquée de même. Si vous voulez bien examiner la vôtre vous découvrirez sans peine ce signe.
Il revint s’asseoir tandis qu’Aldo maniait le pendentif avec une bizarre impression : la ressemblance avait quelque chose d’hallucinant et il fallait s’y connaître pour s’apercevoir qu’il s’agissait d’un faux.

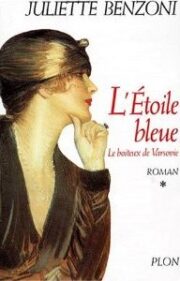
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.