Il n’était pas loin de minuit quand Morosini regagna enfin l’hôtel de l’Europe.
CHAPITRE 3 JARDINS DE WILANOW !
Quand il mit le nez à la fenêtre, le lendemain matin, Aldo eut peine à en croire ses yeux. Par la magie d’un rayonnant soleil, la ville d’hier, frileuse, mélancolique et grise, s’était muée en une capitale pleine de vie et d’animation, cadre séduisant d’un peuple jeune et ardent vivant avec passion la réunification de sa vieille terre, glorieuse, indomptable mais trop longtemps déchirée. Depuis quatre ans, la Pologne respirait l’air vivifiant de la liberté et cela se sentait. Aussi fut-elle soudain chère au visiteur indifférent de la veille. Peut-être parce que, ce matin, elle lui rappelait l’Italie. La grande place qui s’étendait entre l’hôtel de l’Europe et une caserne en pleine activité ressemblait assez à une piazza italienne. Elle était peuplée d’enfants, de cochers de fiacre et de jeunes officiers promenant leurs sabres encombrants avec la même gravité que leurs confrères de la Péninsule.
Pressé soudain de se mêler à cet aimable brouhaha et de grimper dans l’un de ces fiacres, Morosini hâta sa toilette, engloutit un petit déjeuner qui lui parut regrettablement occidental et, dédaignant la toque de fourrure de la veille, sortit dans la lumière blonde.
Tandis qu’il descendait, il avait pensé un moment aller à pied, mais il changea d’avis à nouveau : s’il voulait avoir une vue d’ensemble, le mieux était de prendre une voiture, et il indiqua au portier galonné qu’il désirait voir la ville :
– Trouvez-moi un bon cocher ! recommanda-t-il.
L’homme aux clefs s’empressa de héler un fiacre de belle apparence pourvu d’un cocher ventripotent, jovial et moustachu, qui lui offrit un sourire édenté mais radieux quand il lui demanda dans la langue de Molière de lui montrer Varsovie.
– Vous êtes français, monsieur ?
– À moitié. En réalité, je suis italien.
– C’est presque la même chose. Ça va être un plaisir de vous montrer la Rome du Nord !... Vous saviez qu’on l’appelait comme ça ?
– Je l’ai entendu dire mais je ne comprends pas. J’ai fait quelques pas hier soir et il ne m’a pas semblé qu’il y eût beaucoup de vestiges antiques.
– Vous comprendrez tout à l’heure ! Boleslas connaît la capitale comme personne !
– J’ajoute qu’il parle très bien le français.
– Tout le monde parle cette belle langue ici. La France, c’est notre seconde patrie ! En avant !
Ayant dit, Boleslas enfonça sur sa tête sa casquette de drap bleu ornée d’une sorte de couronne de marquis en métal argenté, claqua des lèvres et mit son cheval en marche. Comme tous les cochers de fiacre, il portait plusieurs chiffres en fonte accrochés à un bouton placé près de son col et qui lui pendaient sur le dos comme une étiquette. Intrigué, Morosini lui demanda la raison de ce curieux affichage !
– Un souvenir du temps où la police russe sévissait ici, grogna le cocher. C’était pour mieux nous repérer. Un autre souvenir, c’est les lanternes que vous avez dû voir le soir accrochées devant les maisons. Comme on a l’habitude, on n’a rien changé...
Et la visite commença. Au fur et à mesure qu’elle se déroulait, Morosini appréciait davantage le choix de son portier. Boleslas semblait connaître chacune des maisons devant lesquelles on passait. Surtout les palais, qui donnèrent au visiteur la clef du surnom de Varsovie : il y en avait ici autant qu’à Rome. Tout au long de la Krakowskie Przedmiescie, la grande artère de la ville, ils se côtoyaient ou se faisaient face, certains bâtis par des architectes italiens mais sans le côté massif des grandes demeures romaines. Construits souvent sur plan rectangulaire, flanqués de quatre pavillons, vestiges d’anciens bastions fortifiés, ils possédaient de vastes cours et de hauts toits couverts de cuivre verdi qui ne contribuaient pas peu au charme coloré de la ville. Boleslas montra les palais Tepper où Napoléon rencontra Maria Walewska et dansa avec elle une contredanse, Krasinsski où le futur maréchal Poniatowski fit bénir les drapeaux des nouveaux régiments polonais, Potocki où Murat donna des fêtes superbes, Soltyk où séjourna Cagliostro, Pac, ambassade de France sous Louis XV, où se cacha Stanislas Leczinski, le futur beau-père du roi, Miecznik dont la dame fut l’inspiratrice de Bernardin de Saint-Pierre. Aldo finit par protester :
– Vous êtes bien sûr de ne pas être en train de me faire visiter Paris ? fit-il. Il n’est question que de la France et des amours des Français...
– Mais parce que entre la France et nous c’est une histoire d’amour qui dure, et ne me dites pas qu’un Italien n’aime pas l’amour ? Ce serait le monde à l’envers...
– Le monde restera à l’endroit : j’y suis aussi sensible que mes compatriotes mais, pour l’instant, j’aimerais visiter le château.
– Vous avez le temps avant le déjeuner. Vous pourrez voir aussi la maison de Chopin et celle de la princesse Lubomirska, une femme charmante qui, par amour, est allée se faire exécuter en France pendant la Révolution.
– Encore l’amour ?
– Vous n’y échapperez pas. Cet après-midi, si vous me faites toujours confiance, je vous emmènerai voir sa maison : le château de Wilanow, construit par notre roi Sobieski pour son épouse... française.
– Pourquoi pas ?
À midi, le voyageur choisit de déjeuner dans la cukierna de la place du château, une pâtisserie dont la terrasse fleurie surplombait la rue. Des jeunes filles vêtues comme des infirmières lui servirent un assortiment de choses délicieuses qu’il arrosa de thé. Il avait toujours adoré les gâteaux et trouvait parfois amusant d’en faire un repas, mais Boleslas qu’il invita refusa de le suivre sur ce terrain : il préférait des nourritures plus substantielles et promit de revenir chercher son client deux heures plus tard.
Aldo fut plutôt content qu’il ait refusé son offre : le cocher était bavard et le moment d’isolement qu’il goûta dans cet endroit, mi-salon de thé, mi-café, lui parut bien agréable. Morosini s’y régala donc de mazourki, sorte de tourtes à la manière viennoise dont le fourrage semblait varier à l’infini, et de nalesniki, crêpes chaudes à la confiture, tout en admirant quelques charmants visages. C’était très agréable de ne penser à rien et d’avoir l’impression d’être en vacances !
Il la prolongea en fumant un odorant cigare tandis que le trot allègre du cheval l’emmenait au sud de la capitale. Son automédon, momentanément réduit au silence, digérait en somnolant, laissant son attelage se conduire à peu près seul sur une route habituelle. Le beau temps du matin commençait à décliner. Un peu de vent s’était levé et poussait vers l’est des nuages grisonnants qui, par instants, voilaient le soleil, mais la promenade était agréable.
Wilanow plut à Morosini. Avec ses terrasses, ses balustres et ses deux amusantes tourelles carrées dont les toits à plusieurs étages se donnaient des airs de pagode, le château baroque étalé au milieu de ses jardins ne manquait pas de charme. Il possédait ce qu’il fallait pour séduire une jolie femme coquette, ce qu’était à n’en pas douter cette Marie-Casimire de la Grange d’Arquien, de bonne noblesse nivernaise, dont l’amour, pour parler comme Boleslas, fit une reine de Pologne alors que rien ne l’y destinait à l’origine.
Aldo connaissait son histoire par sa mère dont les ancêtres cousinaient avec les ducs de Gonzague : l’une de leurs plus belles fleurs, Louise-Marie, dut, sur l’ordre de Louis XIII, s’en aller épouser le roi Ladislas IV alors qu’elle était follement éprise du beau Cinq-Mars. Elle emmenait avec elle Marie-Casimire, celle qu’elle préférait parmi ses dames d’honneur. Parvenue en Pologne, celle-ci épousa d’abord le vieux mais riche prince Zamoyski, puis, après un veuvage assez hâtif, le grand maréchal de Pologne, Jean Sobieski, à qui elle inspira une ardente passion. Lorsqu’il devint roi sous le nom de Jean III, celui-ci éleva au trône la femme qu’il aimait et fit bâtir pour elle ce palais d’été tandis qu’il s’en allait acquérir une gloire sinon universelle, du moins européenne en barrant aux Turcs, à Vienne, la route de l’Occident et en les rejetant vers leurs propres terres.
Un guide rafraîchit la mémoire du visiteur qui, en l’écoutant, s’expliquait de plus en plus mal les envolées lyriques de son cocher au sujet de cet « amour de légende ». Sobieski, certes, était légendaire mais pas Marie-Casimire, ambitieuse et intrigante, qui influença de façon désastreuse la politique de son mari, le brouilla avec Louis XIV et, après sa mort, fit tant et si bien que la Diète polonaise la renvoya dans ses foyers[vii].
L’intérieur du château se révéla plutôt décevant. Les Russes avaient emporté beaucoup de ce qu’il contenait initialement. Seuls quelques meubles – et nombre de portraits ! – rappelaient le souvenir du grand roi. L’antiquaire admira pourtant sans réserve certain ravissant cabinet florentin, don du pape Innocent IX, un miroir superbement ouvragé qui avait reflété le trop joli visage de la reine et un panneau de Van Iden provenant d’un clavecin à elle offert par l’impératrice Éléonore d’Autriche...
À mesure qu’il parcourait les pièces souvent vides, Aldo sentait une bizarre mélancolie l’envahir. Il était presque le seul visiteur et cet endroit trop silencieux finissait par lui procurer une sorte d’angoisse. Il se demanda ce qu’il était venu faire là et regretta de n’être pas resté en ville. Pensant que les jardins où revenait le soleil lui rendraient sa bonne humeur, il choisit de sortir sur la terrasse dominant un bras de la Vistule pour admirer, au bord de l’eau, les arbres géants dont on disait qu’ils avaient été plantés par Sobieski lui-même. C’est alors qu’il vit la jeune fille...
Peut-être n’avait-elle pas vingt ans mais elle était d’une surprenante beauté : grande et presque frêle avec des cheveux d’un blond d’or pur, des yeux clairs et une bouche ravissante, elle portait avec une élégance parfaite un manteau de drap bleu ourlé de renard blanc avec une toque assortie qui lui donnait l’apparence d’une héroïne d’Andersen. Elle semblait en proie à une vive émotion et parlait avec animation à un jeune homme brun, romantique et décoiffé, qui n’avait pas l’air plus heureux qu’elle mais dont Aldo n’avait même pas remarqué la présence tant il était occupé à regarder l’inconnue.
Pour ce qu’il pouvait diagnostiquer de l’attitude des deux personnages, il s’agissait d’une scène de rupture ou quelque chose d’approchant. La jeune fille semblait prier, supplier. Il y avait des larmes dans ses yeux ; dans ceux du garçon aussi mais bien qu’ils parlassent assez fort, Morosini ne comprenait pas un mot de ce qu’ils se disaient. Tout ce qu’il réussit à saisir fut le nom des protagonistes. La belle enfant s’appelait Anielka et son compagnon Ladislas.
Retranché, par discrétion, derrière un if taillé, il suivit avec intérêt le dialogue passionné. Anielka implorait de plus belle un Ladislas drapé plus fermement que jamais dans sa dignité. Peut-être l’histoire classique entre la demoiselle riche et le garçon pauvre mais fier qui veut bien partager sa misère mais pas la fortune de la bien-aimée ? Dans ses habits noirs et flottants, Ladislas ressemblait assez à un nihiliste ou à un étudiant illuminé et le spectateur caché ne comprenait guère pourquoi cette ravissante enfant semblait y tenir à ce point : il était certainement incapable de lui offrir un avenir digne d’elle, ou même un avenir tout court. Et il n’était même pas tellement beau !
Soudain, le drame atteignit son point d’orgue. Ladislas saisit Anielka dans ses bras pour lui donner un baiser trop passionné pour n’être pas le dernier puis, s’arrachant à elle en dépit d’une tentative désespérée pour le retenir, il s’enfuit à toutes jambes, laissant voler dans le vent frais son manteau trop long et son écharpe grise.
Anielka n’essaya pas de le suivre. S’accoudant sur la balustrade, elle se courba jusqu’à ce que sa tête repose sur ses bras et se mit à sangloter. De son côté, Aldo resta sans bouger à l’abri de son if, ne sachant trop que faire. Il ne se voyait pas aller offrir de banales consolations à la désespérée mais, d’autre part, il lui était impossible de s’en aller et de la laisser là, seule avec son chagrin.
Elle se redressa et demeura un moment debout, les mains posées sur la pierre, bien droite, regardant le paysage étalé à ses pieds, puis se résolut à partir. Aldo, de son côté, décida de la suivre mais, au lieu de se diriger vers l’entrée du château, elle prit l’escalier qui menait au bord de la rivière, ce qui ne laissa pas d’inquiéter Morosini, pris d’un bizarre pressentiment.
Bien que son pas à lui fût léger et silencieux, elle s’aperçut vite de sa présence et se mit à courir avec une rapidité qui le surprit. Ses pieds minces, chaussés de daim bleu, volaient sur les graviers du chemin. Elle fonçait vers le fleuve et cette fois, son dernier doute balayé, Aldo se lança à sa poursuite. Lui aussi courait bien : depuis son retour de captivité, il avait eu le temps de refaire du sport – natation, athlétisme et boxe ! – et sa forme physique était sans défaut. Ses longues jambes grignotèrent l’avance de la jeune fille mais il ne réussit, cependant, à l’atteindre qu’au bord même de la Vistule. Elle poussa un cri strident en se débattant contre lui de toutes ses forces et en proférant des paroles incompréhensibles mais qui ne semblaient pas des plus aimables. Alors il la secoua, dans l’espoir qu’elle se tairait et se tiendrait tranquille.

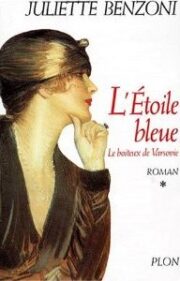
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.