– Quatre ans ? Quatre longues années ? Pardonnez-moi, mais je ne sais pas attendre. Je n’ai jamais su : ce que je veux, ce que je désire, il me le faut sur-le-champ. Or, vous avez été longtemps prisonnier. Je n’aurais pas pu le supporter.
– Qu’auriez-vous fait ? Vous m’auriez trompé ? Bien loin de chercher à dissimuler son regard, elle ouvrit tout grands ses yeux limpides qui se fixèrent sur lui d’un air songeur.
– Je n’en sais rien, dit-elle avec une franchise qui fit grimacer son vis-à-vis.
– Et vous disiez m’aimer ? fit-il avec une amertume voilée de dédain...
– Mais je vous aimais... peut-être même vous gardé-je... un sentiment ? ajouta-t-elle avec ce sourire auquel il était incapable de résister au temps de leurs amours. Seulement... la passion s’accommode mal de la vie quotidienne, surtout en temps de guerre. Même si vous ne l’avez pas cru, je devais me protéger. Le Danemark est bien proche de l’Allemagne et pour tous je restais une étrangère, presque une ennemie. Même affublée d’une couronne de comtesse vénitienne, je ne pouvais être que suspecte.
– Vous ne l’auriez pas été si vous aviez consenti à vous... « affubler » d’une couronne princière. On ne s’en prend pas à une Morosini sans risquer de s’en mordre les doigts. Auprès de ma mère vous n’aviez rien à craindre.
– Elle ne m’aimait pas. Et puis quand vous dites que je n’avais rien à craindre, vous oubliez une chose : c’est qu’en rentrant de captivité, il vous a fallu travailler. Vous n’êtes certainement pas devenu antiquaire de gaieté de cœur ?
– Plus que vous ne le pensez ! Mon métier me passionne, mais si je vous ai bien comprise vous essayez de me faire entendre qu’en devenant ma femme vous auriez eu à redouter... la pauvreté ? C’est bien ça ?
– Je l’admets, dit-elle avec cette franchise sans nuances qui l’avait toujours caractérisée. Même si les hostilités n’étaient pas intervenues, je ne vous aurais pas épousé car je me doutais que vous ne pourriez pas soutenir votre train de vie pendant de longues années encore et, que voulez-vous, j’ai toujours craint la gêne depuis que j’ai quitté la maison paternelle. Nous n’étions pas riches et j’en ai souffert. On n’imagine pas ce que c’est lorsque l’on a toujours connu l’opulence, ajouta-t-elle en jouant avec un bracelet qui devait totaliser une belle quantité de carats. Avant d’épouser Vendramin, j’ignorais ce que c’était qu’une paire de bas de soie...
– À présent, en tout cas, vous ne semblez pas dans le besoin. Mais, pendant que j’y pense, dites-moi comment vous êtes aussi renseignée sur mes affaires ? On ne vous a pas vue depuis longtemps à Venise, pour ce que j’en sais...
– Sans doute ; cependant j’y garde des amis. Il lui dédia le sourire à la fois moqueur et nonchalant qui manquait rarement son effet.
– La Casati, par exemple ?
– En effet. Comment le savez-vous ?
– Oh, c’est très simple : le soir où j’ai quitté Venise pour venir ici, elle m’avait prié à l’une de ces fêtes dont elle détient le secret et, pour m’appâter, elle m’avait annoncé une surprise, ajoutant même que j’avais tout intérêt à venir si je désirais savoir ce que vous deveniez. J’ai cru un instant que vous étiez chez elle...
– Je n’y étais pas... cependant vous êtes parti ?
– Eh oui ! Que voulez-vous, je suis devenu un homme d’affaires donc un homme sérieux... Mais, en ce cas, je me demande ce que pouvait être la surprise ?
Dianora allait peut-être répondre quand le jeune homme en habit, trouvant sans doute le temps long, surgit du bar et les rejoignit, la mine à la fois contrite et inquiète. Il s’excusa d’interrompre un dialogue où il n’avait que faire en suppliant la jeune femme de considérer que le temps passait vite et qu’ils étaient déjà en retard... Un pli de contrariété se forma aussitôt sur le joli front de Dianora :
– Dieu, que vous êtes ennuyeux, Sigismond ! Par le plus grand des hasards, je viens de retrouver un ami... cher, perdu de vue depuis longtemps et vous venez me parler pendule ! J’ai bien envie d’annuler ce dîner...
Tout de suite Morosini fut debout et se tourna vers le jeune homme dont on pouvait craindre qu’il se mît à pleurer :
– Pour rien au monde, monsieur, je ne voudrais troubler le programme de votre soirée. Quant à vous, ma chère Dianora, il ne faut pas vous faire attendre davantage. Nous nous reverrons un peu plus tard... ou demain matin ? Je pars seulement demain soir.
– Non. Promettez-moi de m’attendre ! Nous ne nous sommes pas dit la moitié de ce que nous avons accumulé pendant ces années. Promettez ou je reste ici ! fit-elle d’un ton définitif. Après tout, je connais peu le comte Solmanski votre père, mon cher Sigismond, et mon absence ne devrait pas lui causer une grande peine.
– N’en croyez rien ! s’écria le jeune homme. Ce serait une grave offense pour lui si vous vous décommandiez au dernier moment ! Je vous en prie, venez !...
– Mais oui, ma chère, il faut y aller, ajouta Morosini que le nom de l’inviteur venait de frapper au plus sensible de la curiosité. Je promets de vous attendre ! Rejoignez-moi au bar lorsque vous rentrerez. De mon côté, je vais grignoter un petit quelque chose ici même...
– Dans ces conditions, soupira la jeune femme en se levant et en refermant son chinchilla, je me rends à vos raisons, messieurs ! Allons donc, Sigismond, et vous Aldo à tout à l’heure !
Quand elle eut disparu en traînant tous les regards après elle, le prince quitta son aspidistra pour gagner le restaurant. Un maître d’hôtel cérémonieux l’installa à une table fleurie de tulipes roses et éclairée par une petite lampe à abat-jour couleur d’aurore. Puis il lui remit une grande carte et s’éloigna sur un salut pour le laisser composer son menu. Telle n’était d’ailleurs pas la préoccupation majeure de Morosini, assez excité à la pensée que Dianora s’en allait dîner dans la maison de la Mazowiecka où il avait songé faire un tour. Ce qui ne s’imposait plus : il en apprendrait davantage quand sa belle amie reviendrait, le regard d’une femme étant toujours beaucoup plus aigu que celui d’un homme. Surtout lorsqu’il y avait là une ravissante jeune fille ! Il serait très instructif d’entendre, tout à l’heure, ce qu’on lui en dirait !
Mis en belle humeur par cette perspective, Aldo se commanda un repas composé de caviar – il avait toujours adoré les petits œufs gris ! – de kaczka, canard braisé farci aux pommes, et de ces koldouni dont les Polonais affirmaient qu’une déesse venue se baigner dans la Wilejka et retenue sur terre par la ruse d’un amoureux en avait donné la recette pour son repas de noces. Il s’agissait d’une sorte de raviolis farcis de viande et de moelle de bœuf, parfumés à la marjolaine et qui, pochés à l’eau, devaient se manger à la cuillère sans les entamer afin qu’ils éclatent seulement dans la bouche. Quant à la boisson et pour être certain de ne pas se tromper, il choisit un Champagne qui aurait au moins l’avantage de le faire digérer.
Tout en laissant son regard errer sur la salle à manger scintillante de cristaux et d’argenterie, Aldo pensait que la vie réserve de bien curieuses surprises. Dianora devait être à cent lieues d’imaginer qu’il l’attendait en pensant à une autre et lui-même admettait volontiers que l’entrevue de tout à l’heure se fût peut-être déroulée de façon bien différente si la blonde Anielka n’avait fait son apparition. La nymphe désolée de la Vistule venait de lui rendre un grand service en le faisant moins sensible à l’assaut des souvenirs trop doux. En procurant à Morosini une émotion nouvelle, elle agissait pour lui à la manière d’un de ces gracieux écrans que l’on place devant les flammes d’un foyer afin d’en atténuer l’ardeur. En fait, ce dont Aldo brûlait, c’était de la revoir.
Malheureusement, il ne lui restait pas beaucoup de temps s’il voulait prendre son train demain soir, et différer son départ serait prendre un retard de plusieurs jours. Or il y avait chez lui plusieurs affaires importantes qui l’attendaient... D’autre part, et même s’il en mourait d’envie, cela valait-il la peine de perdre du temps pour une fille amoureuse d’un autre homme et que, de toute évidence, il n’intéressait pas du tout ? Le plus sage ne serait-il pas de lui tourner le dos ?
Tous ces points d’interrogation occupèrent la majeure partie d’un dîner dont l’orchestre fit une sorte de douche écossaise en alternant allègres mazurkas et nocturnes déchirants.
Son café avalé – un de ces breuvages infâmes dont les hôtels ont le secret – Aldo regagna le bar où il n’aurait à craindre qu’un pianiste discret et dont l’atmosphère feutrée lui plaisait. Il y avait là quelques hommes qui discutaient à voix retenue, perchés sur de hauts tabourets, en buvant des boissons variées. Lui-même choisit un cognac hors d’âge et passa de longues minutes le ballon de cristal dans la paume à en humer le parfum tout en suivant des yeux les volutes bleutées montant de sa cigarette.
Le verre vidé, il se demandait s’il allait en commander un autre quand le barman qui venait de répondre au téléphone intérieur s’approcha de sa table :
– Monsieur me pardonnera si je me permets de supposer qu’il est bien le prince Morosini ?
– En effet.
– Je dois transmettre un message. Mme Kledermann vient de rentrer et fait dire à Votre Altesse Sérénissime qu’elle se sent trop lasse pour prolonger la soirée et qu’elle s’est retirée...
– Madame qui ? sursauta Aldo avec l’impression bizarre que le plafond venait de lui tomber sur la tête.
– Mme Moritz Kledermann, cette très belle dame que j’ai crue voir converser avant le dîner dans le hall avec Votre Altesse ? ... Elle présente ses excuses mais...
Morosini semblait tellement médusé que le barman, inquiet, se demanda s’il ne commettait pas une bévue, quand, soudain, son interlocuteur parut reprendre vie et se mit à rire :
– Ne vous troublez pas, mon ami, tout va bien !
Et ça irait même encore mieux si vous m’apportiez un autre cognac...
Quand l’homme revint avec la boisson, Morosini lui mit un billet dans la main :
– Sauriez-vous me dire quel appartement occupe Mme Kledermann ?
– Oh oui ! L’appartement royal, bien entendu...
– Bien entendu...
Le supplément d’alcool s’avérait nécessaire, contrairement à ce que l’on pouvait craindre, pour qu’Aldo retrouve son équilibre face à la troisième surprise de la soirée, et non des moindres. Que Dianora se fût remariée ne l’étonnait pas. Même, il en était venu à le supposer. Le faste déployé par la jeune femme, ses bijoux fabuleux – ceux que lui avait offerts le vieux Vendramin étaient moins impressionnants ! – tout laissait supposer la présence d’un homme extrêmement riche. Mais que cet homme fût le banquier zurichois dont maître Massaria lui avait offert la fille en mariage, voilà qui dépassait tout ce qu’on pouvait imaginer ! C’était même à mourir de rire. Qu’il eût accepté, et Dianora devenait sa belle-mère ! De quoi bâtir une tragédie... ou plutôt l’une de ces comédies de boulevard si fort appréciées des Français.
L’aventure étant plutôt amusante, elle méritait bien qu’on la prolonge un peu. Bavarder avec la femme du banquier suisse allait être un moment exaltant !
S’arrachant enfin à son fauteuil, Morosini se dirigea vers le grand escalier qu’il gravit d’un pas nonchalant. Point n’était besoin de s’adresser au portier pour trouver l’appartement royal : c’était l’enfance de l’art pour un habitué des palaces. Parvenu au premier étage, il marcha droit à une imposante double porte à laquelle il frappa en se demandant ce qui pouvait pousser Dianora, voyageant sans doute seule avec une femme de chambre, à s’installer tellement au large. Dans tous les grands hôtels, la suite royale se composait en général de deux salons, quatre ou cinq chambres et autant de salles de bains. Il est vrai qu’elle n’appréciait guère la simplicité...
Une soubrette lui ouvrit. Sans rien lui demander, elle tourna les talons et le précéda dans une antichambre puis un salon meublé en style Empire où elle le laissa. La pièce était majestueuse, les meubles ornés de sphinx dorés étaient de grande qualité et quelques toiles honnêtes représentant des paysages habillaient les murs, mais elle évoquait davantage les réceptions officielles que les causeries intimes. Heureusement, le beau feu allumé dans la cheminée arrangeait un peu les choses. Aldo alla s’asseoir près du seul élément chaleureux et alluma une cigarette.
Trois autres suivirent et il commençait à perdre patience quand une porte s’ouvrit enfin pour livrer passage à Dianora. Il se leva à son entrée :
– Avez-vous donc l’habitude d’ouvrir votre porte au premier venu ? fit-il narquois. Votre camériste ne m’a même pas laissé le temps de lui donner mon nom.

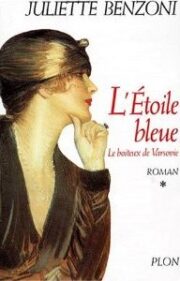
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.