Il tendait le coffret de cuir qu’Aldo repoussa d’un geste doux masquant à merveille la jubilation quasi diabolique qui l’envahissait.
– Merci, sir Eric, mais l’intention me suffira. Je ne veux plus de cette pierre.
– Comment ? Vous refusez ?
– Eh oui ! Vous m’avez dit un jour que, dans votre esprit, le saphir et celle qui était alors votre fiancée étaient inséparables. Rien n’a changé depuis et il va trop bien à lady Ferrais pour que l’idée m’effleure de lui voir une autre destination. Ils sont vraiment faits l’un pour l’autre, ajouta-t-il avec une ironie qu’il fut seul à apprécier. C’était délicieux de se donner les gants d’offrir une pierre fausse à une femme qu’il jugeait tout aussi fausse !
Cette fois, le marchand d’armes semblait confus et, pour alléger l’atmosphère, Morosini rompit les chiens :
– Pour en finir avec la triste histoire que vous avez vécue, puis-je vous demander si vous avez retrouvé votre voiture et votre beau-frère.
– La Rolls oui. Elle était abandonnée à la porte Dauphine. Le beau-frère non, mais je préfère que nous n’en parlions pas afin de ne pas ajouter au chagrin de mon épouse et à celui du comte Solmanski, très affecté par la conduite d’un fils dévoyé. Je n’ai d’ailleurs pas porté plainte et je me suis arrangé pour que la presse ne soit pas informée : nous avons retrouvé ma femme, la rançon, et capturé les ravisseurs, un point c’est tout ! Le nom de Solmanski ne sera pas traîné dans la boue ! Le comte rentre à Varsovie ces jours prochains et nous partons demain pour notre château du Devon où il nous rejoindra plus tard quand la plaie de sa fierté sera un peu cicatrisée...
Aldo s’inclina devant cet homme décidément insaisissable. Il fallait qu’il fût un saint... ou plutôt éperdument amoureux d’Anielka pour agir avec cette magnanimité. Cela méritait bien un coup de chapeau.
– Je ne peux que vous approuver... et vous souhaiter tout le bonheur du monde.
– Rentrez-vous bientôt à Venise ?
– Ce soir même... et avec une joie que je ne saurais exprimer...
Entre lui et Anielka, aucune parole n’avait été échangée. Il n’avait même pas rencontré son regard mais, à nouveau, il prit la main qu’elle lui offrait. Ce fut quand il se pencha sur elle, presque à la toucher de ses lèvres, qu’il sentit le billet que l’on glissait entre ses doigts...
Un instant plus tard, l’étrange couple s’éloignait. Aldo remonta dans sa chambre pour dérouler le message et le lire : il ne contenait que peu de mots : « Je dois obéir à mon père et accomplir ma pénitence. Pourtant c’est vous que j’aime, mais le croirez -vous encore ? ... »
Pendant un moment, son cœur battit plus fort. De joie peut-être, et aussi d’une vague espérance. Pourtant la méfiance ne voulait pas mourir : il revoyait Anielka étendue sur le canapé l’autre nuit, regardant Ferrais, souriant à Ferrais, acceptant Ferrais...
Il fourra le mince papier dans sa poche en essayant de ne plus y penser. C’était difficile. Les mots dansaient dans sa tête. Les plus beaux surtout, les plus magiques : « ... c’est vous que j’aime. » Et cela dura des heures, jusqu’à devenir intolérable ; peut-être parce qu’au regret, au désir réveillé, se mêlait un peu de honte : sir Eric avait été le jouet d’une assez vilaine comédie qu’il ne méritait pas.
Alors, quand il se retrouva seul dans le luxueux compartiment du Simplon-Orient-Express fonçant à pleine vitesse à travers les campagnes bourguignonnes endormies, Aldo baissa la vitre, tira l’unique lettre d’amour d’Anielka, la déchira en menus morceaux que le vent de la course emporta. Ensuite seulement il put dormir...
TROIS MOIS PLUS TARD A L’ILE DES MORTS...
Une brassée de roses à la proue, la gondole noire aux lions ailés traçait sa route vers l’île-cimetière de San Michele. Assis sur les coussins de velours amarante, Aldo Morosini regardait approcher l’enceinte blanche, ponctuée de pavillons, qui cernait la masse sombre et dense des grands cyprès.
Chaque année, les princes de son nom allaient fleurir leur chapelle funéraire en l’honneur de madonna Felicia, née princesse Orsini, au jour anniversaire de sa mort, et Aldo ne manquait jamais de se conformer à ce rite, mais aujourd’hui, le pieux voyage prenait un double sens grâce au message qu’un banquier zurichois lui avait fait parvenir une semaine plus tôt : « Le 25 de ce mois, vers dix heures du matin, à l’île San Michele. S.A. » Quelques mots mais qui avaient apporté à Morosini un appréciable soulagement.
Depuis environ deux mois qu’il était rentré chez lui, Aldo s’inquiétait d’un inexplicable silence. Aucune nouvelle ne lui était arrivée en réponse au bulletin de victoire envoyé depuis Paris et annonçant le succès de sa première mission. Il avait craint d’apprendre qu’une catastrophe quelconque était venue réduire à néant la quête du Boiteux. Heureusement, il n’en était rien.
La journée s’annonçait belle. La lourde chaleur estivale sous laquelle Venise étouffait chaque année faisait trêve depuis le gros orage qui avait éclaté la veille au soir. La lagune devenait satin et miroitait sous un soleil léger. C’était un beau matin paisible, animé par le cri des oiseaux de mer. Guidée avec force et douceur par Zian, la gondole – pour rien au monde Aldo n’eût pris le canot automobile pour faire visite à ses chères princesses ! -griffait à peine l’eau calme et, en regardant approcher la cité des morts, il éprouva une fois de plus l’impression d’être au bout du monde vivant, de voguer vers quelque Jérusalem céleste, parce que San Michele lui rappelait un peu ces palais blancs débordant de verdure qu’il avait admirés, avant la guerre, au cours d’un inoubliable voyage aux Indes et qui surgissaient soudain du miroir liquide d’un beau lac où leur reflet s’inscrivait avec une netteté parfaite.
Quand l’embarcation atteignit le pavillon à colonnes dont les degrés de marbre plongeaient dans l’eau, Aldo sauta à terre, prit l’énorme bouquet et entra dans le cimetière, salué familièrement par le gardien qu’il connaissait de longue date. Il s’engagea dans l’une des allées bordées de hauts cyprès où une légère brume s’attachait encore. Tout autour, des tombes marquées de croix blanches, toutes semblables mais abondamment fleuries. De loin en loin, une aristocratique chapelle dont les occupants étaient assurés qu’on les laisserait tranquilles. En effet, les habitants des tombes n’étaient là que de passage : faute d’espace et en dépit de l’étendue du cimetière, les restes humains étaient relevés au bout d’une douzaine d’années pour être confiés à l’ossuaire.
Aldo aimait bien San Michele, qu’il ne trouvait pas triste. Toutes ces petites croix blanches émergeant d’une masse de corolles diversement teintées ressemblaient à un parterre sur lequel il aurait neigé.
Le champ du repos était vide, à l’exception d’une vieille femme en grand deuil courbée sur l’une des sépultures, un chapelet de buis coulant de ses mains, abîmée dans sa prière. Ce fut seulement quand il atteignit la chapelle familiale qu’il vit le prêtre ou ce qu’il crut un instant en être un. La longue robe noire, un peu flottante, et la coiffure ronde pouvaient appartenir à plusieurs Églises d’Orient ainsi que la barbe rejoignant les grands cheveux, mais il sut très vite qu’il avait déjà vu ces belles mains et la puissante canne d’ébène où elles s’appuyaient. Debout devant la porte de bronze, le visiteur, tête penchée, semblait plongé dans une profonde méditation et Aldo patienta un petit moment. Il était certain que, derrière les lunettes fumées masquant le haut du visage, s’abritait un œil unique d’un bleu aussi profond que celui du saphir, et que Simon Aronov était devant lui. Soudain, celui-ci parla, sans même se retourner :
– Pardonnez-moi mon silence ! dit-il. Je crains qu’il ne vous ait inquiété mais je me trouvais assez loin. En outre, je tenais à ce que, pour cette fois, nous nous rencontrions ici, à Venise, et devant ce tombeau afin de rendre hommage à celle qui fut la dernière victime de la pierre bleue. Je voulais venir plier le genou sur les cendres d’une grande dame et prier. En face du Très-Haut, ajouta-t-il avec l’ombre d’un sourire, les prières, en quelque langue qu’on les prononce, n’ont d’autre valeur que leur sincérité...
Pour toute réponse, Aldo tira une clef de sa poche et ouvrit la porte du tombeau :
– Entrez ! dit-il.
Bien qu’entretenu à la perfection, l’intérieur de la chapelle sentait les fleurs fanées, la cire refroidie et surtout l’humidité, mais dans ce milieu quasi aquatique, aucun Vénitien n’y prêtait attention. Morosini désigna le banc de marbre placé en face de l’autel et propice aux méditations. Le Boiteux s’y assit tandis qu’il déposait ses roses dans une jardinière.
– Vous fleurissez souvent cette tombe ? demanda Aronov.
– Assez souvent, oui, mais aujourd’hui ce n’est pas pour ma mère. Le sort a voulu que vous me fixiez rendez-vous au jour anniversaire de la mort de notre amazone : Felicia Orsini, comtesse Morosini, qui toute son existence lutta pour ses convictions et pour venger son époux fusillé à l’Arsenal par les Autrichiens. Si nous avions le temps, je vous raconterais sa vie : elle vous plairait... mais ce n’est pas pour écouter la saga de ma famille que vous êtes venu. Voici ce que je vous ai annoncé !
Il tendait un écrin de cuir bleu qu’Aronov garda un instant entre ses doigts, sans l’ouvrir. Une larme glissa de son œil :
– Après tant de siècles ! murmura-t-il. Merci !... Me ferez-vous la grâce de vous asseoir un instant auprès de moi ?
Pendant un moment qui lui parut très long, Aldo regarda les longs doigts caresser le maroquin soyeux. Jusqu’à ce qu’enfin il disparût dans les plis de la robe noire, mais à sa place surgit un petit paquet enveloppé de soie pourpre parfilée d’or. La voix lente et chaude du Boiteux se fit entendre à nouveau :
– Parler d’argent ici serait un sacrilège, dit-il. À cette heure, mes banquiers doivent être en train de régler la question avec votre trésorerie. Ceci – et j’espère que vous l’accepterez ! – est un don personnel offert aux mânes d’une princesse chrétienne.
En même temps, il ôtait le tissu chatoyant, révélant un reliquaire d’ivoire d’un travail admirable que l’œil averti du prince-antiquaire attribua sans hésitation au VIe siècle byzantin. Par les cloisons évidées, on pouvait voir qu’il était doublé d’or et qu’au centre reposait un mince étui de cristal enfermant quelque chose qui ressemblait à une aiguille brune.
– Ceci, dit Aronov, appartenait à la chapelle privée de la dernière impératrice de Byzance au palais des Blachernes. C’est une épine de la couronne du Christ... du moins on l’a toujours cru et je veux le croire aussi, ajouta-t-il avec un sourire d’excuses qu’Aldo comprit : il y avait tant de reliques à Byzance qu’il était difficile d’en attester toujours l’authenticité. Le présent n’en demeurait pas moins royal.
– Et vous me le donnez ? dit Morosini la gorge soudain sèche.
– Pas à vous. À elle ! Et je vois là un tabernacle de marbre où mon humble hommage trouvera la place qui lui convient. Il apaisera peut-être l’âme inquiète de votre mère. On dit chez nous que c’est le cas lorsqu’il s’agit d’un assassinat...
Aldo hocha la tête, prit le reliquaire, le déposa pieusement à l’intérieur du tabernacle devant lequel il s’agenouilla un instant avant de le refermer et d’en enlever la clef. Puis il revint à son visiteur.
– J’espérais pouvoir l’apaiser moi-même, soupira-t-il avec amertume, mais le meurtrier court encore. Cependant, j’ai quelques doutes depuis que j’ai rencontré le dernier possesseur du saphir.
– Le comte Solmanski... ou celui qui se fait appeler ainsi ?
– Vous le connaîtriez ?
– Oh oui ! Et j’ai aussi appris bien des choses en lisant les journaux parisiens du mois de mai. Il y avait dedans une excellente photographie de la jeune mariée enlevée au soir de ses noces... et une autre de son père !
– Il ne le serait pas ?
– Ça, je l’ignore, mais ce dont je suis certain c’est que le nom annoncé n’est pas le sien. Le vrai Solmanski a disparu en Sibérie, voilà de nombreuses années. Il y a été déporté pour complot contre le tsar. Il doit y être mort car je n’ai pas réussi à savoir ce qu’il est devenu, mais son remplaçant – Ortschakoff de son véritable nom – doit être au courant pour avoir osé venir s’installer à Varsovie dans le palais de celui qui a été sans doute sa victime. Comme beaucoup d’autres au nombre desquelles il aimerait me compter !
– Il est votre ennemi ?
– Il est celui du peuple juif. Pour une raison que j’ignore, il en a juré la perte et je puis vous dire qu’il a participé à plusieurs pogroms. Il cherchait déjà le pectoral dont il connaît la légende et il « me » cherchait. C’est pourquoi je vis dans la discrétion... et sous un faux nom.

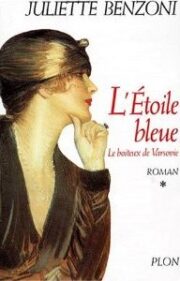
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.