Ce que voulait Simon Aronov était simple : obtenir de cet expert européen en joyaux anciens qu’il l’aide à récupérer les quatre pierres manquant au pectoral et cela dans le plus noble des buts : une tradition juive voulait, en effet, qu’Israël retrouve patrie et souveraineté quand ce symbole des Douze Tribus, entièrement reconstitué, lui serait rendu.
Le choix du prince-antiquaire n’était pas fortuit : parmi ces quatre pierres, sa famille maternelle possédait depuis plusieurs siècles le saphir, dit saphir wisigoth ou Étoile bleue, et Aronov espérait obtenir de son hôte qu’il accepte de le lui vendre, ignorant encore qu’Isabelle Morosini, la dernière propriétaire, avait été assassinée par son cambrioleur.
Cette nuit-là, une entente s’était scellée entre le Juif et le prince chrétien. Fructueuse, puisque deux mois plus tôt, dans l’île-cimetière de San Michele à Venise, Simon Aronov recevait des mains de son émissaire le saphir revenu à lui au terme d’une folle aventure jalonnée de plusieurs morts puisque, hélas ! les gemmes arrachées au pectoral attiraient le malheur.
La Rose d’York était donc la deuxième pierre manquante et, depuis une semaine, la presse britannique, relayée par les principaux journaux européens, embouchait ses grandes trompettes afin d’annoncer la vente prévue chez Sotheby’s pour le 5 octobre. Sans se douter le moins du monde que le bijou annoncé n’était pas le vrai mais une admirable copie exécutée dans les moindres détails grâce à un procédé connu du seul Simon Aronov.
Le raisonnement de celui-ci était simple. Ayant acquis la certitude que le diamant ne pouvait se trouver qu’en Angleterre, caché au fond du coffre de quelque collectionneur particulièrement discret, il jouait là un coup de poker reposant sur sa profonde connaissance de l’âme humaine et surtout de celle plutôt complexe des collectionneurs de tout poil. Selon ses prévisions, le possesseur du véritable diamant ne pourrait supporter le battage suscité autour de la fausse pierre parce que, de deux choses l’une : ou bien le vacarme soulevé par l’annonce de la vente lui inspirerait un doute insidieux sur l’authenticité de sa propre pierre, ou bien son orgueil ne tolérerait pas de voir un faux susciter admiration, convoitise et même dévotion. De toute façon, il se manifesterait, et c’est là que l’attendait Simon Aronov par la personne interposée d’Aldo Morosini. Aussi, dès son retour à Londres, celui-ci comptait-il bien se rendre chez le joaillier censé être le découvreur du joyau et qui le livrait au feu des enchères dans l’espoir « secret » -selon la presse – d’inciter le gouvernement de Sa Majesté à l’acheter pour le joindre au Trésor de la Couronne déposé à la Tour de Londres et empêcher ainsi qu’une pièce appartenant à l’histoire anglaise quitte la mère patrie. Les journaux faisaient aussi état de plusieurs lettres anonymes, reçues par Mr. Harrison, affirmant que son diamant était faux et que, s’il n’annulait pas la vente, il risquait d’être démasqué publiquement. Toute une suite de bonnes raisons pour une visite au luxueux magasin de New Bond Street !
Il était déjà tard et de violentes bourrasques de pluie trempaient les rues d’Inverness quand la voiture déposa son passager devant le Caledonian Hotel. Transi, car le mercure était en chute libre, celui-ci paya son chauffeur et se précipita à l’intérieur, avide de retrouver une baignoire pleine d’eau chaude – le Caledonian était le meilleur hôtel de la ville et son confort sans défaut ! – et un verre de la boisson nationale, mais, en traversant le hall, il aperçut son ami Adalbert, installé au bar, un journal en travers des genoux, un gobelet de whisky à la main et apparemment en proie à une profonde méditation. Ce qui était tout à fait inhabituel. Aussi choisit-il de le rejoindre afin d’apprendre la raison d’une mine aussi sombre.
– Eh bien ? fit-il en s’installant sur le tabouret voisin et en indiquant du geste au barman de lui servir la même chose. Tu en fais une tête ?
Adalbert Vidal-Pellicorne tressaillit mais arbora aussitôt le sourire qui le quittait rarement. C’était le plus agréable compagnon qui soit : toujours optimiste et d’humeur égale il avait noué depuis quelques mois avec Aldo une amitié qui, née d’abord de la nécessité, ne cessait de s’affirmer à l’entière satisfaction des deux hommes. Bien que leur première rencontre se fût déroulée dans des circonstances pittoresques, elle avait été souhaitée, voulue par Simon Aronov. Vidal-Pellicorne était l’un des rares hommes en qui le Boiteux eût une confiance absolue. Et cela en dépit d’une apparence et d’un comportement originaux pour ne pas dire farfelus.
Au physique, c’était un homme d’une quarantaine d’années mais qui en paraissait dix de moins. Long et mince au point que l’on pouvait se demander s’il possédait un squelette, il arborait sous une tignasse blonde et bouclée toujours en désordre une figure de chérubin aux yeux d’un bleu candide et au sourire angélique, ce qui ne l’empêchait pas d’être malin comme un singe, solide comme un roc et doué d’une habileté manuelle remarquable. Archéologue de profession avec un faible pour l’égyptologie et une solide connaissance des pierres précieuses, il écrivait agréablement, s’habillait avec élégance, possédait toutes les qualités d’un épicurien, d’un parfait homme du monde, d’un habile prestidigitateur et d’un serrurier à rendre jaloux le fantôme du roi Louis XVI. C’était surtout grâce à ses divers talents que Morosini avait pu récupérer le saphir et le restituer à Simon Aronov. Tel qu’il était, Morosini l’aimait bien et appréciait de l’avoir comme partenaire dans la dangereuse quête pour le pectoral.
Sans répondre à la remarque de son ami, Adalbert accentua son sourire :
– Alors, cet enterrement ? demanda-t-il en repoussant d’un geste machinal la mèche qui lui mangeait continuellement un sourcil. Ça s’est bien passé ?
– Tu n’avais qu’à m’accompagner, tu le saurais.
– Il ne faut pas trop m’en demander, mon bon ! Je ne suis venu dans ce pays quasi barbare que pour te tenir compagnie. En outre, j’ai horreur des enterrements.
– Celui-là valait le dérangement : une simplicité pleine de grandeur et de couleur locale avec, en plus, une surprise.
– Bonne ou mauvaise ?
– Pas terrible. Je savais que les Saint Albans appartenaient à la famille de sir Andrew mais j’ignorais qu’ils étaient ses héritiers directs. Ils sont maintenant comte et comtesse de Killrenan. Une descendance qui ne doit pas causer beaucoup de joie à mon vieil ami. Je les trouve aussi antipathiques l’un que l’autre bien qu’elle soit jolie.
– Il n’avait qu’à y penser plus tôt à sa descendance et s’en fabriquer une, remarqua Adal, rejoignant sans le savoir la philosophie du lutin de la lande.
– Quelqu’un m’a déjà dit ça ce matin. Tu verras à quoi ils ressemblent le jour de la vente chez Sotheby’s. Peut-être même avant : lady Mary n’a toujours pas digéré l’affaire du bracelet...
– Tu crois qu’ils seront sur les rangs pour la Rose ?
– Elle sûrement. Elle entre en transe dès qu’elle voit un joyau. Lui, je n’en sais rien : il est collectionneur de jades rares mais il est peut-être amoureux et comme il a l’air plutôt argenté, cet avocat...
– Il appartient au barreau ?
– Il paraît.
Tandis que Morosini portait à ses lèvres le verre qu’on venait de lui servir, Adalbert vidait le sien tout en retombant dans sa songerie de tout à l’heure mais son ami n’eut pas le temps de lui poser de questions. Il se gratta le bout du nez puis soupira :
– A propos d’avocat, quelqu’un qui te touche de près va en avoir un besoin urgent ces jours-ci !
– Qui donc ?
– Anielka Ferrals. Elle est accusée du meurtre de son mari.
Les doigts nerveux de Morosini retinrent de justesse le verre qui allait s’en échapper. Son second réflexe fut de le vider d’un trait.
– Comment as-tu appris cela ? murmura-t-il.
L’archéologue reprit le journal resté étalé sur ses genoux, le retourna et le lui offrit :
– C’est là-dessus. J’hésitais un peu à te le dire pour ne pas achever de détruire ton moral après l’enterrement d’un ami mais ce n’est que reculer pour mieux sauter : autant que tu saches tout.
– Je préfère, en effet...
Ce fut vite lu : l’information était brève, presque laconique. Visiblement, Scotland Yard gardait vis-à-vis des journalistes un silence prudent afin de leur éviter de se mêler de son enquête et de la gêner : les présomptions d’empoisonnement sur la personne de son époux qui pesaient sur lady Ferrals étant sérieuses, la jeune femme avait été conduite au commissariat central de Canon Row puis présentée au juge qui lui avait refusé la liberté provisoire. Elle venait d’être écrouée à la prison de Brixton. Rien de plus !
Tandis qu’Aldo lisait, Vidal-Pellicorne observait son ami. Il semblait accablé. Plus la moindre trace de l’indolente ironie qui rendait si séduisant l’étroit visage brun au profil de condottiere ! Et quand les yeux bleu acier se relevèrent sur lui, Adalbert put y voir passer une ombre de douleur qui confirma ses inquiétudes : en dépit de la rude déception qu’il lui devait, Morosini aimait toujours la jeune Polonaise dont il avait espéré un instant faire sa femme.
Il se garda cependant de la moindre remarque, sachant qu’elle serait mal venue :
– Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est comment on a pu en arriver là, se contenta-t-il de soupirer. Il n’est pas possible qu’elle soit coupable.
– Crois-tu ? Ses réactions sont tellement imprévisibles ! J’ai souvent eu l’impression que, pour elle, la mort – qu’il s’agisse de la sienne ou de celle des autres ! – ne présentait guère d’importance. Je crois qu’elle doit savoir aimer mais ce dont je suis certain c’est qu’elle sait haïr. Souviens-toi de son mariage et des jours qui l’ont suivi !
– Elle avait bien quelques circonstances atténuantes ! Son époux s’était comporté avec elle comme un soudard sans même attendre d’être marié selon l’Église. Quant à toi, elle était persuadée que tu te moquais d’elle avec la sublime Dianora Kledermann, ton ancienne maîtresse.
– Je te l’accorde. Pourtant, de là à tuer, il y a quand même une différence. De toute façon, rien ne sert d’ergoter : en rentrant à Londres demain, nous en saurons peut-être un peu plus... Et, à ce propos, toi qui connais le monde entier, as-tu des relations à Scotland Yard ?
– Aucune ! L’Angleterre n’est pas ma villégiature préférée. J’apprécie ses maîtres tailleurs, ses chemisiers, ses jardins, son tabac, son whisky et son code de la civilité puérile et honnête, mais je déteste son climat, ses odeurs de charbon, sa Tamise huileuse, son brouillard, son Intelligence Service avec qui j’ai eu à en découdre parfois et surtout sa cuisine ! Le pire, en la matière, étant le haggis qui est sans doute la plus abominable tambouille que j’aie jamais avalée...
On l’évita soigneusement au dîner où Aldo ne mangea guère. En dépit de la sévérité dont il venait de faire preuve, la pensée d’Anielka le hantait. Cette exquise femme-enfant de dix-neuf ans croupissant dans les ombres maléfiques d’une prison lui était d’autant plus insupportable que depuis quatre mois il s’efforçait de l’enfouir au plus profond de sa mémoire à la limite des frontières de l’oubli. Sans résultat, bien entendu ! Pour ce genre d’entreprise, il fallait laisser le temps au temps...
Anielka ! Depuis leur première rencontre dans les jardins de Wilanow, près de Varsovie, elle l’obsédait. Peut-être parce qu’elle était entrée dans sa vie en même temps que Simon Aronov et que c’était à peine une coïncidence qu’elle eût arboré l’Étoile bleue, un soir d’avril à Paris, en débarquant du Nord-Express avec son père et son frère. À cet instant Morosini l’avait déjà sauvée, par deux fois, du suicide. Si elle voulait attenter à sa vie, c’était d’abord parce qu’elle devait renoncer à Ladislas, l’étudiant nihiliste qu’elle aimait, ensuite parce qu’elle refusait d’être livrée en justes noces à Eric Ferrals, le marchand d’armes. Et puis, il y avait eu la rencontre au Jardin d’Acclimatation – elle adorait les jardins ! – où, après lui avoir dit qu’elle l’aimait, elle avait supplié Aldo de la sauver d’un mariage odieux mais nécessaire pour renflouer la fortune familiale, et tout ce qui s’était ensuivi jusqu’à ce dernier billet disant qu’ayant accepté par raison la vie conjugale elle n’en vouait pas moins à son prince vénitien un amour éternel. Un billet que, le soir même, il déchirait en morceaux et jetait par la fenêtre du train pour Venise...
Était-ce à cause de cet amour qu’elle avait tué ? La tentation d’y croire était forte et Morosini se défendait de plus en plus faiblement contre une explication romantique flattant sa vanité. De toute façon, il savait bien qu’à peine à Londres il n’aurait rien de plus pressé que de voler vers elle si c’était possible, d’essayer de la voir et de tout tenter pour l’aider.

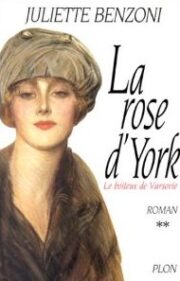
"La Rose d’York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La Rose d’York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La Rose d’York" друзьям в соцсетях.