— Il vient du royaume de Soudan, Madame, expliqua Beaufort en espagnol, tout exprès pour vous servir. Il est adroit en toutes choses, il joue de la flûte et sait danser. Il s’appelle Nabo… Il est chrétien.
Tandis que Marie-Thérèse, rouge de joie, riait en frappant ses mains l’une contre l’autre dans un geste qui lui était familier, sa naine qui la suivait partout comme un petit chien vint prendre le jeune garçon par la main pour l’entraîner sous une tonnelle où elle s’était préparé un petit repas de gâteaux et de sucreries afin de le partager avec lui. Ils étaient à peu près de la même taille mais le contraste qu’ils formaient – elle si laide en dépit de ses habits magnifiques, lui si beau ! – était frappant et, naturellement, quelques plaisanteries osées fusèrent sur ce qui pouvait sortir plus tard d’un tel couple. Un coup d’œil sévère du Roi les fit taire tandis que Marie-Thérèse recommandait :
— Tu peux jouer avec lui, Chica, mais ne me l’abîme pas !
Sur le visage grossier où les traits semblaient avoir du mal à se mettre d’accord pour composer une physionomie, un étonnant, un radieux sourire éclata soudain :
— Oh non !… Il est trop joli ! Chica en prendra grand soin !…
Pendant le souper fastueux où Beaufort tint à servir en personne son jeune souverain, Mademoiselle, qui pour une fois n’avait pas faim, se rapprocha de Sylvie assise à l’écart sur un banc de pierre voisin d’un parapluie de roses, et s’installa auprès d’elle. Durant le long voyage de retour, les deux femmes avaient noué amitié.
— Que faites-vous là seulette ? Ne me dites pas que votre amoureux vous délaisse déjà ? Ou bien l’avez vous renvoyé ?
— Mon amoureux ? Oh… M. de Gramont ? Il vient de partir pour Paris où l’appelle je ne sais quelle affaire.
Elle dit cela d’un ton tellement indifférent que la princesse se mit à rire.
— Allons, je constate avec joie qu’il ne vous émeut guère et vous n’imaginez pas comme j’en suis ravie !
— Pourquoi donc ?
— Parce que je redoute qu’il ne devienne veuf un jour et ne demande votre main…
— Pourquoi deviendrait-il veuf ? La duchesse est-elle malade ?
— Sa santé n’est pas des meilleures. Ce n’est d’ailleurs pas une sinécure d’avoir épousé un Gramont, et la pauvre Françoise de Chivré qui détient le titre déteste son château de Bidache où on la confine généralement et passe le plus de temps qu’elle peut avec sa fille, la princesse de Monaco. Elle doit s’y sentir en sûreté !
— En sûreté ? Ne le serait-elle pas auprès de son époux ?
— Oh, l’époux serait assez bon homme en dépit de son caractère emporté, et surtout intéressé, mais le pire c’est son frère, le chevalier, qui est un vrai démon et que, malheureusement, il écoute un peu trop. Si celui-ci juge un jour qu’une nouvelle alliance, avec une femme riche et bien en cour, pourrait être utile à la famille, la duchesse pourrait faire à Bidache un dernier séjour… un peu malsain.
— Vous ne voulez pas dire, Altesse, que cette pauvre femme pourrait…
Le regard effaré de sa nouvelle amie fit sourire la princesse.
— Oh si ! Je les en crois très capables et la pauvre Françoise ne l’ignore pas. Elle fait d’affreux cauchemars quand elle est là-bas. Elle m’a dit un jour y avoir rencontré le fantôme de sa belle-mère…
— La mère du maréchal ? Lui serait-il arrivé malheur ?
— C’est le moins qu’on puisse dire. Écoutez plutôt…
Et Mademoiselle raconta comment, un jour de mars 1610, le père du maréchal, rentrant chez lui inopinément, surprit sa femme, la belle Louise de Roquelaure, en tendre conversation avec un sien cousin, Marsilien de Gramont que, par malheur, il aimait aussi. Sa réaction fut immédiate : il embrocha le séducteur tandis que Louise réussissait à s’enfuir jusqu’à un couvent voisin. Le mari furieux l’en tira bien vite pour la traduire devant une espèce de tribunal composé des notables du pays où elle eut la pénible surprise de trouver le cadavre de son amant que l’on n’avait pas encore enterré. Tous deux furent condamnés à être décapités, ce que l’on exécuta aussitôt sur Marsilien mais, pour sa femme, Antonin de Gramont préféra attendre, craignant un peu les représailles d’un beau-père qui était non seulement gouverneur de Gascogne mais fort bien en cour. En effet, Roquelaure en appela à la Reine, Marie de Médicis, et Gramont reçut l’ordre « de ne rien tenter contre la vie de son épouse ». Cet ordre que lui porte le conseiller de Gourgues, Gramont le reçoit avec colère. Il part pour Paris, laissant la coupable à la garde de sa mère qui n’était autre que la fameuse Diane d’Andoins, dite Corisande, la première passion du jeune Henri IV alors roi de Navarre. C’est une femme dure, orgueilleuse qui supporte mal le temps qui passe. Elle déteste sa belle-fille. Le mari a-t-il ou n’a-t-il pas donné d’instructions à sa mère ? Toujours est-il que le 9 novembre suivant, on portait en terre la jeune femme à laquelle Corisande refusa la sépulture des Gramont…
— On dit, acheva Mademoiselle, que la malheureuse aurait été jetée au fond d’une oubliette où Corisande la laissa mourir les os brisés. En ce qui me concerne, je n’ai jamais voulu aller à Bidache et je vous conseille d’en faire autant…
— Quelle horrible histoire ! émit Sylvie, glacée jusqu’à l’âme. Et le fils n’a rien tenté pour sa mère ?
— Il la connaissait à peine. Depuis sa naissance il vivait chez Corisande, à Hagetmau. Alors, si vous apprenez la mort de la duchesse, sauvez-vous à toutes jambes !…
Sylvie n’écoutait plus. Elle regardait la table royale où François remplissait la coupe de Louis XIV avec des gestes presque tendres. Mademoiselle surprit ce regard et soupira :
— Celui-là aussi vous aime… et au fond je ne vois pas pourquoi vous ne l’épouseriez pas ?
Le propos ne surprit pas Sylvie. La princesse était depuis longtemps la meilleure amie de François, sa complice durant la Fronde et sans doute aussi sa confidente. Sans même tourner la tête, elle répondit :
— Pendant des années ce fut mon rêve impossible et ça l’est plus encore à présent…
— À cause de ce malheureux coup d’épée ? Nous étions tous un peu fous alors et l’on s’étripait joyeusement en famille selon que l’on tenait pour ou contre Mazarin, mais s’il s’est souvent battu en duel, jamais Beaufort n’a été l’agresseur. C’est pour cela, je crois, que sa sœur lui a pardonné la mort de Nemours. Vous devriez pardonner aussi…
— C’est à mon fils que le pardon appartient. Lorsqu’il aura l’âge d’homme – ce qui vient vite ! – il saura à quoi s’en tenir et, s’il pardonne, je n’aurai aucune raison d’être plus intransigeante.
— Et s’il ne pardonne pas, s’il provoque Beaufort en duel ?
— Cela, je saurai l’empêcher, dussé-je y laisser la vie… mais j’espère bien ne pas en venir là !
— Je l’espère aussi, cependant suivez mon conseil. Faites la paix avec Beaufort ! Même Chimène a fini par épouser Rodrigue !
Cette fois, Sylvie se contenta de sourire. Elle ne pouvait deviner qu’un danger plus grand, plus immédiat surtout, allait se présenter bientôt.
Le jeudi 26 août, dans la fraîcheur du matin, le Roi et la Reine qui avaient quitté Fontainebleau prirent place sur un double trône abrité de soie fleurdelysée à crépines d’or que l’on avait érigé sur un vaste espace herbu, et un peu en élévation, situé à mi-chemin environ du château de Vincennes et de la porte Saint-Antoine[58]. Tous deux, naturellement, étaient vêtus avec la somptuosité qu’un peuple attend de ses souverains en représentation, mais pour ce jour où Paris allait découvrir sa reine, Louis XIV avait volontairement assourdi son propre éclat afin de laisser briller davantage Marie-Thérèse. Celle-ci portait en effet une robe de satin noir tellement brodée d’or et d’argent, tellement enrichie de perles et de pierreries que l’on n’en voyait plus guère la couleur d’origine. Des diamants scintillaient sur sa jeune gorge, à ses oreilles, ses bras, ses petites mains, et, sur sa chevelure coiffée lâche afin qu’on pût l’admirer, la couronne royale étincelait de tous ses feux dans le soleil du matin. Louis se contentait d’un habit entièrement brodé d’argent et d’un seul diamant à son chapeau sous le piquet d’aigrette et de plumes blanches.
Le jeune couple reçut là l’hommage des corps constitués, subit avec patience l’interminable discours d’un chancelier Séguier drapé d’or de la tête aux pieds et qui croyait que ce jour était aussi celui de son triomphe : ce n’était plus un secret pour personne que Mazarin allait vers sa fin et l’imposant personnage pensait que le rôle de Premier ministre l’attendait… Enfin, l’immense cortège qui allait amener la Reine au Louvre put s’ébranler. Louis XIV sauta, avec un évident soulagement, sur un beau cheval bai brun tandis que Marie-Thérèse s’installait dans un « char plus beau que celui que l’on donne faussement au soleil et ses chevaux auraient emporté le prix de la beauté sur ceux de ce dieu de la fable ». Elle souleva un enthousiasme délirant auquel elle répondit par des sourires d’abord timides puis plus assurés et qu’elle appuyait d’un joli geste de la main à mesure que les acclamations se levaient sur son passage. Elle pouvait voir, caracolant devant elle, l’homme qu’elle aimait à présent plus que tout au monde : de lui, en ce jour de gloire, ne pouvaient lui venir que des bonheurs. On était bien loin de la pompe espagnole où le peuple, saluant très bas, regardait passer dans un silence religieux des idoles hiératiques parées comme des châsses de saints. À Paris on saluait aussi, mais on se relevait vite pour jeter son chapeau en l’air, crier, chanter et dire des vers :
Venez, ô reine triomphante,
Et perdez sans regrets le beau titre d’Infante
Entre les bras du plus beau des rois.
Il était six heures du soir quand, de concerts en compliments et d’hymne en arcs de triomphe, on atteignit enfin le Louvre qui, pour la circonstance, avait fait toilette – la longue absence de la Cour l’avait permis – et offrait des appartements rénovés, des tentures fraîches, des fleurs partout… même si la Cour carrée n’était toujours pas achevée.
En compagnie de Mmes de Navailles et de Motteville, Sylvie avait assisté au défilé depuis l’un des balcons de l’hôtel de Beauvais appartenant à cette femme de chambre d’Anne d’Autriche que l’on surnommait Cateau la Borgnesse et dont la fortune avait connu un essor incroyable depuis que, pendant la Fronde, elle s’était emparée du jeune Roi pour le déniaiser, exploit qui avait ravi sa mère. Depuis, l’époux de la dame, ancien marchand de rubans dans la galerie du Palais, avait été promu conseiller et baron de Beauvais, et une véritable manne céleste ne cessait de pleuvoir sur le couple. Elle leur avait permis d’acheter à Madeleine de Castille, l’épouse de Fouquet, un terrain longeant la rue Saint-Antoine, sur lequel ils avaient bâti un magnifique hôtel dont la nouveauté résidait dans le corps de logis principal donnant directement sur la rue et orné de plusieurs balcons. Tendu de velours pourpre, les deux plus beaux avaient abrité, l’un, Anne d’Autriche, sa belle-sœur la reine mère d’Angleterre et la jeune Henriette, fille de celle-ci, le deuxième, Mazarin et Turenne. Les principaux de la Cour, ceux qui n’étaient pas dans le cortège, se partageaient les autres. Pour leur part, Mme de Fontsomme et ses deux amies n’avaient accepté que contraintes et forcées : elles détestaient d’un cœur unanime cette baronne de Beauvais aux armoiries fraîchement peintes en qui elles ne voyaient pas grande différence, sur le plan de l’honorabilité, avec une patronne de bourdeau. Mais la possibilité de refuser leur avait été ôtée par la Reine Mère en personne : elles étaient « ses » invitées, en partant du principe que, dans la maison qu’elle honorait de sa présence, elle était chez elle. Les rétives s’étaient donc inclinées, ce qui avait valu à Sylvie de recevoir le salut énamouré de M. de Gramont qui défilait devant le Roi avec les autres maréchaux de France ; mais à peine le cortège éloigné, peu désireuses de partager le pain et le sel de Cateau la Borgnesse, elles tirèrent toutes trois leur révérence pour gagner le Louvre par un chemin détourné et s’y restaurer en attendant l’arrivée de la Reine.
En descendant de carrosse devant l’entrée principale – qui était encore la porte de Bourbon mais plus pour longtemps, car Louis XIV avait décidé de raser tout ce qui restait du Vieux Louvre –, Sylvie fut abordée par un gentilhomme d’une quarantaine d’années, portant beau encore que vêtu à une mode vieille d’une dizaine d’années, dont la tournure ainsi que le teint basané dénonçaient un coureur d’aventures venu de loin. Son visage irrégulier n’était pas sans charme et il montra une politesse parfaite en saluant Sylvie :

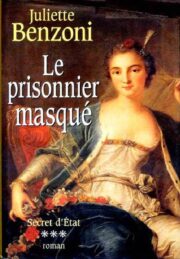
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.