— Je vous demande en grâce de me pardonner si je vous suis importun, madame, mais j’étais dans la foule tout à l’heure et quelqu’un vous a signalée à mon attention comme étant Mme la duchesse de Fontsomme. Je serais désespéré de faire erreur car je serais alors impardonnable…
— On ne vous a pas trompé, monsieur. Je suis bien celle que l’on vous a dit mais… puis-je savoir en quoi je vous intéresse ?
— J’aimerais obtenir de vous un instant d’entretien. J’avais pensé me présenter à votre hôtel mais vous n’y êtes pas souvent et vous me pardonnerez, j’espère, d’avoir saisi l’occasion.
— Qu’avez-vous donc de si important à me dire, monsieur ? Vous comprendrez sans peine que je ne puisse m’arrêter plus longtemps ni retenir au seuil du palais les dames qui m’attendent ?
— Pas ici, sans doute, mais j’ai eu, madame la duchesse, l’honneur de vous demander un entretien…
— Soit. Eh bien, puisque vous connaissez mon hôtel, soyez-y demain vers six heures du soir. Je ne serai pas de service. Mais… auparavant, me confierez-vous votre nom ?
L’inconnu balaya le sol des plumes fatiguées de son chapeau :
— Acceptez mes excuses ! J’aurais dû commencer par là ! Je me nomme Saint-Rémy, Fulgent de Saint-Rémy et je viens des Îles. J’ajoute que nous sommes un peu parents…
Ces derniers mots trottèrent longtemps dans la tête de Sylvie tandis qu’elle gagnait l’appartement de la Reine avec ses compagnes. Ils en furent chassés par ce qu’elles y trouvèrent : la duchesse de Béthune, provisoirement en bon état – les apothicaires parisiens n’avaient pas de meilleure cliente ! –, venait d’arriver pour prendre le service que Mme de Fontsomme assumait depuis le mariage. Elle avait commencé par vouloir inspecter la garde-robe de Marie-Thérèse ainsi que ses bijoux, mais elle comptait sans Maria Molina qui, flanquée des autres femmes espagnoles, de Nabo et de Chica, ne l’entendait pas de cette oreille et prétendait tout simplement la mettre à la porte. En fait de dame d’atour, Molina ne connaissait que « Mme de Fontsomme » et ne comprenait pas ce que cette intruse venait faire ici, pourquoi elle tripotait des bijoux dont la conservation ne relevait pas d’ailleurs de la dame d’atour mais du garde du cabinet. Comme elles employaient toutes deux une langue différente, la compréhension n’était pas au rendez-vous et le combat semblait d’autant plus chaud.
Mme de Motteville et Sylvie se jetèrent dans la bataille oratoire qui sans elles serait peut-être allée plus loin, Molina se montrant facilement agressive dès qu’il s’agissait de « son Infante » et Mme de Béthune possédant un caractère difficile. Née Charlotte Séguier et fille du Chancelier – le potentat doré de tout à l’heure ! – elle en avait hérité l’arrogance et se croyait, selon l’expression de Mme de Motteville qui ne l’aimait pas, « plus duchesse que toutes les autres ».
Lorsque le calme revint, le ressentiment de Mme de Béthune ne fut pas apaisé pour autant. Avec une parfaite injustice il alla tout entier à « Mme de Fontsomme qui aurait dû, dès l’arrivée de l’Infante en France, apprendre à ses domestiques le nom de la véritable dame d’atour et non s’installer dans la fonction comme si elle n’en était pas simplement suppléante ». Le tout sur un ton cassant qui exaspéra Sylvie.
— Et pourquoi pas les inciter à vous héberger chaque soir dans leurs prières ? riposta-t-elle. Si vous étiez venue à Saint-Jean-de-Luz comme vous en aviez le devoir, je n’aurais pas eu besoin de vous remplacer…
— Me sachant souffrante, vous auriez dû venir m’en demander permission avant de partir !
— Vous demander permission quand j’avais reçu, du Roi lui-même, l’ordre d’être présente là-bas ? Mais vous rêvez, madame !
— Entre gens de bonne compagnie, c’est ainsi que les choses se passent, ou se devraient passer.
— Vous vous en expliquerez avec Leurs Majestés.
— Je n’y manquerai pas, soyez-en sûre. L’étiquette…
— … n’a rien à voir avec vos états d’âme, coupa Suzanne de Navailles impatientée. En tout cas, vous devriez y regarder à deux fois avant d’importuner Leurs Majestés. La Reine aime beaucoup Mme de Fontsomme avec qui elle peut parler sa langue natale. Ce qui n’est pas votre cas. Quant au Roi qu’elle a jadis initié à la guitare, il a pour elle plus que du respect…
Lorsque Marie-Thérèse arriva, recrue de fatigue après cette longue journée de représentation sous un soleil ardent, ses femmes s’empressèrent autour d’elle pour la libérer de ses lourds vêtements de parade mais, quand Molina voulut défaire la coiffure, Mme de Béthune s’interposa :
— C’est à la dame d’atour d’accomplir cette fonction.
Et elle repoussa Molina pour s’emparer de la Reine que l’on avait enveloppée d’un peignoir de fine batiste. Mais n’est pas coiffeuse qui veut et, au bout de quelques instants, il fut évident qu’en ôtant les fils de perles ou les pierres isolées, elle tirait copieusement les cheveux de sa patiente qui cependant ne disait rien, subissant son supplice avec une douceur exemplaire. Mme de Navailles, elle, ne le supporta pas longtemps :
— Tudieu, madame, quelle maladroite vous faites ! Laissez ces soins à qui en est capable.
— La Reine ne se plaint pas, que je sache !
— Non, coupa une voix autoritaire, parce qu’elle est la bonté même et qu’elle doit considérer cela comme une pénitence à offrir au Seigneur ! Retirez-vous, madame de Béthune, et laissez faire Molina !
Flanquée de l’indispensable Motteville, la Reine Mère venait de faire son entrée chez sa belle-fille, imposante et majestueuse à son habitude, et devant elle toutes les dames plièrent le genou. Elle leur sourit, mais n’en avait pas fini avec Mme de Béthune qu’elle n’était pas fâchée de pouvoir tancer : n’était-elle pas la fille de ce Séguier qui, au temps de ses épreuves, avait poussé l’audace jusqu’à porter la main sur elle pour s’emparer d’une lettre[59] ? Une offense que la fière Espagnole n’avait jamais pardonnée. Or Mme de Béthune ressemblait beaucoup à son père.
— Il vous plaît, apparemment, de remplir votre office quand il vous chante ! On ne vous a pas vue depuis des semaines et vous reparaissez tout à coup au moment où l’on s’y attend le moins pour troubler l’harmonie du service de la Reine. N’est-ce pas un peu cavalier ?
Frémissante de colère mais matée, la duchesse s’excusa sur sa mauvaise santé et les douleurs qui ne lui avaient pas permis de se joindre aux autres dames pour être présentée au moment du mariage. Elle était désolée d’avoir manqué si fort…
— Manqué ? Mais vous n’avez manqué à personne. Vous savez bien que vous devez votre charge à l’insistance de M. le Cardinal qui souhaitait obliger M. le Chancelier… À présent le sujet est clos. Mesdames, ajouta-t-elle en haussant le ton, j’ai une grande nouvelle à vous apprendre : Sa Majesté la reine douairière d’Angleterre, ma sœur, nous a fait la grâce d’accorder à mon fils Philippe la main de sa fille Henriette. Toutes deux vont repartir prochainement pour Londres afin d’obtenir l’agrément du roi Charles II qui ne fait aucun doute. Pendant ce temps, nous veillerons à la composition de la maison de la future duchesse d’Orléans… Allons, du calme ! dit-elle en riant. La nouvelle n’est pas si nouvelle et vous vous en doutiez bien un peu ?
Le bruit, en effet, s’en était glissé dans les salons depuis le retour de la Cour. Mazarin poussait le projet avec d’autant plus d’enthousiasme que ce mariage serait pour lui un excellent moyen de faire sa paix avec le jeune Charles II auquel il avait si souvent refusé des secours pour ne pas compromettre son entente avec Cromwell et dont le soudain retour sur le trône lui posait quelques problèmes.
Anne d’Autriche laissa le léger brouhaha s’apaiser, puis, s’approchant de Sylvie tout en gardant l’œil sur la dame d’atour :
— Quel âge a votre fille Marie, madame de Fontsomme ?
— Quatorze ans, Votre Majesté.
— Elle en aura donc quinze l’an prochain lorsque les noces auront lieu. L’âge que vous aviez vous-même, ma chère Sylvie, lorsque vous vîntes me servir… avec tant de dévouement ! Aussi sa place me semble tout indiquée chez les filles d’honneur de la nouvelle Madame. La dernière fois que je la vis, elle promettait d’être jolie et Monsieur tient beaucoup à ce que sa cour se compose uniquement d’êtres jeunes et beaux.
C’était une faveur extrême que cette nomination avant toutes les autres et, en plongeant dans sa révérence pour remercier, Sylvie la ressentit comme telle. Sans pour autant en éprouver beaucoup de joie. De la crainte plutôt : elle ignorait de quoi serait faite cette nouvelle cour, brillante sans doute si l’on s’en tenait aux goûts somptuaires et raffinés du jeune Monsieur, mais peut-être encore moins sage que ne l’était celle du Louvre quand elle-même y était entrée. Marie n’était ni faible ni peureuse. Elle possédait, comme l’on dit, un caractère et elle ne rêvait que de briller dans le monde. Elle serait sans doute ravie mais sa mère savait que c’en serait fini de sa tranquillité à elle. D’autant que ce jour si glorieux venait de lui donner une ennemie. Il n’y avait pas à se tromper sur le regard venimeux que coulait vers elle la dame d’atour en titre.
Du coup, elle eut ce soir-là toutes les peines du monde à s’endormir en dépit des paroles apaisantes prodiguées par Perceval lorsqu’il l’avait vue revenir visiblement troublée.
— Ne vous tourmentez donc pas pour un événement qui se produira dans un an. À chaque jour suffit sa peine…
— Justement ! En dehors de Marie il y a ce personnage, M. de Saint-Rémy, dont je voudrais savoir ce qu’il me veut.
— Ce qu’il « nous » veut ! Vous pensez bien que je serai là. En attendant, essayez de vous reposer. Moi je sors !
— Où allez-vous ?
— À Saint-Mandé, demander à souper à notre ami Fouquet. Vous savez qu’il a des intérêts dans les Îles. Il saura peut-être me dire d’où vient le personnage.
Ainsi qu’il en avait gardé l’habitude, Perceval, dédaignant les voitures, partit à cheval – il disait qu’avec un cheval on passait partout et que cela allait plus vite ! – mais revint plus tôt qu’on ne l’attendait : le charmant château de Saint-Mandé où Fouquet aimait travailler et réunir son petit groupe d’artistes, écrivains et néanmoins fidèles amis, était à peu près vide ce soir-là. Perceval n’y trouva que le poète Jean de La Fontaine qui rêvassait sous son cèdre favori en buvant le vin de Joigny que Vatel, le maître queux du Surintendant, faisait venir pour lui. Toujours aimable, il en offrit un verre au visiteur mais fut incapable de lui apprendre où se trouvait Fouquet. Une seule chose était sûre : ce soir on souperait sans lui. Le chevalier de Raguenel déclina l’invitation. Il allait repartir en priant La Fontaine de l’annoncer pour le lendemain, quand l’abbé Basile fit son apparition. Ce qui était presque aussi bien que le maître des lieux car Basile, le mauvais sujet de la famille, était à la fois le jeune frère et l’homme à tout faire de Fouquet.
Un curieux homme, cet abbé commendataire de Saint-Martin de Tours qui n’avait jamais reçu les ordres, ce qui valait mieux pour l’Église ! Intrigant, jouisseur, brave comme l’épée qui ne le quittait guère et presque aussi intelligent que son aîné, rusé comme un renard et volontiers brouillon, il s’était épanoui comme une fleur au soleil dans le tumulte de la Fronde tout en faisant preuve d’une certaine suite dans les idées en servant fidèlement Mazarin – et son frère bien sûr ! – depuis onze ans. Joyeux viveur au demeurant et volontiers touche-à-tout, il écouta ce que Perceval avait à dire avec l’attention méritée par un homme appartenant à une famille riche et bien en cour.
— Saint-Rémy, dites-vous ? Cela devrait être aisé à trouver. Les Français ne pullulent pas vraiment sur les îles d’Amérique. Il est possible que cet homme en vienne : je sais qu’un navire a touché terre, ces jours derniers, à Nantes : il faut savoir s’il était dessus et je ne manquerai pas de me renseigner.
Et comme Perceval un peu remonté le remerciait, il ajouta :
— Un sourire de Mme la duchesse de Fontsomme sera ma meilleure récompense. Voilà des années que je suis à ses pieds mais elle n’a jamais eu l’air de s’en apercevoir. Il est vrai que derrière Nicolas, on ne me voit plus !
— Au fait, sauriez-vous où il est ?
— À Charenton, chez Mme du Plessis-Bellière où il s’est réfugié tout à l’heure pour chercher un peu d’air frais. Il étouffait de rage en sortant de chez M. le Cardinal qui, tout mal en point qu’il est, ne cesse de le harceler pour obtenir les intérêts des sommes qui lui ont été confisquées pendant la Fronde.

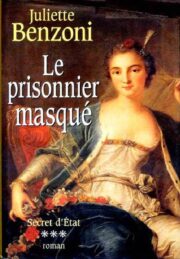
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.