— Tu ne l’aimes pas beaucoup, on dirait ?
— Je ne l’aime pas du tout, et ne me faites pas de contes, elle vous déplaît autant qu’à moi.
— C’est vrai. Elle est charmante pourtant ! Jolie, gracieuse et obligeante. Toujours prête à rendre service…
— Trop ! Beaucoup trop ! Si vous voulez m’en croire, moins vous la verrez et mieux vous vous porterez !
Sylvie ne répondit pas. Depuis qu’un jour, sur le chemin de l’église, elle l’avait payée de l’aide apportée à Beaufort en présentant la jeune femme à la Reine, elle s’était efforcée de ne pas développer davantage leurs relations parce qu’elle n’arrivait pas à éprouver de la sympathie pour la marquise. Peut-être à cause de cette avidité à fleur de peau qu’elle avait découverte. En outre, sa réputation, encore intacte au moment où toutes deux étaient entrées en relations, se dégradait avec une curieuse rapidité. Mme de Brinvilliers affichait sa liaison avec un certain chevalier de Sainte-Croix qui se disait alchimiste. Le mari, quant à lui, ne cachait pas davantage ses relations avec une certaine personne, et les échos des colères du Lieutenant civil Dreux d’Aubray, père de la marquise, débordaient de beaucoup les limites de la rue Neuve-Saint-Paul.
Perceval qui entretenait toujours de bonnes relations avec ceux de la Gazette – le fils de Théophraste Renaudot et son petit-fils, l’abbé, qui s’intéressait beaucoup aux nouvelles – prétendait même qu’il lui arrivait de fréquenter les tavernes et qu’elle buvait de façon immodérée. Aussi déconseillait-il fortement à Sylvie de poursuivre des relations qui ne lui apporteraient rien de bon. Dans les premiers temps, celle-ci avait résisté : ne devait-elle pas quelque chose à la marquise pour avoir aidé François à sauver Philippe ?
— Votre dette est payée, rétorqua-t-il. En outre, cette femme œuvrait surtout pour son propre compte : souvenez-vous qu’elle voulait écarter à tout prix du chemin de son père l’encore trop belle Mme de La Bazinière. Quand le destin a placé le duc de Beaufort sur son chemin, elle a sauté sur l’occasion : obliger un prince du sang, même bâtard, est une aubaine que l’on ne trouve pas à tous les coins de rue…
Avec le temps, Sylvie avait fini par admettre qu’il avait raison et s’était efforcée de tenir à distance la remuante marquise après l’avoir accompagnée à deux reprises dans ses visites aux malades de l’Hôtel-Dieu. Elle avait pourtant été sensible à la douceur, la gentillesse et la générosité avec lesquelles la jeune femme se penchait sur les plus misérables. Celle-ci était trop fine pour ne pas s’en être aperçue, et c’était le plus souvent pour obtenir sa compagnie dans ces occasions qu’elle venait la chercher.
— J’espère, conclut Jeannette, qu’elle finira par comprendre. En ce qui me concerne, vous ne serez plus jamais là pour elle…
Sylvie se contenta de lui sourire en guise de consolation puis remonta dans sa chambre. Elle voulait écrire à la marraine de Marie, la chère Hautefort (elle n’avait jamais vraiment réussi à s’habituer au nom germanique de Schomberg) afin de lui raconter ce qui venait de se passer. À travers le temps, l’amitié des deux femmes gardait toute sa force, toute sa chaleur, et Sylvie aimait toujours autant confier ses soucis à cette autre Marie. Elle était de si bon conseil !
Une heure plus tard, un courrier à cheval partait pour Nanteuil tandis que Mme de Fontsomme rejoignait au Louvre la reine Marie-Thérèse dont l’attitude, en ces heures graves, l’émouvait : la Reine consacrait à sa belle-mère tout le temps qu’elle ne passait pas en prières dans son oratoire ou à l’église. On sentait qu’elle voulait entourer la malade d’une vraie tendresse et jouir de sa présence tant que Dieu l’autoriserait. C’était très touchant…
CHAPITRE 9
LA DISGRÂCE
Attendue avec une extrême impatience, la première lettre de Perceval mit longtemps à venir, au point que Sylvie se demandait si quelque mésaventure, quelque accident ou quelque mauvaise rencontre ne lui était advenu. Le contenu la rassura tout en lui fournissant l’explication de ce long silence : le cher homme ne voulait pas écrire tant qu’il ignorait où se trouvait au juste la fugitive.
Tout d’abord, espérant vaguement que, pour mieux brouiller les pistes, Marie s’était tout platement embarquée sous un déguisement dans le coche de Lyon, relayé ensuite par celui de Marseille, d’Aix, etc., il avait vite perdu cet espoir, le coche ayant été rattrapé par lui au deuxième relais. Et tout au long de la route, il s’était inquiété d’une jeune dame voyageant en « chaise », en carrosse, ou même par les voies fluviales : sachant qu’elle trouverait Beaufort à Toulon, Marie n’était pas autrement pressée. Pas un instant, il n’avait imaginé que courait devant lui, avec une avance de dix heures, un jeune et audacieux cavalier…
— Ces hommes sont inouïs ! remarqua Mme de Schomberg qui avait rejoint son amie dès le reçu de sa lettre et s’était installée rue Quincampoix pour lui tenir compagnie. Il ne leur viendrait pas à l’idée qu’une fille avide de gloire et d’éclat comme ma filleule, nourrie de romans chevaleresques, puisse souhaiter se conduire comme l’une de leurs héroïnes ! Et celui-là est peut-être le plus intelligent que je connaisse ! Que dit-il encore ? Il doit y avoir mille choses passionnantes dans cette longue lettre.
Il y en avait. D’abord, le récit des mésaventures du voyageur dont la chaise – décidément ce genre de véhicule n’était pas encore au point ! – avait brisé un essieu dans une profonde ornière aux environs de Mâcon, l’obligeant à se procurer un véhicule moins rapide mais plus solide. Pas question de continuer à cheval à cause d’un tour de rein, récolté dans l’accident. Marie était donc à Toulon depuis deux ou trois jours quand Perceval encore douloureux y parvint et, apparemment, elle n’y avait pas perdu son temps. À peine arrivé, Perceval se fit porter à l’Arsenal dont Beaufort ne sortait guère ; celui-ci remâchait encore la violente colère qui le secouait depuis vingt-quatre heures. L’accueil que reçut de lui Perceval de Raguenel s’en ressentit :
— Ah, vous voilà, vous aussi ? Une réunion de famille en quelque sorte ? aboya-t-il. Je suppose que Mme de Fontsomme vous suit de près ?
Mais Perceval n’était pas homme à se laisser impressionner par le tonnerre de cette bouche à feu humaine qu’il connaissait depuis la petite enfance.
— Mme de Fontsomme est à Paris, fort inquiète et fort affligée, monseigneur. Elle m’a confié une lettre que…
— Donnez !
Le messager s’exécuta sans autre commentaire mais suivit avec intérêt sur le visage du duc le cours changeant des sentiments. De la colère, Beaufort passa au sourire, puis à la tristesse et, finalement, retrouva sa fureur intacte :
— Sa bénédiction ! gronda-t-il en froissant le papier dans ses grandes mains nerveuses. Elle m’envoie sa bénédiction ! Elle veut, elle aussi, que j’épouse cette folle ! Alors qu’elle sait combien je l’aime, elle !…
— Et vous n’avez pas le droit de douter de son amour. Seulement… c’est une mère, et pour le bonheur de sa fille elle est prête à tous les sacrifices…
— Pas moi ! Et pourtant, il va bien falloir m’y résoudre.
— Vous allez… épouser Marie ? émit, sur le mode prudent, Raguenel un peu surpris tout de même de la rapidité avec laquelle la jeune fille semblait avoir eu gain de cause.
— Oh, ce n’est pas pour tout de suite !… Mais j’ai dû donner ma parole de gentilhomme. Vous n’imaginez certainement pas la scène que j’ai vécue hier, ici même !
La veille au soir, alors que Beaufort revenait des chantiers où il surveillait la construction d’un vaisseau et la remise en état de six autres, il avait reçu la visite du « chevalier de Fontsomme ». Il fallait bien donner un nom pour passer les divers factionnaires commis à la garde du vieil arsenal jadis construit par Henri IV et où, de ce fait, Beaufort se sentait chez lui. Découvrir Marie sous ce déguisement masculin avait été une surprise pour le duc, moins tout de même que l’étrange lumière intérieure qui émanait d’elle.
— Je suis venue vous redire que je vous aime, déclara-t-elle d’emblée – et, comme à peine remis du choc il protestait avec quelque énergie, elle reprit : Il n’est pas question d’échanger ici des raisonnements ou d’essuyer des faux-fuyants, j’ajoute que je suis déterminée à devenir votre épouse…
— J’ai voulu, alors, reprit François, prendre cette incroyable déclaration sur le ton de la plaisanterie mais elle ne plaisantait pas. Sa figure était si grave qu’elle m’impressionnait. Elle a tiré de sa ceinture un stylet dont elle a placé la pointe contre sa gorge, disant que si je ne promettais pas immédiatement d’en faire ma femme, elle se tuait devant moi. Nous étions seuls car elle avait demandé à m’entretenir sans témoins pour « affaire d’importance ». Aucun secours ne pouvait me venir. Je n’avais plus la moindre envie de rire car je lisais dans ses yeux une horrible détermination : « Vous n’avez que dix secondes, ajouta-t-elle encore. Jurez sinon… » Pour mieux me convaincre, elle enfonça légèrement la pointe acérée et un peu de sang perla. Comprenant qu’elle irait jusqu’au bout de son projet, j’étais affolé. Elle se mit à compter : un… deux… trois… quatre… cinq… six… À sept j’ai rendu les armes… et juré de l’épouser ainsi qu’elle l’exigeait. Alors, elle a souri et remis le poignard dans sa gaine en disant qu’elle avait confiance en moi et que jamais je ne regretterais d’avoir accepté parce qu’elle ferait tout au monde pour me rendre heureux « … à commencer par vous donner des enfants, ce que ma mère ne saurait plus faire ». C’était une phrase de trop : en acceptant, c’était à Sylvie que je pensais, Sylvie qui me haïrait pour l’éternité si sa fille se donnait la mort devant moi. Je lui ai fait entendre que le mariage n’était pas pour demain, qu’il ne pouvait en être question avant la campagne que je vais mener contre le reis Barbier Hassan, ce renégat portugais qui est l’amiral d’Alger ; en conséquence elle pouvait rentrer chez elle. Elle a refusé, prétextant qu’elle ne rentrerait que mariée, dût-elle rester ici un an ou deux. Je lui ai rappelé alors qu’il fallait aussi obtenir la permission du Roi et celle de ses parents : sa mère, son frère qui est à présent le chef de la famille, mais elle a souri, sachant bien que Philippe serait heureux que je devienne son beau-frère. Il n’y aurait d’ailleurs pas longtemps à attendre pour le savoir : simplement jusqu’à son retour de Saint-Mandrier où je l’avais envoyé inspecter une fortification. Voilà où j’en suis, mon cher Raguenel. Avouez que je me suis bien fait prendre au piège. Un vrai benêt !
— Vous pouviez difficilement agir autrement. Je savais Marie capable d’une grande détermination, mais à ce point !… Son excuse est qu’elle vous aime depuis toujours, je crois. Peut-être autant que Sylvie elle-même…
— Sylvie ! dit Beaufort avec un accent douloureux. Pensez-vous qu’il me réjouisse de faire d’elle ma belle-mère quand je rêvais d’en faire ma duchesse ?
— Je pense qu’il faut laisser le temps au temps… que vous avez eu raison de mettre en avant les délais imposés par les circonstances. Mais… pouvez-vous me dire où se trouve Marie en ce moment ?
— À Solliès – c’est à trois lieues d’ici environ – chez la marquise de Forbin. Elle est, vous le savez peut-être, la mère de Mme de Rascas, la belle Lucrèce qui est la maîtresse de mon frère Mercœur et pour laquelle il fait construire à Aix ce qu’il appelle le pavillon Vendôme. C’est aussi pour moi une amie et je lui ai confié Marie, sans dire qu’elle est ma… fiancée puisqu’il paraît qu’elle l’est. J’ai exigé que, jusqu’à nouvel ordre, tout cela demeure secret…
— Sage précaution ! Peut-être arriverons-nous un jour à obtenir de Marie qu’elle vous rende votre parole ?
— Ne rêvez pas… Vous ne l’avez pas vue comme moi je l’ai vue…
La lettre s’achevait sur un récit succinct de l’entrevue que le chevalier de Raguenel avait eue avec Marie au château de Solliès et par l’annonce de son prochain retour. De toute évidence, la rencontre ne s’était pas bien passée et Perceval préférait attendre d’être en face de Sylvie pour en donner les détails. À moins qu’il préfère ne rien dire du tout. C’est du moins ce que pensait Mme de Schomberg :
— Pour qui sait lire entre les lignes il est très mécontent. J’avoue que je le suis aussi. Je n’aurais jamais cru ma filleule, que j’aime tendrement, capable de telles actions. Sa fugue m’amusait plutôt, je ne vous le cache pas, Sylvie, mais cette scène grandiloquente, cette façon d’obliger un homme à lui engager sa foi sous la menace du suicide me choque profondément. C’est d’un… commun !

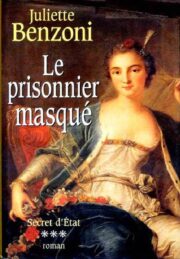
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.