— Oh c’est un peu ma faute ! soupira Sylvie. J’ai méconnu l’ardeur et la solidité de son amour pour François parce que je n’imaginais pas qu’il pût la conduire à de tels excès…
— Le malheur c’est que l’on ne connaît pas vraiment ses enfants. Parce qu’on leur a donné la vie, on doit penser qu’ils vous ressembleront en toutes choses, mais il y a derrière nous, derrière eux, des siècles d’ancêtres qui ont leur mot à dire. L’amour mis à part, les enfants restent des inconnus pour leurs parents… puisque l’amour est aveugle. Ce que vous vivez en ce moment, mon amie, me console de n’en point avoir…
Sylvie fit deux ou trois tours dans la pièce, redressant une fleur, maniant un livre aussitôt reposé, occupant ses mains pour tenter de dissimuler sa nervosité.
— Je me demande, s’interrogea-t-elle enfin, ce que Philippe pense de tout cela ? Mon parrain n’en parle pas.
— Peut-être parce qu’il n’en a rien à dire…
En réalité, Philippe était trop désorienté pour avoir une opinion précise. Le poids des nouvelles qui lui tombèrent dessus, à son retour d’inspection, l’étourdit un peu. L’arrivée de sa sœur, son installation chez Mme de Forbin-Solliès et l’entretien en tête à tête où Beaufort lui demanda la main de Marie, en spécifiant bien qu’il ne pouvait être question, en aucun cas, d’ébruiter la nouvelle, puis la longue promenade qu’il fit le long du port avec Perceval et, enfin, sa visite au château de Solliès dont il était un habitué, le plongèrent dans un abîme de réflexions où se bousculaient des questions sans réponses du genre de celle-ci : pourquoi un événement aussi heureux qu’un mariage entre gens qui s’aiment devrait-il être tenu secret ? Ou encore : pourquoi l’humeur de son chef bien-aimé, toujours si joyeuse depuis leur retour à Toulon, était-elle devenue détestable ? Enfin, pourquoi Marie, à la conduite de laquelle il ne comprenait pas grand-chose, semblait-elle vouloir effacer jusqu’au souvenir de leur mère ? Et pourquoi refusait-elle de rentrer auprès de Madame qu’elle aimait tant ?
L’abbé de Résigny, resté son confident le plus intime, lui conseilla sagement de rester à l’écart et de ne pas essayer de pénétrer les arcanes compliqués d’un cœur de jeune fille. La lettre de quinzaine que celui-ci adressait avec beaucoup de régularité à Mme de Fontsomme reflétait à la fois l’état d’esprit du jeune homme et les conseils qu’il lui prodiguait en duo avec Perceval.
Enfin, l’escadre quitta Toulon pour courir sus aux Barbaresques et Perceval de Raguenel reprit le chemin de Paris après une dernière entrevue avec Marie. Il avait le cœur lourd. Jusqu’à la dernière minute il avait espéré emporter un mot de tendresse pour Sylvie, mais, sûre désormais de la parole extorquée à Beaufort, plus sûre encore d’elle-même, de sa jeunesse, de sa beauté et d’une victoire finale qui chasserait enfin sa mère des pensées de son « fiancé », la jeune fille s’était contentée de lui déclarer :
— Dites-lui que je suis heureuse et que j’espère l’être davantage. Je lui suis reconnaissante d’avoir écrit son consentement à ce mariage que je désire tant. Peut-être nous aidera-t-elle à obtenir celui du Roi ?
— Je ne le lui conseillerai pas. Nul ne peut se permettre de tenter d’influencer une décision du Roi. Surtout en ce qui concerne le duc de Beaufort qu’il n’aime guère. Que ferez-vous s’il refuse ?
— Nous pourrons toujours nous marier secrètement. Comprenez donc, à la fin, que ce que je veux c’est être à lui, et que s’il fallait vivre l’exil cela ne me ferait pas peur puisque je serais avec lui…
Qu’ajouter à cela ? Perceval rejoignit Sylvie à laquelle il fit un rapport aussi complet que possible. Elle l’écouta sans rien dire puis, quand ce fut fini, elle demanda seulement :
— Dites-moi au moins comment est cette dame de Forbin ? Pensez-vous que Marie se trouve bien chez elle ?
— Oh, à merveille ! ricana Perceval. La marquise possède toutes les qualités d’une grande dame jointe aux grâces d’une femme aimable, cultivée et pleine de générosité, et nous pouvons remercier Dieu que cette folle lui soit confiée. Nous n’aurions pu espérer mieux et je la crois pleine de compréhension car, au moment où j’allais la saluer après avoir dit adieu à Marie, elle a murmuré : « Dites à Mme la duchesse de Fontsomme que je ferai en sorte qu’elle n’ait aucun reproche à m’adresser au jour où j’aurai l’honneur d’être en sa compagnie… »
Sylvie ferma les yeux pour mieux apprécier le poids d’angoisse qui se retirait d’elle. Sachant cette dame une amie de François et se souvenant trop bien de son expérience dans la demeure de Catherine de Gondi, à Belle-Isle, elle avait craint que Mme de Forbin-Solliès fût une ancienne maîtresse ou une amoureuse déçue. Il s’entendait si mal à juger les femmes ! Ce qui n’était pas le cas de Perceval. Aussi exhala-t-elle un long soupir, rouvrit les yeux et sourit au visage las de son vieil ami :
— Vous auriez dû commencer par me dire cela. Je n’ai guère confiance dans les « amies » de Monseigneur ! Eh bien, en ce cas, il ne nous reste plus qu’à attendre des nouvelles…
— Je peux déjà vous en donner de fraîches, dit Perceval en ouvrant son justaucorps pour en tirer une lettre. Avant de s’embarquer, le duc m’a donné ceci pour vous…
— J’espérais un peu qu’il répondrait à ma lettre. Voyons ce qu’il écrit, ajouta-t-elle en faisant sauter le cachet de cire rouge et en dépliant le papier sur lequel s’étalait la pittoresque écriture de François – au large car il n’y avait que peu de mots, mais ils lui firent à la fois froid dans le dos et chaud au cœur :
« J’épouserai puisque l’on m’y oblige, écrivait François, mais on ne me contraindra qu’à un mariage secret… et blanc. Je ne toucherai jamais à votre fille parce que je n’aimerai jamais que vous… »
Elle voulut offrir le billet à Perceval pour qu’il en prît connaissance mais il le refusa, disant qu’il en savait déjà le contenu.
— Eh bien, demanda Sylvie, comment croyez-vous que Marie recevra cette dernière disposition ? Nous allons au-devant d’un autre drame…
— Je ne crois pas. Ce qui compte pour elle c’est qu’il lui passe la bague au doigt. Vous n’imaginez pas sa confiance en elle. Elle se fait fort de l’amener une nuit ou l’autre là où elle le veut. Non sans raison, peut-être, elle pense qu’elle a toute la vie devant elle…
— Elle n’a pas tort… et puis elle est si belle ! Il n’est, après tout, qu’un homme…
Les mois qui suivirent furent sans doute les plus tristes que vécut la Cour, partagée entre la lente agonie de la Reine Mère et l’étalage que faisait Louis XIV de sa passion pour La Vallière. On sentait qu’en dépit des témoignages d’amour qu’il ne cessait de donner à celle qui allait partir, en dépit de ses larmes fréquentes, le jeune Roi piaffait d’impatience de ne pouvoir entourer sa favorite – un terme que l’on n’avait pas employé depuis bien longtemps ! – de l’éclat des fêtes et de la caresse des violons. En mai se plaça d’ailleurs un épisode pénible. Lorsque Anne d’Autriche rédigea son testament et indiqua comment s’effectuerait entre ses enfants le partage de ses joyaux, Louis XIV insista d’indécente façon pour que sa mère lui lègue les grosses perles qui faisaient son admiration depuis l’enfance. La passion du Roi pour les pierres précieuses et les magnifiques joyaux commençait à être bien connue, et il ne supportait pas l’idée que ces perles exceptionnelles aillent à la petite Marie-Louise, la fille de Monsieur. Il finit par les avoir en les payant. Anne d’Autriche, alors, offrit à son fils cadet les fameux ferrets de diamants qui étaient peut-être son plus cher souvenir. Il les reçut en pleurant.
Durant tout ce temps, Philippe d’Orléans se montra un fils parfait, plein à la fois de douleur, de tendresse et de compassion. Lorsque sa mère fut ramenée du Val-de-Grâce au Louvre, il ne la quitta presque plus, se faisant son compagnon de tous les jours, son infirmier et presque son directeur de conscience. Un jour, voyant la terrible douleur crisper le visage émacié mais encore si beau, il s’écria :
— Je voudrais que Dieu m’accorde de supporter la moitié de vos souffrances !
Alors elle répondit :
— Ce ne serait pas juste. Dieu veut que je fasse pénitence…
La reine Marie-Thérèse, elle aussi, se vouait sans compter au service de celle en qui elle avait trouvé une seconde mère. Sylvie et Molina l’accompagnaient, car la Reine Mère aimait à présent entendre autour d’elle parler la langue de son enfance, et la première passait de longues heures en compagnie de son amie Motteville. Parfois, la malade demandait à son ancienne fille d’honneur de chanter pour elle comme autrefois, en ces temps si difficiles qu’elle comptait à présent au nombre des jours heureux. Alors, Mme de Fontsomme prenait la guitare et, le temps d’une chanson, redevenait le « petit chat » d’autrefois. Pendant ce temps le ventre de La Vallière s’arrondissait pour la troisième fois…
Les seules bonnes nouvelles de ces jours douloureux vinrent de la Méditerranée où Beaufort faisait merveille. Par deux fois, il porta aux pirates infidèles des coups sensibles : d’abord en forçant, dans le port de La Goulette, le vieux Barbier Hassan qui fut tué au début de la bataille et perdit cinq cents de ses hommes tandis que les canons des vaisseaux du Roi pilonnaient Tunis. Trois navires tombèrent aux mains des Français. La seconde fois, après un court passage à Toulon pour réparer ce qui pouvait l’être et prendre des unités intactes, Beaufort et les siens portèrent le fer et le feu dans le port barbaresque de Cherchell, incendièrent deux vaisseaux et en capturèrent trois. Les étendards des vaincus envoyés à Paris furent portés à Notre-Dame et accrochés aux voûtes séculaires pour le triomphant Te Deum du 21 octobre. Et la ville capitale chanta avec enthousiasme la gloire de celui en qui elle verrait toujours le Roi des Halles. Le lendemain, le père de son héros, César de Bourbon duc de Vendôme et amiral en titre, mourait dans son hôtel du faubourg Saint-Honoré.
Il avait soixante et onze ans et les maladies, fruits d’une vie de débauche, rongeaient ce grand corps taillé pour en vivre cent. La goutte, la gravelle et aussi la syphilis le consumaient au milieu de grandes douleurs qu’il s’efforçait d’apaiser en faisant appel à tous les remèdes que pouvaient offrir, non les médecins qu’il considérait comme des ânes, mais les cueilleurs de simples et rebouteux de campagne. Ses derniers mois, il les passa en compagnie de sa femme dans les châteaux qu’il aimait tant : Anet, Chenonceau et surtout Vendôme, son duché qu’il s’efforçait d’embellir et de mieux aménager. On le voyait parfois à Montoire ; il y possédait une petite maison où il se trouvait bien et qui le reposait des fastes de ses autres demeures. Le grand pécheur se repentait et trouvait un peu de douceur auprès de la fidèle épouse qui n’avait jamais cessé de l’aimer et qui, peu à peu, le ramenait vers Dieu.
Vers la fin du mois de septembre, sentant un mieux qu’il devait au remède d’un empirique de Montoire, il se fit ramener à Paris afin d’y être plus près de ces grandes nouvelles qui annonçaient la gloire de son fils cadet, mais les souffrances le rattrapèrent vite et son agonie allait durer trois semaines. Cependant, quelques jours avant de quitter ce monde, il fit demander à Sylvie de venir le voir. Elle s’y rendit sans hésiter.
En pénétrant dans la chambre somptueuse qu’elle avait vue tant de fois dans son enfance, elle fut saisie à la gorge par l’odeur terrible de la maladie, mal combattue par celle de l’encens que l’on brûlait dans l’espoir que ce pansement des âmes apaiserait aussi le corps. La duchesse Françoise était là, en compagnie d’un capucin priant au pied du lit. Les deux femmes s’embrassèrent avec la chaleur des anciennes tendresses, puis Mme de Vendôme murmura :
— Le bon père et moi allons vous laisser avec lui. Il veut vous parler…
Et Sylvie resta seule avec cet homme qui avait permis qu’elle eût une enfance heureuse mais qui, ensuite, lui avait fait tant de mal… Elle s’approcha du lit que l’on venait de refaire sans doute, car il était aussi lisse et net qu’un lit de parade, regarda cette forme émaciée, jaunie et presque chauve qui avait été l’un des plus beaux hommes de son temps. Il semblait dormir et elle hésita sur ce qu’elle devait faire. Soudain, les terribles yeux bleus à peine pâlis s’ouvrirent d’un seul coup et se tournèrent vers elle :
— Vous êtes venue…
— C’est l’évidence, il me semble…
— Pourquoi ? Pour voir en quel état l’approche de la mort réduit votre plus vieil ennemi ?
— Vous n’êtes pas mon plus vieil ennemi. Celui-là, c’est l’homme qui a assassiné ma mère. À ce moment-là c’est vous, souvenez-vous-en, qui m’avez donné les moyens de continuer à vivre à l’abri de vos châteaux.

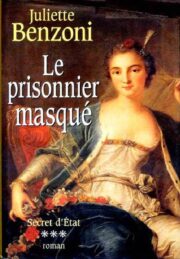
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.