— Vous serez peut-être plus utile encore que vous ne le croyez. À nous revoir, mon cher abbé ! Votre place vous sera toujours gardée chez moi… Ah ! voilà ceux du village qui nous arrivent ! Il est temps, je crois, d’aller leur dire adieu…
Tandis que la cour d’honneur de Fontsomme était le théâtre d’une scène émouvante où la duchesse et le chevalier de Raguenel purent prendre mesure de l’affection qu’on leur portait, Marie roulait vers Saint-Quentin où elle rejoindrait l’énorme cortège parti de Saint-Germain et qui devait accompagner Madame à Dunkerque. La jeune fille se sentait allégée, heureuse même d’avoir mis fin à une séparation si cruelle pour tous. Pleine aussi d’un courage puisé dans le renouveau de tendresse qu’elle éprouvait pour les siens. Ils n’avaient que trop souffert et Marie considérait que c’était à elle de les soutenir maintenant que Philippe, le cher petit frère, ne reviendrait plus. Philippe qu’elle aimait tant et que Fulgent de Saint-Rémy avait voulu tuer ! Elle avait le devoir de faire payer ses forfaits à cet homme qui l’avait abusée trop longtemps. Et cela à l’heure même où il croirait atteindre au triomphe !…
D’un geste machinal, elle chercha un sachet de velours glissé contre sa gorge et le tint un moment dans ses mains en le caressant du bout du doigt, avec quelque chose qui ressemblait à de la tendresse. Il y avait là de quoi libérer la famille de son cauchemar.
Environ dix-huit mois plus tôt, alors que Marie luttait contre le désespoir où l’avaient jetée les révélations de Saint-Rémy et le renoncement à son rêve, Athénaïs, alors en lutte quasi ouverte contre La Vallière, lui avait conseillé de consulter une devineresse :
— Elle dit des choses étonnantes et peut vous aider à les réaliser. Des Œillets vous conduira…
Et c’est ainsi qu’un soir, en compagnie de la suivante de la belle marquise, Marie s’était retrouvée au fond du jardin d’une petite maison sise rue Beauregard, dans ce faubourg de la Villeneuve-sur-Gravois qui avait poussé au début du siècle autour de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Là, dans une sorte de cabinet meublé d’une table, de deux chaises et d’une tapisserie, elle avait rencontré une certaine Catherine Monvoisin, dite la Voisin, assez belle femme rousse de trente-sept ou trente-huit ans, vêtue d’un manteau de velours pourpre brodé d’or et d’une jupe vert d’eau drapée de « point de France », qui avait failli déclencher son hilarité plutôt que sa confiance. Pourtant, ce qu’elle lui dit retint son attention car elle décrivit assez bien la situation dans laquelle se débattait la jeune fille – dans les grandes lignes tout au moins ! Là où Marie cessa de la suivre, c’est quand elle lui prédit un nouvel amour, un amour qui viendrait de loin.
— Vous oublierez alors, lui dit-elle, cette passion qui vous est si contraire ; auparavant, vous subirez une épreuve… difficile. Je ne sais encore ce que cela sera, mais n’oubliez pas qu’à tout mal existe un remède, et que des remèdes j’en connais beaucoup. Lorsque le temps en sera venu, nous nous reverrons…
En sortant de chez la voyante, Marie n’était qu’à demi convaincue. Quelle idée saugrenue d’imaginer seulement qu’elle pourrait ne plus aimer François, le seul homme qui ait réussi à faire battre son cœur depuis la petite enfance ! Pourtant, quand la terrible nouvelle, doublement douloureuse pour elle, avait couru la Ville et la Cour, surtout quand il avait été question d’investir Saint-Rémy du duché de son frère – ce Saint-Rémy à qui elle avait permis de devenir un ami, de s’attacher à elle mais qu’elle méprisait à présent de tout son cœur ! –, Marie s’était souvenue de la Voisin. Elle était retournée la voir, seule cette fois, et la devineresse lui avait remis ce sachet de poudre blanche qu’elle tenait au creux de sa main.
— Personne ne s’étonnera qu’un homme déjà âgé tombe malade, surtout s’il épouse une demoiselle trop jeune pour lui… Cela sera l’affaire de quelques jours et vous pourrez vous tourner vers un nouvel avenir.
Du poison ! C’était du poison que la Voisin lui avait vendu et, d’abord, Marie avait eu horreur de ce qu’on lui offrait mais, dans les mauvais rêves qu’elle faisait souvent, elle croyait entendre encore la voix désespérée de sa mère lui criant : « Cet homme voulait faire mourir ton jeune frère d’horrible façon », et elle finit par s’habituer à l’idée de venger d’un seul coup tout ce que celui qui osait l’aimer avait infligé aux siens. Même son départ pour Candie avec la flotte, « afin de ramener assez de gloire pour être digne de vous ! » avait fini par prendre une coloration sinistre. Et si c’était lui qui avait porté le coup mortel à Philippe ? Dans une mêlée, ce devait être assez facile… Dès lors, une véritable horreur remplaça la sympathie puis l’amitié née sous les platanes du château de Solliès. La détermination de se changer en justicière et d’en finir avec lui vint tout naturellement. Il suffisait d’avoir assez de courage pour aller jusqu’au bout d’une tâche qui lui répugnait mais qui était nécessaire. Ensuite elle aurait tout le temps qui lui resterait à vivre pour expier dans un couvent. Au moins ceux qu’elle aimait pourraient vieillir en paix…
Elle était si bien enfoncée dans ses pensées qu’elle ne s’aperçut pas que le temps avait changé. En arrivant à Saint-Quentin, le ciel déversait des trombes d’eau, et la vieille et fière cité picarde qui, tant de fois, avait eu à souffrir des guerres espagnoles semblait aux prises avec quelque nouvelle invasion. Marie dut renoncer à atteindre le magnifique hôtel de ville où elle savait que le Roi, la Reine et les princesses passeraient la nuit. Elle laissa la voiture prêtée par Mademoiselle s’arranger comme elle l’entendrait et se lança sur le pavé boueux dans un incroyable enchevêtrement de chevaux, de voitures, de seigneurs, de dames et de valets, tous plus ou moins mouillés et crottés. Dominant la mêlée comme une sorte de phare, Lauzun, en selle sur un magnifique cheval plein de feu qui avait au moins l’avantage de lui procurer des coudées franches, lançait des ordres, s’efforçant d’organiser le chaos. Il était d’ailleurs dans son rôle : nommé quelques mois plus tôt capitaine de la 1re compagnie des gardes du corps, c’était à lui que le Roi avait confié le commandement de sa fabuleuse escorte, comportant près de trente mille personnes, qui se dirigeait vers Calais. Le plus fort est que, peu à peu, le calme revenait, l’ordre s’instaurait, même si Lauzun n’était pas encore au bout de ses peines… Soudain, son œil d’aigle découvrit Marie qui s’efforçait courageusement d’atteindre la maison commune ; il tourna son cheval vers elle, l’atteignit, se pencha en lui tendant la main et l’enleva de terre pour l’installer sur la croupe de son coursier :
— Seigneur ! que faites-vous là ? Je croyais que Mademoiselle vous avait donné une voiture pour aller à Fontsomme ?
— J’en arrive mais mon cocher ne pouvait plus avancer et j’ai préféré descendre pour ne pas rester là des heures…
— Mademoiselle est sur le perron de l’hôtel de ville. Je vous conduis à elle…
La princesse, en effet, était là. Sans se soucier de la pluie, elle contemplait, avec un sourire extasié, les évolutions de Lauzun dont, ce n’était plus un secret pour personne, elle était tombée follement amoureuse au cours de la magnifique prise d’armes où le Roi avait remis au jeune homme son bâton de commandement. Tout le monde en riait sous cape, mais un peu moins fort cependant depuis que courait un bruit inquiétant : elle aurait dans l’idée de l’épouser et de faire ainsi de ce cadet de Gascogne un duc de Montpensier, cousin du Roi et maître de la plus grosse fortune du royaume. En le voyant enlever une femme sur son cheval elle avait d’abord froncé le sourcil, mais s’était détendue en reconnaissant Marie qu’elle accueillit avec chaleur :
— Vous voilà donc, petite ! Tout s’est-il bien passé ? Comment va votre mère ?
— Assez mal, je le crains, et j’ai failli la manquer : tout était prêt pour son départ. Avec le chevalier de Raguenel, elle a dû quitter le château peu après moi pour gagner son manoir de Conflans.
— Quoi ! Déjà ? Mais le… nouveau duc n’est pas encore investi ?
— Dès l’instant où elle a reçu l’ordonnance du Roi, elle a décidé de partir. Elle ne veut pas attendre qu’on la chasse…
— C’est abominable ! fit Lauzun qui s’attardait à caresser des yeux sa princesse. Pauvre charmante duchesse, si cruellement éprouvée ! Voir ce barbon succéder à son fils perdu… À propos, j’ai ouï-dire que le Roi songeait à vous le faire épouser ?
— Oui. Ainsi, par dérogation spéciale, le titre lui serait transmis par voie féminine…
— Et vous allez accepter ?
— Il le faudra bien…
— Allez à vos affaires, Lauzun ! coupa Mademoiselle. On a besoin de vous. Je vais conduire Marie à Madame. Nous nous reverrons plus tard !
Quand les deux femmes arrivèrent au logis attribué au duc et à la duchesse d’Orléans, la voix aigre et furieuse de Monsieur résonnait jusqu’aux poutres des plafonds. Une fois de plus, le prince se livrait à ce qui était son occupation préférée depuis l’arrestation de son favori bien-aimé : faire une scène à sa femme. Le thème eût été d’une affligeante monotonie si Madame n’en avait souffert cruellement : « Vous n’irez pas en Angleterre voir votre frère si le Roi ne me rend pas le chevalier de Lorraine ! » On n’en sortait pas…
Quand Mademoiselle et sa jeune compagne entrèrent chez elle, Madame, pâle, les traits tirés et les yeux clos, était étendue sur un lit de repos, s’efforçant de ne plus entendre les hurlements de son époux qui allait et venait à travers la pièce comme un ours en cage, ne s’arrêtant guère que pour montrer le poing à sa femme. Marie se précipita vers sa maîtresse tandis que Mademoiselle s’efforçait, sans grand succès, de calmer le furieux qui lui lança :
— En vérité, je ne sais pas pourquoi Madame tient tellement à passer la Manche. Regardez-la ! Elle est à moitié morte et ne vivra certainement plus longtemps. On m’a prédit d’ailleurs que je me marierais plusieurs fois…
— Oh, mon cousin ! protesta la princesse. On ne dit pas de telles choses ! Elles ne sauraient que porter malheur !
— C’est bien ce que j’espère ! riposta Monsieur féroce.
Cela eût peut-être continué une partie de la nuit comme le prince en avait pris l’habitude si, brusquement, le Roi n’était apparu. Il embrassa la scène d’un coup d’œil et, dédaignant les révérences qui le saluaient, marcha vers la chaise longue d’où Madame faisait effort pour se lever :
— Ne bougez, ma sœur !… Je suis venu vous prier de faire silence, Monsieur mon frère. On n’entend que vous !
— Avec ou sans votre permission, je crierai, Sire, je crierai jusqu’à ce que l’on me rende justice, et je suis ici chez moi !
— Que l’on vous rende justice, cela veut dire que l’on vous rende un ami un peu trop cher et qui vous pousse à la rébellion ? Alors, je suis venu vous dire ceci, mon frère : non seulement vous laisserez Madame rejoindre le roi Charles II à Douvres mais vous tolérerez qu’elle y reste plus de trois jours, car la mission que je lui ai confiée est d’importance et ne saurait s’accommoder d’un si court laps de temps. Au moins quinze jours me semblent nécessaires et je dirai… dix-sept ? Qu’en pensez-vous ?
— Jamais ! Si l’on me pousse à bout, elle ne partira même pas.
— Fort bien. Écoutez encore : le chevalier de Lorraine, jusqu’ici emprisonné à Lyon dans la forteresse de Pierre-Encize, vient d’être transféré à Marseille, au château d’If dont le climat est fort malsain. En outre, j’ai ordonné qu’on lui enlève son valet et que toute correspondance lui soit interdite…
Sous le souffle de l’épouvante, la colère de Monsieur tomba d’un seul coup et il fondit en larmes…
— Vous n’avez pas fait cela, Sire ?
— Je ferai pire encore si vous m’y forcez ! Sachez-le, mon frère, je ne laisserai personne se mettre à la traverse de ma politique. J’ai besoin que France et Angleterre se rapprochent. Alors je n’aurai pitié de personne et surtout pas de vous qui êtes prince français. Et si le chevalier de Lorraine me gêne par trop…
— Non, Sire mon frère ! Je vous en supplie : cessez de le faire souffrir ! Je ne… je ne puis en endurer la pensée. Le château d’If, mon Dieu !
— Il ne dépend que de vous qu’il en sorte, libre de se rendre en Italie… et d’y reprendre son écritoire.
Sous le terrible regard de son frère, Monsieur amena son pavillon, terrifié à l’idée de ne revoir jamais celui qu’il aimait tant…
— Je suis l’humble serviteur de Votre Majesté, exhala-t-il en s’inclinant avant de quitter la salle en courant comme si le diable le poursuivait.
Louis XIV le regarda sortir, un indéfinissable sourire au coin des lèvres, puis revint à sa belle-sœur dont il prit la main pour la porter à sa bouche.

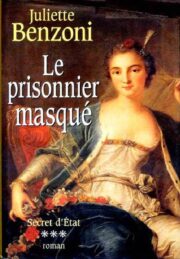
"Le prisonnier masqué" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le prisonnier masqué". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le prisonnier masqué" друзьям в соцсетях.