– Je n’ai rien contre une conversation à cœur ouvert avec vous, mon cher, mais nous aurions pu causer aussi bien à l’hôtel où vous semblez avoir vos petites entrées ? On est très mal chez vous.
– Ce n’est pas vraiment un lieu de villégiature. Quant à ce que j’ai à vous dire, ça tient en deux mots : je veux le rubis.
– C’est une manie chez vous ? La dernière fois, vous couriez après un saphir. Maintenant, c’est un rubis. Avez-vous l’intention de me convoquer chaque fois que vous aurez envie d’une pierre précieuse ?
– Ne faites pas l’idiot ! Vous savez très bien ce que je veux dire. Le rubis a été vendu à Kledermann par cet abruti de Saroni qui a cru pouvoir faire cavalier seul et s’approprier l’objet.
Et ce soir, Kledermann vous l’a revendu. Alors dites-moi où il est et on vous ramène en ville ! Morosini éclata de rire :
– Où êtes-vous allé pêcher votre psychologie du collectionneur ? Vous vous imaginez que le banquier m’a fait venir ici pour lui racheter la pièce rare sur laquelle il a réussi à mettre la main ? Vous rêvez, mon vieux ! Il m’a fait venir pour l’estimer et lui en raconter l’histoire, un point c’est tout ! Cela dit, je désirais en effet racheter ce rubis mais Kledermann y tient comme à la prunelle de ses yeux. J’ai échoué.
– Moi je n’échouerai pas et vous allez m’aider.
– Du fond de cette cave ? Je ne vois pas comment ? Au fait, c’est vous qui avez arrangé de si belle façon ce pauvre Saroni ?
– Ce n’est pas moi, c’est mon… employeur, fit Ulrich avec une nuance de dédain qui n’échappa pas à Morosini. C’est lui qui a mené l’interrogatoire et c’est son exécuteur qui l’a tué. Moi j’ai horreur de me salir les mains…
– Je vois. Vous êtes le cerveau de l’association ?
Un éclair d’orgueil traversa les yeux pâles de l’Américain.
– On peut dire ça, en effet !
– Étrange ! Que l’on ne laisse pas les responsabilités au jeune Sigismond qui est loin d’être une lumière, je le conçois mais… le vieux Solmanski est toujours vivant, lui, en dépit de la comédie du suicide jouée à Londres. Et à moins qu’il ne soit devenu subitement gâteux ? …
– Eh bien, vous en savez des choses ! Non, il n’est pas gâteux mais il est malade. Le produit qu’il a avalé pour simuler la mort a laissé des traces. Il ne peut plus diriger lui-même les opérations. Pourquoi croyez-vous qu’il ait pris la peine de me faire évader pour me mettre à la tête de la bande de malfrats ramenés d’Amérique par Sigismond ?
La conversation prenait un tour inattendu qui était loin de déplaire à Morosini. Il poussa son avantage :
– Il est certain que le besoin d’un homme à poigne devait se faire sentir. Sigismond n’est qu’un agité dangereux et cruel. Je crois même que son père partage mon opinion.
– Sans aucun doute ! acquiesça Ulrich toujours aux prises avec les joies de l’autosatisfaction.
– Autrement dit, vous prenez vos ordres directement de lui. Il est ici ?
– Non. À Varsovie…
Entraîné par le rythme de la conversation, il avait parlé trop vite et le regretta aussitôt :
– De toute façon, ça ne vous regarde pas !
– Que voulez-vous de moi ? Je vous ai déjà dit que Kledermann veut garder le rubis. Je ne vois pas ce que vous pourriez me demander de plus ?
Un sourire qui n’avait rien d’aimable vint se poser comme un masque sur le visage taillé à coups de serpe de l’Américain :
– Oh, c’est simple : vous allez vous arranger pour le récupérer. Vous avez vos grandes et vos petites entrées : ce doit être assez facile ?
– Si c’était aussi facile j’aurais déjà trouvé un plan, mais ce que vous êtes en train de me demander c’est de cambrioler une chambre forte qui ne vole pas son nom. C’est Fort-Knox en plus petit !
– Il ne faut jamais désespérer de rien. En tout cas, arrangez-vous comme vous l’entendrez mais il me faut le rubis, sinon…
– Sinon quoi ?
– Vous pourriez vous retrouvez veuf !
C’était tellement inattendu que Morosini ouvrit de grands yeux :
– Ce qui veut dire ?
– C’est assez facile à comprendre : nous tenons votre femme ! Vous savez, cette ravissante créature que vous êtes venu arracher de nos mains au péril de votre vie dans la villa du Vésinet ?
– J’entends bien mais… elle est la sœur et la fille de vos patrons ? Et ce sont eux qui vous ont donné l’ordre d’enlever ma femme ?
Ulrich prit un instant de réflexion avant de répondre, puis releva la tête avec l’air d’un homme qui vient de prendre un parti :
– Non. Je dirais même qu’ils ignorent ce détail. Voyez-vous, il m’a semblé qu’il ne serait pas mauvais de prendre une assurance contre eux tout en me procurant un moyen de pression sur vous !
Le cerveau d’Aldo travaillait à toute vitesse. Il y avait là quelque chose de bizarre. Sa première pensée pencha pour un bluff.
– Quand l’avez-vous enlevée ? demanda-t-il d’une voix égale.
– Hier soir, vers onze heures, alors qu’elle sortait du Harry’s Bar avec une amie… Cela vous suffit ?
– Non. Je veux téléphoner chez moi !
– Pourquoi ? Vous ne me croyez pas ?
– Oui et non. Le délai me semble un peu court pour l’amener ici…
– Je n’ai pas dit qu’elle était ici. Mais que je la tienne, vous pouvez en être sûr !
À son tour, Aldo prit un temps de réflexion. Quand il avait quitté Anielka, elle venait tout juste d’être débarrassée de ses nausées mais sa forme n’était pas éblouissante. Il l’imaginait mal se précipitant au Harry’s Bar pour y siroter des cocktails, même avec une amie qui pouvait être Adriana. En tout cas, une chose était certaine : Ulrich savait qu’il avait épousé la veuve de Ferrals mais il ignorait l’état actuel de leurs relations. Un instant, il caressa l’idée de déclarer avec un grand sourire : « Vous avez ma femme ? À merveille ! Gardez-la donc, vous n’avez pas idée du service que vous me rendez ! » Il imagina la tête d’Ulrich à l’annonce de cette nouvelle… D’autre part, il savait d’expérience que cet homme était dangereux et qu’il n’hésiterait pas un instant à faire souffrir Anielka pour parvenir à ses fins. Or, si Aldo voulait récupérer sa liberté, il ne souhaitait pas la mort de la jeune femme et encore moins qu’elle subît une quelconque torture. La seule chose à faire était de jouer le jeu tel qu’on le lui offrait. C’était l’unique façon de remonter à l’air libre…
– Eh bien ? fit Ulrich. Vous ne dites plus rien ?
– Ce genre de nouvelle mérite qu’on y réfléchisse, non ?
– Peut-être, mais je trouve que c’est suffisant. Alors ?
Morosini se composa un visage qu’il espérait suffisamment angoissé :
– Vous ne lui avez pas fait de mal, au moins ?
– Pas encore et je dirais même qu’elle est fort bien traitée !
– En ce cas, je n’ai pas le choix. Que voulez-vous au juste ?
– Je vous l’ai dit : le rubis.
– Vous ne pensez pas que je vais vous le chercher cette nuit ? Et demain, le rubis partira chez quelque joaillier pour être monté en vue d’être offert à Mme Kledermann pour son anniversaire.
– C’est quand, cet anniversaire ?
– Dans treize jours.
– Vous y serez ?
– Naturellement ! fit Aldo en haussant les épaules avec une lassitude bien imitée. À moins que vous ne me gardiez ici ?
– Je ne vois pas trop à quoi vous pourriez me servir dans ce trou. Alors, écoutez-moi bien ! On va vous ramener en ville où vous vous tiendrez à ma disposition, monsieur le prince ! Et, bien entendu, pas question d’approcher la police : je le saurais et votre femme en pâtirait. Pas question non plus de quitter votre hôtel. Je vous indiquerai par la suite un rendez-vous. Vous pouvez toujours essayer d’apprendre quel joaillier est chargé de la monture ?
Ulrich se leva et se dirigea vers la porte mais se retourna avant de l’ouvrir :
– Ne faites pas cette tête-là. Si les choses marchent comme je le veux, il se peut que vous y trouviez votre intérêt.
– Je ne vois pas en quoi ?
– Allons, réfléchissez ! Au cas où, grâce à vous, je pourrais visiter la chambre forte de Kledermann, il se peut que je vous laisse le rubis…
– Comment ? lâcha Aldo abasourdi. Mais je croyais…
– Les Solmanski le veulent à tout prix mais qu’ils l’aient ou non, ça m’est égal ! Il fallait être aussi bête que Saroni pour s’imaginer qu’un truc comme ça pouvait se vendre sans faire de vagues. Dans le coffre du banquier, il doit y avoir de quoi se remplir les poches plus facilement…
– Il a beaucoup de bijoux historiques. Pas commodes à vendre non plus.
– Vous tourmentez pas pour ça. En Amérique tout se vend et à des prix plus intéressants qu’ici. À bientôt !
Assis sur son lit, Aldo leva la main dans un vague salut négligent. Un instant plus tard, le batracien nommé Archie effectuait sa rentrée, arborant ce qu’il croyait être un sourire :
– On va te ramener en ville, mon gars, fit-il, mais Morosini n’eut même pas le temps d’articuler un mot : un coup de matraque appliqué à une vitesse incroyable le renvoya au pays des songes…
Le second réveil eut lieu dans des circonstances encore moins confortables que le premier : au moins, dans la maison inconnue, il y avait un lit. Cette fois, Morosini ouvrit les yeux dans un univers obscur, froid et humide. Il s’aperçut vite qu’on l’avait posé sur l’herbe d’une pelouse autour de laquelle il y avait de beaux arbres. Au-delà on apercevait le lac, des hangars à bateaux, des restaurants sur pilotis. La nuit était toujours là et les réverbères continuaient à brûler. Transi, en dépit de son manteau de vigogne qu’on avait eu la grâce de lui remettre, Aldo repéra vite les lumières du Baur-au-Lac qui ne lui parut pas très éloigné. En dépit de sa tête douloureuse, il se mit à courir dans le triple but de sortir du jardin, de rentrer chez lui et de se réchauffer.
Lorsqu’il pénétra dans le hall de l’hôtel, le portier s’autorisa à lever un sourcil en voyant rentrer en aussi triste état un client apparemment sobre et qu’il croyait couché depuis longtemps, mais il se serait fait couper la langue plutôt que d’oser une question. Aldo le salua d’un geste vague de la main et marcha d’un pas tranquille vers l’ascenseur : il avait, en effet, retrouvé la clé de sa chambre au fond de sa poche.
Une douche chaude, deux comprimés d’aspirine, et il se plongeait dans son lit en repoussant fermement toute pensée défavorable au sommeil. Dormir d’abord, on verrait après !
Il n’était guère plus de dix heures quand il se réveilla, plus dispos qu’il ne l’aurai craint. Il commença par se commander un copieux petit déjeuner puis demanda qu’on lui appelle Venise au téléphone. Bien qu’il n’y crût guère, cette histoire d’enlèvement d’Anielka le tarabustait. Si c’était vrai, il allait trouver la maison sans dessus dessous et peut-être même envahie par la police ? Il n’en fut rien : la voix qui lui répondit – celle de Zaccaria – était calme et paisible, même lorsque Aldo demanda à parler à sa femme :
– Elle n’est pas là, dit le fidèle serviteur. Votre départ lui a donné des envies de bouger : elle est allée passer quelques jours chez donna Adriana.
– Elle a emporté des bagages ?
– Bien sûr. Ce qu’il faut pour un petit séjour. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?
– Tout va bien, ne te tourmente pas. Je voulais seulement lui dire un mot. Au fait, Wanda est avec elle ?
– Bien entendu…
– C’est parfait. Je vais téléphoner chez ma cousine.
Il n’y eut pas plus de succès. Une voix mâle et rogue lui apprit que ni la comtesse Orseolo ni la princesse Morosini n’étaient là : ces dames avaient quitté Venise la veille au matin en direction des grands lacs. Elles n’avaient pas laissé d’adresse, ne sachant encore où elles se fixeraient.
– Et vous êtes qui, vous ? demanda Aldo qui n’aimait ni le ton ni la voix du personnage.
– Moi, je suis Carlo, le nouveau serviteur de madame la comtesse. C’est tout ce que Votre Excellence désire savoir ?
– C’est tout. Merci.
Aldo raccrocha. Plutôt perplexe. Ce qui se passait à Venise était encore plus bizarre qu’il ne l’avait cru. Où était Anielka ? Prisonnière d’Ulrich, ou paisible touriste sur le lac Majeur ? À moins que les deux femmes, plus Wanda, n’aient été enlevées ensemble ou qu’Adriana, non contente d’entretenir des relations avec le cirque Solmanski, n’en eût noué d’autres avec les gangsters yankees ? Jusqu’à ce nouveau valet qui péchait par singularité : le nom était italien mais, vu l’accent, Morosini aurait eu tendance à penser que Karl ou Charlie conviendraient mieux. Qu’est-ce que tout cela voulait dire au juste ?
Une longue succession de points d’interrogation l’occupa jusqu’à l’arrivée pétaradante d’Adalbert et de son roadster Amilcar rouge vif doublé de cuir noir qui valut à son propriétaire la considération respectueuse du voiturier persuadé d’avoir affaire à un échappé de la Targa Florio ou de la toute nouvelle course des Vingt-Quatre heures du Mans. Morosini, lui, n’apprécia pas :

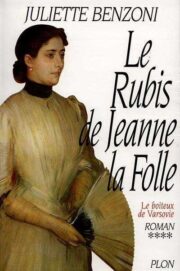
"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.