LE RUBIS DE JEANNE LA FOLLE
Le boiteux de Varsovie tome 4
Première série
Juliette Benzoni
Résumé :
Dernier tome de la première série de la saga du Boiteux de Varsovie, Aldo et ses amis nous entraîne dans une nouvelle aventure. Le prince Aldo Morosini réussira-t-il à s’emparer de la quatrième pierre du pectoral, le rubis cabochon de la reine espagnole Jeanne que l’on surnommait « la Folle », la plus belle mais aussi la plus malfaisante des pierres qu’amateurs d’art et redoutables gangsters convoitent aussi ? Trouvera-t-il enfin l’amour et retrouver celle qu’il aime, et s’en sortira-t-il vivant malgré tous les ennemis l’entourant de toutes parts ?
De Séville à Prague, puis à Zurich, Aldo Morosini, aidé de son ami archéologue Adalbert Vidal Pellicorne, va traquer la pierre qui est la plus malfaisante et la plus sanglante de toutes. Mais, sur son chemin, il devra faire face au danger que représentent Anielka, la femme qu’on lui a imposée et sa sulfureuse famille. Dans ce quatrième et dernier tome de la saga du Boiteux de Varsovie, Juliette Benzoni nous entraîne dans des aventures pleines de rebondissements et de suspense où l’amour et l’argent tuent.
Première partie LE MENDIANT DE SÉVILLE 1924
CHAPITRE 1 UNE ÂME EN PEINE
La fête avait quelque chose de magique. Peut-être parce que, ce soir, elle naissait de la plus pure tradition andalouse traduite à miracle par la voix exceptionnelle d’un enfant…
Assis sur une chaise près de la fontaine, vêtu d’un costume noir et d’une chemise blanche, les mains posées bien à plat sur les cuisses, le cou tendu et les yeux levés comme pour interroger les étoiles haut plantées dans la voûte bleue du ciel, Manolo, indifférent à la foule qui l’entourait, laissait jaillir sa voix pure en une soleâ d’une grande beauté. À son côté, le guitariste debout, un pied posé sur un tabouret, se penchait vers lui avec une sorte de sollicitude.
Vrai filigrane sonore, la phrase musicale s’élançait limpide, coupée d’étranges plaintes, puis reprenait son vol. L’assistance retenait son souffle, envoûtée par une si parfaite expression du « cante jondo », le « chant profond » venu du fond des âges où se rejoignaient la musique liturgique de Byzance, celle des rois maures de Grenade et l’apport fougueux des bandes gitanes immigrées au XVe siècle. C’était la racine même du flamenco avant l’apport des cafés de Triana ou du Sacro Monte ; un extraordinaire moment d’art pur…
Comme un charme qui se brise, la ligne mélodique cassa net, générant un instant de silence suivi d’un tonnerre d’applaudissements sous lequel le jeune garçon salua gravement.
Il n’avait pas quatorze ans mais déjà il était célèbre. Deux ans plus tôt, ce gamin gitan remportait haut la main le concours de chant que venaient de fonder, à Grenade, le poète Federico Garcia Lorca et le musicien Manuel de Falla. Depuis on se l’arrachait. Tout au moins, on essayait. Ceux qui veillaient à la jeune carrière du petit chanteur opéraient une rigoureuse sélection. Mais quelle barrière pouvait résister à dona Ana, dix-septième duchesse de Medinaceli, dès l’instant où elle avait décidé d’en faire le clou de la soirée que, en l’honneur de la Reine, elle donnait pour la San Isidro ?
Debout à quelques pas des deux dames dans le grand patio illuminé par des centaines de bougies et de petites lampes à huile qui exaltaient la splendeur des azulejos, le prince Morosini oubliait volontiers le chanteur pour mieux contempler l’hôtesse et son invitée, tant leur beauté quasi nordique tranchait parmi les peaux et les chevelures brunes. Blonde en effet comme on l’est à Venise, les traits ciselés par un burin délicat autour de grands yeux clairs, la femme la plus titrée d’Espagne après la duchesse d’Albe se tenait debout auprès du fauteuil de sa souveraine dont les trente-six ans et les sept maternités n’atténuaient en rien la beauté. La blondeur anglaise de la Reine, son teint de camélia et ses yeux d’aigue-marine s’accommodaient à merveille du haut peigne andalou et des dentelles qui en coulaient. Liées par une véritable amitié – la reine Victoria-Eugénia était la marraine de la petite Maria-Victoria, fille de la duchesse qui occupait la charge de dame d’honneur – un âge à peu près semblable et un même sens de l’élégance, les deux femmes semblaient vraiment sorties d’un tableau de Goya dont l’œuvre et l’époque servaient de thème à la magnifique fête donnée à la Casa de Pilatos, le palais sévillan des Medinaceli dont le charme enchantait Morosini.
Ce n’était pas la première fois qu’il venait à Séville, mais lorsqu’il y était arrivé, l’avant-veille, c’était dans les bagages de la Reine, sur la chaleureuse invitation du Roi son époux.
– Tu viens de me rendre un grand service, Morosini, avait déclaré Alphonse XIII qui tutoyait en général les gens qui lui plaisaient, et pour te remercier, je t’en demande un autre : accompagne ma femme en Andalousie ! Elle se sent un peu accablée par l’Espagne, ces temps-ci. Ta présence sera une agréable diversion… Il y a des moments où l’Angleterre lui manque !
– Mais je ne suis pas anglais, Sire, objecta Morosini peu tenté par l’idée de se retrouver noyé dans les méandres de la sévère étiquette de cour.
– Tu es un Vénitien mâtiné de Français. C’est presque aussi bien si l’on y ajoute que tu ne considères pas le thé comme un poison violent et que tu détestes la corrida autant qu’elle… Et comme, de toute façon, tu ne peux pas loger sous le même toit, on va te retenir une suite à l’Andalucia Palace où tu seras mon invité. Je te dois bien ça, ajouta le Roi en cueillant sur son bureau un objet magnifique : une coupe d’agate cerclée d’or et de pierres précieuses dont l’anse était formée par un cupidon d’ivoire et d’or chevauchant une chimère émaillée… le « service » dont on remerciait Aldo.
Deux mois plus tôt, les talents de Morosini avaient été requis par les héritiers d’un prince napolitain trop désargenté pour que sa famille, déçue dans ses espérances, hésite à « bazarder » l’incroyable accumulation d’objets de toute sorte entassés dans son palais délabré. Il y avait de tout là-dedans depuis des animaux empaillés, des cages vides et d’affreux objets en simili gothique jusqu’à de ravissants cristaux, une collection de tabatières, quelques tableaux et surtout une coupe ancienne exceptionnelle qui décida Morosini à acheter le tout avant de céder à un brocanteur la plus grande partie de ses acquisitions, gardant seulement les tabatières et la coupe qui lui rappelait quelque chose.
Le vague souvenir devint certitude après un long tête-à-tête avec de vieux bouquins dans la paix de sa bibliothèque : l’objet avait appartenu au Grand Dauphin, fils du roi de France Louis XIV. Collectionneur impénitent, le prince raffolait des coupes, plats et coffrets représentant ce qui se faisait de plus précieux aux temps de la Renaissance et du baroque. À sa mort, survenue à Meudon le 14 avril 1711, le Roi-Soleil décida qu’en dépit de l’abandon fait par lui de ses droits au trône de France, le fils cadet du Grand Dauphin, devenu le roi Philippe V d’Espagne, devait recevoir au moins un souvenir de son père. Aussi le trésor, emballé dans de somptueux coffres de cuir timbrés aux armes de l’héritier défunt, prit-il sous bonne escorte le chemin de Madrid. Il devait y rester jusqu’au règne plutôt bref de Joseph Bonaparte, dont Napoléon Ier son frère avait fait un roi d’Espagne. Peu délicat, celui-ci, en abandonnant son trône, rapatria la collection à Paris.

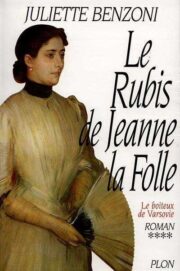
"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.