– Excusez-moi ! C’était à la Casa de Pilatos. Pendant la fête qui s’y déroulait dans le patio et les jardins, je suis monté à l’étage pour revoir un tableau qui m’intéressait. Elle était là, devant ce portrait qu’elle caressait. Elle s’est enfuie en me voyant et moi je l’ai suivie.
– Ce portrait c’est celui de Juana la Loca, la reine folle ?
– En effet. Y a-t-il un lien avec elle ? Votre Catalina est habillée de la même façon…
– Oui, bien que les deux femmes ne se soient jamais vues. La princesse avait deux ans au moment du drame et ce n’est pas à elle que s’attache l’affection de Catalina mais au bijou qu’elle porte. Vous avez dû remarquer à son cou le médaillon qui enchâsse un gros rubis ?
– Je l’ai remarqué, affirma Aldo qui se garda bien de préciser que c’était justement ce qu’il souhaitait examiner de plus près.
– C’est lui que cette malheureuse est condamnée à retrouver pour obtenir sa délivrance… mais c’est une longue et triste histoire et il se fait tard, señor ! …
– J’aimerais pourtant l’entendre. Ne pourrions-nous aller quelque part boire un verre de xérès ou de manzanilla ?
Tout en parlant, il fit surgir un billet au bout de ses doigts, Le mendiant se mit à rire, découvrant des dents presque aussi blanches que celles de son interlocuteur :
– Il est certain que nous aurions un grand succès, vous en tenue de soirée et moi dans mes oripeaux ! Cependant, j’accepterai volontiers cet argent… mais demain, quand vous serez vêtu de façon moins voyante !
– D’accord ! Où et quand ?
– Ici même. Disons… vers trois heures ? C’est l’heure chaude, il n’y aura pas grand-monde. Je vous attendrai devant la chapelle.
– Et où irons-nous ?
– Nulle part nous ne serons plus tranquilles que dans ce jardin inculte. Si vous n’avez pas peur….
– Au contraire ! J’entrerais même volontiers maintenant.
– Ne m’obligez pas à recommencer ! soupira le mendiant : il n’est jamais bon de défier les forces inconnues. Demain vous saurez… ce que je sais tout au moins. Vous retournez à la Casa de Pilatos ?
– Sans doute. J’ai l’impression d’en être absent depuis des heures…
– Venez. Je vais vous trouver une voiture qui vous ramènera.
Un moment plus tard, Morosini réintégrait la fête. On en était au souper, servi dans le grand jardin sous les arceaux fleuris et les palmes d’une végétation quasi tropicale. Le bruit des rires et des conversations sur fond musical emplissait la nuit et, du coup, Morosini hésita sur la conduite à tenir : arrivant bon dernier, il pouvait difficilement se mettre à la recherche de sa place à table dès l’instant où la Reine présidait : le protocole s’y opposait.
Il choisit d’attendre, gagna le petit jardin illuminé mais désert, s’y installa sur un banc couvert de faïence jaune et entreprit de fumer le contenu de son porte-cigarettes. C’est là que le découvrit l’une des dames de la Reine :
– Comment, prince, vous êtes ici ? Mais on vous a cherché partout. Sa Majesté a même montré quelque inquiétude. Seriez-vous souffrant ?
– Un peu, oui ! Voyez-vous, dona Isabel, je suis sujet, parfois, à des névralgies fort douloureuses qui font de moi un compagnon peu agréable. Cela m’a pris pendant le concert et je me suis écarté…
Quand il s’agit d’un homme séduisant, la plus revêche des douairières a toujours de la pitié à revendre. Et celle-ci n’en était pas une.
– Il fallait me prévenir et partir. Sa Majesté vous aime bien et ne tient pas à vous voir souffrir : j’aurais présenté vos excuses… C’est d’ailleurs ce que je vais faire, ajouta-t-elle après avoir contemplé un instant le visage crispé du prince. Nous allons demander une voiture et l’on vous ramènera à votre hôtel. Je me charge de tout ! Demain vous viendrez à l’Alcazar offrir vos regrets…
– J’accepte volontiers votre secours, encore que partir sans le congé de la Reine…
– Je l’obtiendrai pour vous. Elle comprendra. Venez ! Je vais faire avancer l’une de nos voitures.
Quelques instants plus tard Morosini enchanté de son stratagème roulait vers l’Andalucia Palace au trot allègre d’une calèche à sonnailles et pompons rouges et jaunes qui lui parut le comble du confort : après sa galopade en souliers vernis dans les ruelles il ne sentait plus ses pieds. Grâce à la chère dona Isabel, il était libre de consacrer ses pensées à sa prochaine rencontre avec le mendiant. Une rencontre dont son instinct de chasseur lui soufflait qu’elle pourrait bien ouvrir une piste intéressante. Et, depuis deux ans, il n’en était pas de plus passionnantes que celles menant à l’une ou l’autre des pierres précieuses volées il y a bien longtemps au pectoral du Grand Prêtre, au Temple de Jérusalem. À cette heure il n’en manquait plus qu’une : un gros rubis cabochon. Ce rubis était la raison pour laquelle Aldo avait voulu examiner en toute tranquillité le portrait de Jeanne la Folle : celui que la mère de Charles Quint portait au cou possédait tous les caractères du joyau disparu…
Depuis deux ans, en effet, Morosini courait l’Europe en compagnie de son ami l’égyptologue Adalbert Vidal-Pellicorne. Ils étaient parvenus à retrouver trois des pierres manquantes : le saphir, le diamant et l’opale. Celui qui les avait lancés dans cette quête, Aldo l’avait rencontré dans les souterrains du ghetto de Varsovie. C’était un Juif boiteux doté d’une vaste culture et d’une grande sagesse, possédant même le don de clairvoyance, et il était de ceux qui savent s’attacher les hommes. L’histoire que Simon Aronov raconta au prince antiquaire était de celles qu’on ne peut écouter d’une oreille indifférente dès l’instant où l’on est jeune, courageux, passionné de joyaux anciens et doué pour l’aventure : le peuple d’Israël dispersé à travers le monde ne retrouverait sa terre natale et ses droits souverains que si le pectoral au complet réintégrait la mère patrie. De même prendrait fin le pouvoir maléfique des pierres sacrées volées pour la première fois par les soldats de Titus. Et Dieu sait si elles étaient malfaisantes ! Leur beauté, leur grande valeur aussi suscitaient la convoitise des hommes comme des femmes, et tout au long des siècles leurs traces étaient souillées de sang.
Aldo lui-même avait eu à en souffrir : sa mère, la princesse Isabelle à qui ses ancêtres avaient légué le saphir, était morte assassinée. Comme avait été assassiné sir Eric Ferrals, le richissime marchand de canons, et par les soins de son beau-père – peut-être par sa propre femme ! – le comte Solmanski, l’ennemi juré du Boiteux lancé comme lui sur la piste des joyaux perdus. Tout aussi néfaste était la Rose d’York, le diamant du Téméraire, le duc de Bourgogne à la destinée shakespearienne : une demi-douzaine de cadavres rien qu’après l’annonce de sa mise en vente à Londres. Sans compter une victime de Jack l’Éventreur et quelques autres ! Quant à l’opale, liée à la légende tragique des Habsbourg, passant par celle de l’éblouissante Sissi et de son fils Rodolphe, elle avait laissé quatre cadavres sur la terre autrichienne au cours du seul automne précédent. Chaque fois, les deux chercheurs rencontrèrent la main criminelle de Solmanski.
En ce qui le concernait, Morosini avait payé sa bonne part. Non content d’avoir fait une meurtrière d’Adriana Orseolo, la cousine préférée d’Aldo, Solmanski avait réussi au moyen d’un chantage ignoble à le contraindre lui, prince Morosini, à épouser sa fille, la ravissante mais inquiétante Anielka, veuve de sir Eric Ferrals probablement empoisonné par elle bien que le tribunal d’Old Bailey n’ait pu prouver sa culpabilité.
Ironie du sort : Aldo se retrouvait l’époux d’une femme dont il était fou avant de découvrir qu’il ne l’aimait plus. Si même il l’avait réellement aimée ? C’est si facile de confondre le désir et l’amour…
De retour à l’Andalucia, Aldo alla boire un dernier verre au bar. Un bon moyen de chasser les idées sombres qui lui venaient quand il pensait à celle qui portait son nom. Avec grâce d’ailleurs ! Sa beauté blonde, fragile et délicate, attirait les hommes autant qu’un pot de miel attire les mouches. On l’enviait à Morosini. Certains le jalousaient et personne ne comprendrait que le mariage restât blanc mais jamais il ne manquerait au serment fait aux mânes de sa mère assassinée, jamais il ne donnerait à la fille du meurtrier le triomphe de continuer la lignée de l’une des plus nobles et des plus anciennes familles de Venise. Il savait qu’il ne pourrait pas regarder ses enfants en face s’ils avaient Roman Solmanski pour grand-père..
À cette situation, il existait une solution : l’annulation en cour de Rome d’un mariage contracté sous la contrainte et non consommé. La décision d’Aldo était prise : il allait entamer la procédure.
S’il ne l’avait pas fait au lendemain de son mariage, c’était surtout par pitié pour celle qu’il avait dû jurer, devant Dieu, d’aimer et de protéger. Et cela, justement parce qu’il l’avait aimée au point de tout risquer pour la posséder.
En effet, la situation de la jeune femme était peu enviable malgré la présence de sa fidèle femme de chambre, Wanda, qui s’occupait d’elle depuis l’enfance. Supportée plus qu’acceptée dans un palais qui se refusait à être son foyer, tenue à distance par un mari qu’elle disait aimer, elle devait endurer l’angoisse suscitée par le sort de son père, emprisonné en Angleterre et dans l’attente d’un procès pour meurtre qui risquait de le conduire à la potence. Que le comte Solmanski fût un être abject ne changeait rien à l’image qu’en gardait sa fille et, si Morosini se réjouissait de voir son ennemi abattu, on ne pouvait demander à Anielka de partager ce sentiment. Aussi, tant que la sentence ne serait pas rendue, l’époux forcé n’enverrait pas sa demande d’annulation. Simple question d’humanité ! Mais ensuite, que Solmanski soit mort ou vivant, Aldo ferait tout pour récupérer sa liberté.
Qu’en ferait-il ? Pas grand-chose sans doute. La seule femme pour laquelle il l’eût abdiquée avec enthousiasme s’était éloignée de lui à tout jamais. Elle devait le mépriser, le détester, et cela aussi était de sa faute, il avait découvert beaucoup trop tard à quel point il aimait l’ex-Mina van Zelden, muée en une adorable Lisa Kledermann…
Découvrant que la fine Champagne réveillait les souvenirs au lieu de les étouffer, Morosini abandonna le bar, monta dans sa chambre et, sans même accorder un regard au magique paysage nocturne de Séville, il se mit au lit avec la ferme intention de dormir : c’était la meilleure façon d’user le temps jusqu’à sa rencontre avec le mendiant.
L’homme était au rendez-vous. En arrivant sur la placette, Morosini l’aperçut accroupi à l’entrée de la chapelle dans sa souquenille couleur de corail. L’endroit étant désert, il ne mendiait pas et même semblait dormir. Pourtant, il se leva dès qu’apparut celui qu’il attendait et lui fit signe d’aller vers la maison où il le rejoignit.
Dans la lumière crue d’un soleil déjà africain, la lèpre et les blessures de la bâtisse étalaient leur misère sans pourtant rien enlever d’une sorte de beauté farouche, mais Morosini savait que nulle part au monde les haillons ne se portent avec plus d’orgueil qu’en Espagne.
Sans dire un mot, le mendiant sortit une clé de ses hardes et s’en servit pour ouvrir une porte plus solide qu’elle n’en avait l’air :
– Vous voyez qu’à moins d’être un esprit on n’entre pas si facilement, dit le mendiant. Mais Catalina n’a pas besoin de clés, elle !
– Et ceux qui la suivent, comment font-ils ?
– Le diable l’ouvre pour eux… Cette nuit, vous auriez pu entrer si je n’étais intervenu.
Le jardin avait dû être ravissant. Les céramiques bleues et jaunes qui en marquaient les chemins étaient éclatées, décolorées, parfois réduites en poudre mais, en ce beau printemps, la végétation plus vivace que jamais changeait les anciens massifs en une petite jungle délirante et parfumée. Une large pierre usée qui avait été un banc couvert d’azulejos bleus accueillit les deux hommes sous un oranger obstiné dont les fleurs blanches embaumaient. Tout ce joli fouillis cachait bien les blessures de la vieille maison.
– Je ne sais pas si le diable a ici son logis, remarqua Morosini, mais il offre quelques ressemblances avec un paradis…
– Dommage seulement qu’il n’y ait rien à boire ! fit le mendiant. On est presque en terre d’islam, ici, et les houris de Mohammed se montraient plus généreuses.
– Il n’y a qu’à parler, dit Morosini en tirant d’un sac de voyage qu’il portait avec lui deux porons de manzanilla enveloppés de linge humide pour leur conserver de la fraîcheur.
Il en tendit un à son compagnon.
– Señor, vous savez vivre ! dit celui-ci en renversant la tête pour s’envoyer, d’un geste habitué, une longue rasade au fond du gosier. Aldo en fit autant mais plus modérément :

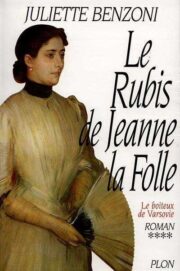
"Le rubis de Jeanne la Folle" отзывы
Отзывы читателей о книге "Le rubis de Jeanne la Folle". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Le rubis de Jeanne la Folle" друзьям в соцсетях.