– L’Egypte, grogna Aldo, vaguement frustré. Vous aussi ?
– Ne le prends pas à mal, mais le cher Adalbert nous en a tellement rebattu les oreilles pendant un mois qu’il a fini par me tenter. Et puis le souffle du désert sera excellent pour mes articulations ! Plan-Crépin, allez chez Cook nous retenir des cabines et aussi des chambres au Mena House de Ghizeh pour commencer. Nous verrons ensuite !
– Et nous partons quand ?
– Demain, tout de suite... par le premier bateau ! Et ne faites pas cette tête ! Vous qui avez déjà tellement de cordes à votre arc, vous allez pouvoir vous exercer au maniement de la pelle et de la pioche ! Cela vous changera de vos exploits de monte-en-l’air !
Deux jours plus tard, elles avaient disparu, laissant derrière elles une montagne de regrets et un grand vide tout à fait palpable quand Morosini et Guy Buteau se retrouvèrent tête à tête dans le salon des laques où l’on prenait les repas le plus souvent... L’ancien précepteur était sensible, lui aussi, à la soudaine désertification du palais. A la fin de ce premier repas pris en silence, il traduisit son impression :
– Vous devriez vous marier, Aldo ! Cette grande demeure n’est pas faite pour abriter seulement un célibataire et un vieux garçon...
– Mariez-vous vous-même, mon cher, si le cœur vous en dit ! Moi ça ne me tente pas.
Puis, après avoir allumé une cigarette d’une main nonchalante, il ajouta :
– Vous ne croyez pas que nous sommes ridicules ? Après tout, nos invités n’étaient là que depuis un grand mois, et auparavant, je crois me souvenir que nous vivions parfaitement bien ?
Sous leur fine moustache grise, les lèvres de M. Buteau s’étirèrent en un demi-sourire :
– Nous n’avons jamais été seuls, Aldo ! Naguère, nous avions Mina. Je crois bien que c’est elle que je regrette le plus...
Morosini changea de visage et écrasa dans un cendrier la cigarette qu’il venait d’allumer :
– S’il vous plaît, Guy, évitons d’en parler ! Mina, vous le savez, n’existait pas. Ce n’était qu’un leurre, une apparence recouvrant la fantaisie passagère d’une fille riche qui cherchait à se distraire...
– Vous n’êtes pas juste et vous le savez. Mina... ou plutôt Lisa, pour lui donner son véritable nom, n’a jamais cherché ici une distraction. Elle aimait Venise, elle aimait ce palais : elle a voulu y vivre...
– ... et, déguisée en bas-bleu, braquer sur l’étrange bestiole que je suis un microscope dépourvu de bienveillance. Son verdict ne m’a pas été favorable.
– Et le vôtre, maintenant que vous la connaissez sous son aspect réel ?
– N’a aucune espèce d’importance ! Qui voulez-vous que cela intéresse ?
– Moi, par exemple, fit Buteau avec un sourire. Je suis persuadé qu’elle est la femme qu’il vous faudrait.
– Cela vous regarde et comme vous êtes seul de cet avis, le mieux est d’en rester là. Allons plutôt nous coucher ! Demain, nous aurons à mettre à la tâche le jeune Pisani et, comme il y a en outre plusieurs rendez-vous, la journée sera longue... D’ailleurs, s’il fait l’affaire, nous aurons vite oublié Mina.
En fait, dès le premier coup d’œil, Morosini avait été certain que la recrue lui conviendrait. Ce jeune Vénitien blond, courtois, bien élevé, bien habillé et plutôt sobre de paroles ne détonnerait aucunement au milieu des marbres et des ors d’un palais transformé en magasin d’antiquités de classe internationale. Il s’y intégra même avec un naturel parfait car il éprouvait une véritable passion pour les beaux objets anciens. Surtout ceux en provenance d’Extrême-Orient, faisant preuve d’une érudition qui stupéfia son nouveau patron quand il « pêcha » sur une console une gourde à couverte céladon du xviii siècle : sans même prendre la peine de la retourner pour chercher le nien-hao – le titre de règne –, Angelo Pisani s’écria :
– Admirable ! Cette gourde à triple goulot d’époque Kien-Long, ornée en relief des diagrammes talismaniques des « vraies formes des cinq montagnes sacrées », est une pure merveille ! Elle n’a pas de prix !
– Je compte pourtant lui en donner un, fit Morosini, mais je vous fais mon compliment ! Me Massaria ne m’avait pas dit que vous étiez un sinologue de cette force.
– Par ma mère, j’ai un peu de sang de Marco Polo, expliqua modestement le nouveau secrétaire. Mon attirance découle sans doute de cela, mais je sais aussi quelques petites choses sur les antiquités d’autres pays.
– Et les pierreries, les joyaux anciens, vous vous y connaissez aussi ?
– Pas du tout ! admit le jeune homme avec un sourire désarmant. Sauf, bien sûr, pour les jades et bijoux chinois, mais si M. Buteau veut bien m’initier, j’apprendrai sûrement assez vite.
Il fit preuve, en effet, de nettes dispositions et comme, côté secrétariat, il n’y avait pas grand-chose à lui enseigner, Morosini se déclara satisfait, regrettant toutefois qu’en dehors du métier, il fût à peu près impossible de tirer trois paroles d’Angelo. Il était, dans le palais, une sorte d’ombre silencieuse et efficace mais pas autrement distrayante, et Aldo n’en regretta Mina que plus amèrement : elle avait la repartie vive, souvent pittoresque, et avec elle au moins, on s’amusait...
Pour tenter de se désennuyer, il s’offrit une aventure avec une cantatrice hongroise venue chanter Lucia di Lammermoor à la Fenice. Elle était blonde, ravissante, fragile, ressemblait un peu à Anielka et possédait une voix de cristal digne d’un ange, mais c’était bien tout ce qu’elle avait d’angélique. Aldo découvrit vite que la belle Ida était aussi experte en amour qu’en comptabilité, qu’elle savait parfaitement distinguer un diamant d’un zircon et qu’en tout état de cause elle ne voyait aucun inconvénient à joindre un titre de princesse à celui de prima donna.
Peu désireux de transformer ce rossignol migrateur en poularde domestique, Morosini se hâta de lui ôter ses illusions, et la romance prit fin, un soir de juin, sur le quai de la gare de Santa Lucia par le don d’un bracelet de saphirs, d’un bouquet de roses et d’un grand mouchoir destiné au rite des adieux, que l’amant inconstant put voir s’agiter longuement par la fenêtre baissée du sleeping, à mesure que le train s’éloignait.
Rentré chez lui avec un vif sentiment de soulagement, Morosini trouva un peu moins amère la solitude à deux dans laquelle Guy Buteau et lui se mouvaient, avec la curieuse impression d’être coupés du reste du monde.
Cela tenait surtout à la rareté des nouvelles envoyées par les gens qu’ils aimaient bien. Les sables de l’Egypte semblaient avoir englouti Vidal-Pellicorne, la marquise et Mlle du Plan-Crépin. Le premier pouvait arguer l’excuse d’un métier très absorbant, mais les deux autres auraient pu envoyer autre chose qu’une seule carte postale en six mois !
Pas de nouvelles non plus d’Adriana Orseolo, la cousine d’Aldo. La belle comtesse, partie pour Rome l’automne dernier afin de faire inscrire son valet – et amant ! – Spiridion Mélas chez un maître du bel canto, semblait s’être effacée elle aussi de la surface de la terre. Même l’annonce du cambriolage de sa maison ne lui tira qu’une lettre adressée au commissaire Salviati pour lui exprimer son entière confiance dans la police de Venise, s’affirmant trop occupée pour quitter Rome. De toute façon, le prince Morosini était sur place pour veiller à ses intérêts.
Un peu suffoqué d’un pareil sans-gêne – il n’avait même pas reçu une carte de Nouvel An ! –, celui-ci empoigna son téléphone et appela le palais
Torlonia où Adriana était censée habiter. Il apprit qu’après un séjour d’une semaine sa cousine était partie sans laisser d’adresse. Et, sous le ton courtois de son correspondant, Morosini crut comprendre que les Torlonia en étaient plutôt soulagés. Même échec auprès du maestro Scarpini : le Grec possédait une belle voix, certes, mais un caractère trop difficile pour qu’il soit possible d’envisager un séjour de plusieurs mois en sa compagnie. On ignorait où il avait porté ses pas...
Le premier mouvement d’Aldo fut d’envoyer chercher un billet pour la capitale italienne mais il se ravisa : fouiller Rome était une entreprise aléatoire, et le couple l’avait peut-être quittée pour Naples ou toute autre destination. En outre, Guy, consulté, suggéra, puisque la comtesse avait choisi de se fondre dans la nature, de la laisser poursuivre son aventure.
– Mais je suis son seul parent et j’ai de l’affection pour elle, plaida Aldo. Je lui dois de la protéger.
– Contre elle-même ? Vous ne réussirez qu’à vous brouiller. Je la crois aux prises avec le démon de midi. Elle en a l’âge et, malheureusement, on n’y peut rien. Il faut la laisser aller jusqu’au bout de sa folie mais se tenir prêt à ramasser les morceaux quand le temps en sera venu.
– Il va achever de la ruiner. Elle n’est déjà pas si riche !
– Elle l’aura voulu.
C’était la sagesse même et, de ce jour, Aldo évita de prononcer le nom d’Adriana. Il était déjà suffisamment hanté par elle depuis la découverte de certaine correspondance dans le tiroir secret de son cabinet florentin, après le cambriolage. Une lettre surtout, signée R., et qu’il avait gardée afin d’y réfléchir longuement, sans y trouver une autre clef que l’amour mais sans se résoudre à en partager le mystère, même avec Guy. Peut-être pour ne pas être obligé de trop regarder les choses en face : au fond de lui-même, il avait très peur de découvrir que cette femme – son premier amour d’adolescent ! – était mêlée de près ou de loin à la mort de sa mère...
En fait, Aldo n’avait pas beaucoup de chance avec les femmes chères à son cœur. Sa mère avait été assassinée, sa cousine était en train de tourner à la gourgandine. Quant à la ravissante Anielka dont il s’était épris dans les jardins de Wilanow, elle s’était retrouvée devant le tribunal d’Old Bailey, accusée du meurtre de sir Eric Ferrals, son mari, épousé sur l’ordre de son père, le comte Solmanski. Elle aussi, après le procès, s’était volatilisée en direction des États-Unis, avec ledit père, sans lui avoir envoyé le moindre signe de tendresse ou de remerciement pour la peine qu’il s’était donnée à son service. Alors qu’elle jurait n’aimer que lui...
Et sans parler, bien sûr, de l’éblouissante Dianora, son grand amour d’autrefois, son ancienne maîtresse devenue l’épouse du banquier Kledermann. Celle-là ne lui avait pas caché qu’entre une fortune et une passion il n’était pas question d’hésiter. Le drôle, dans l’affaire, c’est que Dianora, en épousant Kledermann était devenue, sans aucun plaisir, la belle-mère de Mina, alias Lisa Kledermann, la secrétaire modèle mais à transformations, que toute la maisonnée regrettait d’un cœur si unanime ! Elle aussi s’était dissoute dans un matin gris et brumeux sans songer un instant qu’un mot d’amitié aurait peut-être fait plaisir à son ancien patron.
L’été passa. Lourd, brumeux, orageux. Pour fuir les hordes de touristes et de « voyages de noces », Aldo se réfugiait de temps en temps sur l’une des îles de la lagune en compagnie de son ami Franco Guardini, le pharmacien de Santa Margarita dont il appréciait le naturel silencieux. Ils passaient là des heures paisibles parmi les herbes folles, sur un banc de sable ou au pied d’une chapelle en ruine, pêchant, se baignant, retrouvant surtout les joies simples de l’enfance. Aldo s’efforçait d’oublier que le courrier n’apportait jamais que des lettres d’affaires ou des factures. Seule exception dans cet océan d’oubli, une courte épître de Mme de Sommières annonçant un séjour à Vichy afin d’y soigner un foie qui ne se sentait pas au mieux de son expérience africaine : « Viens nous rejoindre si tu ne sais pas quoi faire ! » concluait la marquise avec une désinvolture qui acheva d’indisposer son petit-neveu. Ils étaient incroyables, ces gens qui ne pensaient à lui que lorsqu’ils commençaient à s’ennuyer ! Il décida de bouder.
Pourtant, il éprouvait une inquiétude grandissante au sujet de Vidal-Pellicorne. Si les dangers courus par un archéologue sont réduits, il n’en allait pas de même quand, à cette paisible profession, on joignait celle d’agent secret, et Adalbert était très capable de s’être fourré dans un piège quelconque. Aussi, pour en avoir le cœur net, décida-t-il d’envoyer un télégramme à l’intention du professeur Loret, conservateur du musée du Caire, pour lui demander ce que devenait son ami. Et ce fut en revenant du bureau de poste qu’il trouva la lettre sur son bureau...
Celle-là, pourtant, ne venait pas d’Egypte mais de Zurich, et le cœur de Morosini manqua un battement. Simon Aronov ! Ce ne pouvait être que lui ! En effet, l’enveloppe ouverte libéra une feuille de papier pliée en quatre sur laquelle on avait écrit à la machine : « Mercredi 17 octobre à l’Opéra de Vienne pour le Chevalier à la rose. Demandez la loge du baron Louis de Rothschild. »

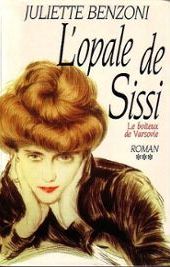
"L’Opale de Sissi" отзывы
Отзывы читателей о книге "L’Opale de Sissi". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "L’Opale de Sissi" друзьям в соцсетях.